LES TOILES ROSES


MARC ENDEWELD
RENCONTRE
ABDELLAH TAÏA
(2/2)
Journaliste, Marc réalise des enquêtes et des reportages pour de nombreux journaux sur des sujets aussi divers que la vie politique, l’économie, l’actualité sociale, les nouvelles technologies, les médias et leur économie, la lutte contre les discriminations et la question des minorités...
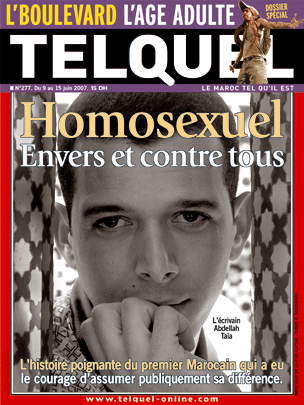
Ces mots, il les a sortis d’un coup, comme une évidence. Immédiatement. Une vraie claque : « Je me sens terroriste », dit simplement Abdellah. Dans une époque où ce vocable – « terroriste » – est devenu l’expression du mal le plus absolu, l’employer détonne. Abdellah est écrivain et connaît le poids des mots.
Pas de provocation là-dedans pourtant. Au contraire, le début d’une réflexion dense, irréprochable de mon point de vue, car évacuant pensée binaire, caricatures, et volonté de croisades. Si Abdellah est « moderne », c’est d’abord parce qu’il s’inscrit dans une histoire, celle du Maroc. Où affirmation nationale aurait dû avoir partie liée avec débat politique. Ce rêve de Mehdi Ben Barka. Questionnant son héritage, Abdellah n’hésite pas à relever le défi de la référence, de la hauteur, de l’ambition. Dans son refus de se placer entre le bien et le mal, de se poser en « victime », l’écrivain refuse d’être réduit à un symbole, d’être réduit à un faire valoir idéal à toute récupération. « L’homosexualité n’est pas une vitrine », dit-il. Ça nous rappelle que dans notre monde englué dans le « choc des civilisations », un piège, s’extraire des facilités est plus qu’une nécessité. Une survie. Si l’on veut éviter la peur. Échapper à la guerre civile. Étrange écho d’ailleurs avec la dernière référence de cette interview : Albert Camus. Car l’ambition du « premier homme » est devenu un combat dans notre époque de morts vivants.
Dans l’introduction de son ouvrage collectif, Lettres à un jeune marocain, Abdellah lâche : « Aujourd’hui je sais que tout dans nos vies est politique ». N’oubliant pas son histoire, sa pauvreté originelle, il sait que le refus des dominations n’est pas quelque chose qui va de soi. Qu’il est d’abord question de résistance aux puissants et de combat. La colère d’Abdellah est politique, mais au sens noble du terme. L’inverse de la manipulation d’egos et des manœuvres d’appareils (et de leur préservation à tout prix). L’inverse du politiquement correct et de la bonne conscience si chère aujourd’hui à l’homosexualité parisienne. Pas d’effet de posture chez Abdellah. Au contraire, une cohérence rugueuse. Le contraire du fake. Le contraire des imposteurs qui ont envahi nos écrans « modernes ».

Abdellah Taïa me fait penser à un autre grand résistant et écrivain. Jack London. Tous deux viennent des va-nu pieds. Tous deux ont approché l’aristocratie de notre société. Mais leur idéal de responsabilité est plus fort que toutes les compromissions. Dans un texte autobiographique intitulé Ce que signifie la vie pour moi (Disponible aux Éditions du Sonneur), London, en colère lui aussi, parle justement des morts-vivants qu’il a rencontré en politique, à l’Université, dans les sphères culturelles et intellectuelles : « Dans cette catégorie des morts-vivants, je fais une place d’honneur aux professeurs que j’ai rencontrés, des hommes qui s’en remettaient à cet idéal universitaire décadent qu’est la poursuite sans passion de l’intelligence sans passion ». Ces professeurs, experts, avocats, juristes, journalistes, psychologues qui pullulent aujourd’hui dans toutes les boutiques « militantes »… et si éloignés de leur vérités personnelles, protégés à la fois par leur statut social, et leurs compétences « techniques ».
Justement, un ami m’a écrit un mail suite à la publication de l’interview d’Abdellah dans Têtu du mois de Novembre : « Ce que dit Abdellah me semble très fort, puissant et essentiel, et je suis très touché par son engagement qui me semble aller au-delà de l’engagement intellectuel classique car il touche à tous les aspects de sa vie (…) Pour moi cet interview me semblait aussi importante que celle qu’avait donné Guy Hocquenghem dans le Nouvel Obs en 1972 car il en ressort un discours vraiment nouveau et révolutionnaire ». Alors Abdellah Taïa, mauvaise conscience des pédés parisiens en désespérance politique ? Il y a sûrement un peu de ça, même si on ne peut, bien évidemment, le réduire à ce miroir qui nous ramène à tous nos renoncements.
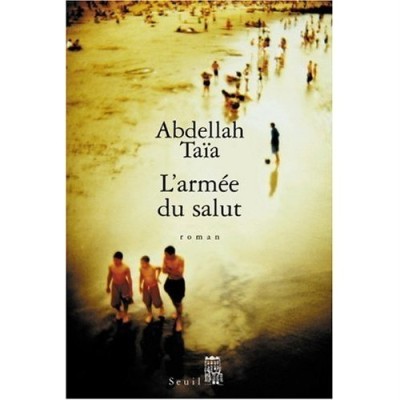
Pour finir, je citerai les derniers mots d’Abdellah, dans Têtu : « Je me sens libre, mais je ne me reconnais pas dans la manière dont les homosexuels vivent ici. L’homosexualité est liée pour moi à un combat de vie, ce n’est pas quelque chose de léger… L’homosexualité a un sens de résistance, même si je ne limite pas mon identité à celle-ci. En France, on m’a fait passer pour le gentil petit Marocain qui fait le couscous et le tajine, le petit Maghrébin qu’on a envie de mettre dans son lit, ou alors le pauvre musulman qui ne peut pas boire ni manger de porc. Toutes ces réductions de mon identité, ça m’a fait mal. J’ai appris à redevenir malin comme dans mon quartier de Hay Salam, au Maroc, à résister à cette autre banalisation de mon être. J’ai continué à écrire, à être superstitieux, secret, à être quelque part religieux, mais à partir d’une religion réinventée ». Oui continuons à « écouter » Abdellah, car même à l’écrit, ses paroles, ont la force de raisonner en chacun de nous. En tout cas, à 28 ans, je l’espère.

Marc Endeweld : Tu dis une chose extrêmement forte : « ces jeunes Marocains, terroristes, c’est moi ». Tu dis aussi : « L’homosexuel, c’est pas fashion ». En fait, tu fais de ton combat homosexuel un véritable combat politique. Dans l’introduction de ton ouvrage collectif Lettres à un jeune Marocain, tu en appelles à revenir à la lumière de Mehdi Ben Barka, et tu soulignes la trahison de la génération de tes parents sous Hassan II, des intellectuels. Tu soulignes qu’on a vendu le Maroc plutôt que d’être à la hauteur de ce rêve… Là aussi, tu t’inscris totalement dans l’histoire marocaine… Tu ne te places pas du côté du bien contre le mal…
Abdellah Taïa : Je me sens terroriste, oui, comme ces deux jeunes frères qui se sont fait exploser à Casablanca. Je me sens comme eux. D’ailleurs quand j’ai commencé à écrire cet article, « Il faut sauver la jeunesse marocaine », j’ai eu aussi une autre idée : écrire le roman d’un kamikaze marocain à la première personne. Je voulais aller jusqu’au bout de cette identification et révéler en même temps la réalité intérieure, et le double rejet dans lequel a vécu ce kamikaze. Il était hors de question pour moi de l’éloigner, de me dissocier de lui, de le rejeter même dans sa mort. Rejeter le kamikaze, ne pas chercher à le comprendre, c’est le tuer une deuxième fois.
Comme les autres rejettent l’homosexuel…
Oui. Absolument. Je me sentais terroriste en écrivant cette histoire, cet article. Je ne me suis jamais, jamais, considéré comme une victime. Je ne suis pas une victime, ni de la société marocaine, ni de ma famille. La victime se tait, pleure, donne malgré elle raison à la société et ses diktats. Cela ne veut pas dire que je n’ai pas de compassion pour les victimes, bien au contraire… Mais ce n’est pas parce que je suis homosexuel que je suis une victime. Ce point-là est très, très important. Je me sens fort comme ma mère. J’ai appris d’elle comment me défendre, me battre. Il a fallu, bien sûr, attendre le bon moment pour s’engager dans le combat, être suffisamment armé… Aujourd’hui, j’ai la possibilité de le faire, et aller par la même occasion au plus profond des choses. Il ne suffit pas de dire : « Je suis contre tel ou tel islamiste ». En tant qu’écrivain, ça serait presque un crime de ma part que de condamner des gens aussi facilement, il faut bien au contraire entrer dans leur peau. Je peux le faire. Être homosexuel ne m’empêche pas de comprendre les autres, un hétérosexuel marocain, par exemple, engagé, poussé vers le pire. Moi-même j’ai été contacté par des islamistes quand j’étais adolescent, ils m’ont invité, je suis allé les voir, manger avec eux… J’aurai pu m’enfoncer davantage dans cet extrémisme… Le rêve du cinéma et le rêve d’aller à Paris m’ont sauvé. Je ne suis pas en train de prendre la pose ici. Je comprends de l’intérieur ces deux frères terroristes qui se sont fait exploser à Casablanca. Écrire, c’est aller loin dans l’histoire, dans le passé historique et chercher une figure qui incarne quelque chose de fort, « de haut », de noble, quelque chose à la hauteur du Maroc, et plus grand que le Maroc, pour le replacer dans le monde. Cette figure a existé, il s’agit de Mehdi Ben Barka qui a été assassiné dans les années 1960. Il avait un rêve pour les Marocains, il avait un idéal, il venait d’un milieu très pauvre, il s’est battu pour l’indépendance du Maroc, il voulait faire quelque chose avec ce pays, apporter quelque chose, donner quelque chose aux Marocains, à lire, à voir, les porter haut, plutôt que de les écraser. Il se trouve que ce grand rêve a été tué, et avec lui toute une génération d’intellectuels marocains, et cela dure jusqu’à aujourd’hui. Quand je pense à l’histoire moderne du Maroc, je ne vois pas une autre figure comparable à celle de Mehdi Ben Barka. Il était donc important pour moi de rattacher cet ouvrage collectif, Lettres à un jeune marocain, à cette figure. Faire un lien entre le combat de ce grand homme et celui de ma génération.
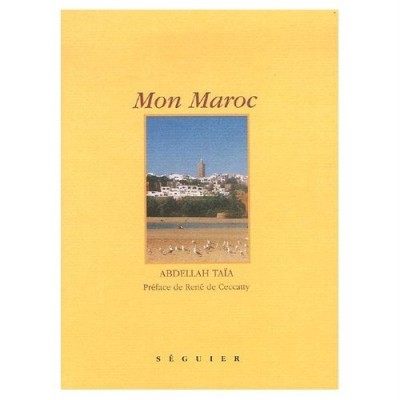
Tu dis toi-même : « Je ne savais pas qui c’était »…
Car moi-même, longtemps, j’ai été complètement dépolitisé. Je ne me rendais pas compte de la valeur réelle de ces gens-là, ces véritables combattants. On patauge depuis plusieurs décennies déjà dans un discours officiel qui réécrit l’histoire et la vide de son sens… Ben Barka a été assassiné à Paris par le pouvoir, avec la contribution des services secrets français. Son rêve ne doit pas mourir. C’est ce que je dis dans l’introduction de ce livre. C’est un message pour les générations qui arrivent aujourd’hui, celles d’Internet, qui ne se rendent pas compte de l’importance historique de Ben Barka.
Cette obligation de compréhension en tant qu’écrivain fait que tu acceptes dialoguer avec les islamistes… Ça t’a amené à défendre la liberté d’expression en Espagne.
Porter des idées comme je le fais nécessite une certaine vigilance, par rapport à l’instrumentalisation dont je peux être l’objet par des institutions ou des personnes qui veulent faire de moi une figure opprimée, victime, et se servir de ce que j’écris, de ce que je suis devenu, pour justifier leur côté politiquement correct. J’en ai eu l’illustration au mois de mars dernier quand un grand festival espagnol, celui de Cartagena, a censuré Nadia Yacine en annulant sa participation après l’avoir annoncée dans la presse. Nadia Yacine est la fille de l’islamiste marocain le plus connu, Cheikh Yacine… J’ai grandi pas loin de chez lui, il vient aussi de Hay Salam. Ils ont également déprogrammé Ali Lamrabet, un journaliste qui a fait des caricatures par rapport au roi et au budget du palais royal, et qui est maintenant exilé en Espagne. Le festival a reçu des pressions, et a décidé de supprimer ces deux personnes du programme. Le directeur du festival n’a rien a dit dans le quotidien espagnol El Pais : « Mais il n’y a pas de censure, puisque Abdellah Taïa va venir, et il sera libre de parler de ce qu’il veut, même de l’homosexualité ». Bref, une récupération de ce que je suis pour justifier la censure.
Ce que je n’accepte pas au Maroc, on me demandait de l’accepter en Espagne, pays démocratique. Il fallait que je m’estime heureux, moi petit Marocain qu’on invite, et qu’en plus je souscrive à la censure d’autres Marocains. Qu’est-ce que cela veut-il bien dire ? Que le Maroc a besoin de gens qui pensent tous la même chose, tous du même côté ? Je ne crois pas. Ce qui nous manque c’est l’installation sérieuse d’un débat contradictoire. Moi, je n’ai rien contre Nadia Yacine comme personne, ce sont ses idées que je n’accepte pas. Elle est quand même marocaine, et le Maroc est pluriel. Il fallait que je dise tout cela et que je me retire du festival, car j’estimais que c’était un manque de respect vis-à-vis de moi et vis-à-vis du Maroc. C’est ce que j’ai fait dans une tribune publiée en avril 2009 dans El Pais. J’ai dit ma solidarité pour ces gens, pour ces deux personnes censurées, et j’ai replacé l’homosexualité, et la prise de parole par rapport à l’homosexualité. Redire le sens profond de cela. Parler de l’homosexualité n’était pas destiné à l’Occident. Ce n’était pas une vitrine.

Peux-tu revenir sur la génération Internet ?
Je me suis construit seul. Quand j’ai pris conscience de mon homosexualité, j’ai compris qu’il n’y avait personne autour de moi avec qui parler, chez qui je pouvais trouver de la tendresse ou bien un interlocuteur. Jusqu’à ce que je quitte le Maroc, j’avais pris l’habitude de ne consulter personne, de ne me référer qu’à moi-même, et de prendre seul toutes les décisions importantes, ou moins importantes, qui concernent ma vie, mes lectures, mon temps libre, etc. Ce fonctionnement solitaire, malgré la douleur, et malgré les incertitudes, et des fois, les larmes et l’errance, ce fonctionnement m’a sauvé, car j’ai su très vite qu’il ne fallait surtout pas demander l’autorisation aux autres, ni à ma mère, ni à mon grand frère, ni à mes amis, ni à mes professeurs, car intuitivement j’avais conscience que ces gens-là, même s’ils étaient intellectuels, même s’ils m’aimaient, allaient me ramener à des sentiments de protection et de peur, et donc à un autre enfermement dont ils n’avaient même pas conscience eux-mêmes. Donc finalement cette solitude en tant qu’homosexuel, en tant qu’individu qui se destine par les rêves à quelque chose de grand, m’a sauvé. Il faut dire qu’à l’époque, il n’y avait pas Internet, il n’y avait pas ce monde virtuel de l’informatique dans lequel on est en train de refaire aujourd’hui le monde d’une certaine façon, et dans lequel on est en train de redéfinir les règles et les lois, et la morale, malgré toute la sauvagerie que cela implique.
C’est la différence entre moi, 36 ans aujourd’hui, qui pensais parfois la nuit que j’étais le seul homosexuel au Maroc, et les jeunes homosexuels marocains d’aujourd’hui. Ils ont pu, grâce à Internet, je ne vais pas dire sauver leur peau, mais au moins se sentir un peu moins seuls. Entamer déjà quelque chose, accéder à un monde sans surveillance, celui de l’Internet, où pendant un moment, chaque jour, ils peuvent être eux-mêmes à la fois dans leur sexualité et dans leur pensée. Et même si Internet ne tient pas toutes ses promesses, et même si cette liberté peut être dangereuse car accentuant la solitude, et l’isolement et la folie, il y a quand même une différence entre nous. Et le meilleur exemple de ce que je dis, c’est ce jeune Marocain qui s’appelle Samir Bargachi, qui a créé sur Internet un site pour défendre les homosexuels marocains, pour leur donner un espace où ils peuvent s’exprimer, et à partir duquel ils peuvent réclamer des changements de loi, et petit à petit, constituer un réseau d’influence, d’amis qui pèseront un jour, j’espère sur le gouvernement marocain. Je trouve que ce garçon est beaucoup plus courageux que moi, il a à peine 22 ans, a déjà créé ce site et fait parler de lui. Il est allé au Maroc pour annoncer la création de ce site, il a donné une conférence de presse à Casablanca en avril dernier, il a accordé des interviews dans plusieurs journaux importants au Maroc, en arabe comme en français. Ce garçon porte en lui un espoir énorme.
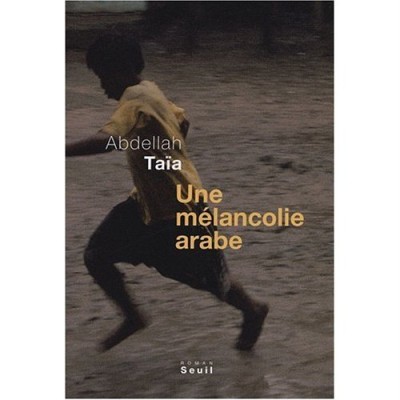
Tu dis : « Je me suis construit dans la solitude ». Comment es-tu passé du « nous » au « je » ?
J’ai grandi à Salé, une ville juste à côté de Rabat. C’est une ville connue dans l’histoire du Maroc pour ses pirates, ses corsaires, dont on trouve les traces dans Candide de Voltaire, et aussi les livres de William Defoe et de Dickens. J’ai grandi dans cet imaginaire, celui de gens un peu en dehors des lois, loin du centre-ville, à la périphérie, dans un quartier qui s’appelle Hay Salam (« quartier de la paix ») et qu’on appelait Hay Dalam (« quartier des ténèbres »). On était oubliés, marginalisés. Mais, en même temps, ce quartier se trouve juste à côté de la route vers l’aéroport de Rabat Salé, à 1 ou 2 km de la base militaire la plus importante du Maroc et à seulement 1 km d’un terrain où je me jouais au football et sur lequel a construit aujourd’hui une prison, la prison Zaki, la plus importante au Maroc. J’ai grandi donc à côté de cette prison qui montait, qui s’élevait… J’ai passé mon enfance libre en regardant cette prison vide, bientôt pleine. J’étais un pauvre va-nu-pieds, je hantais les rues, je me bagarrais, je faisais partie d’un clan, avec les copains on tuait les chats, on finissait les bouteilles de vin en plastique des ivrognes du quartier : une enfance où tous les jeux interdits étaient simples et naturels. Autant cette enfance était quelque chose de beau, de fort, et de très pauvre en même temps, autant tout le reste de ma vie dans ce quartier a été marqué par un isolement progressif, dans le sens où j’ai compris qu’on me demandait d’être une figure masculine conforme aux diktats de la société. J’en étais incapable.
Je n’avais pas d’autre choix que de… non pas me retirer du monde, mais de trouver une place ailleurs, un point de vue autre, dans le noir si je peux dire, et à partir duquel j’essayerai d’envisager une possibilité d’exister… C’est ce que j’ai fait, j’ai cessé de fréquenter ces garçons de l’enfance. Je suis devenu un solitaire. Évidemment, tout cela n’a pas été simple car il a fallu gommer des choses de ma personnalité qui choquaient les gens autour de moi. Je crois que j’étais assez efféminé quand j’étais enfant et le quartier me renvoyait cette image, celle d’un petit garçon efféminé. Même dans ma famille. Tant que j’étais enfant, cela n’avait pas beaucoup d’importance, mais quand que je suis devenu adolescent, c’était une autre histoire. Soit on devient un homme, un actif, ou bien on est cette petite chose sexuelle sur laquelle tout le quartier va passer, pour que la libido des hommes dans cette ville, dans ce quartier, soit canalisée. Certains ont été sacrifiés, tués, et je ne voulais pas devenir ça, je ne voulais pas mourir tout simplement. Il fallait donc résister. J’ai fait tout cela d’une manière très intuitive. J’ai cessé de fréquenter ces garçons de l’enfance, je me suis tu. Je n’avais pas de chambre pour moi. Je dormais avec mes six sœurs, ma mère et mon petit frère. Je savais qu’il fallait attendre plusieurs années avant d’en avoir une à moi, dans laquelle réinventer tout, redécouvrir tout. Voilà. C’est dans ce quartier que le passage du « nous » au « je » s’est produit, mais ce n’était ni un passage intellectuel, ni un passage dans le but d’écrire un jour… C’était une nécessité intérieure, une manière de sauver ma peau.

Que s’est-il passé ensuite ? Le cinéma est arrivé dans ta vie…
À partir du moment où je me suis retiré, en quittant la rue, l’espace privilégié de l’enfance, l’obsession des films a commencé. Je devais avoir 13 ans. Je ne voyais plus les films de la même façon. Avant, j’allais au cinéma. Maintenant, j’allais voir des films, je choisissais. J’ai découvert un autre plaisir cinématographique à partir duquel j’ai pu construire, petit à petit, mon regard sur le monde. Un regard nouveau qui m’a permis de découvrir ce qui se passait autour de moi autrement. Je voyais les films, je les enregistrais en moi et, en même temps, j’observais ce qui se passait de troublant, d’interdit, à l’intérieur des salles de cinéma populaires où je me rendais. Il y avait autant de spectacle sur l’écran que dans la salle. C’était des salles où allaient les gens pas bien, les « mauvaises gens », les garçons qui buvaient, les drogués, les mauvaises filles, les prostituées. Un lieu de la marginalité. À l’époque, je me méfiais de ces gens-là, ces « hors la loi », je pensais que, eux aussi, allaient découvrir mon secret. J’étais avec eux, dans les mêmes images qu’eux et je me cachais d’eux.
J’avais tort : je ne l’ai compris que plus tard… Oui, les films, au sens propre, m’ont aidé à traverser toutes sortes d’épreuves, à survivre dans la solitude, à ne pas trop rejeter le monde malgré la colère qui montait, qui montait, en moi. Les films m’ont permis de rencontrer un autre rêve, celui d’aller un jour à Paris. Une star de cinéma français a toujours été pour moi liée à ce rêve : c’est Isabelle Adjani. J’avais trouvé dans la chambre de mon grand frère des vieux numéros du magazine Première : elle était sur la couverture d’un des numéros qui datait des années 1970. Sur cette couverture, elle avait des cheveux un peu crépus, un regard halluciné, une peau incroyablement blanche, très blanche, trop blanche. Elle était belle, plus que belle, irréelle tellement elle dépassait les canons de la beauté. Et, en même temps, elle semblait ailleurs, habitée, hantée, possédée. On aurait dit « une folle ». Elle avait l’air très française, et pas très française. J’ai volé ce numéro de Première et j’ai appris à aimer de loin Paris en regardant les yeux et le visage d’Isabelle Adjani.
Plus tard, beaucoup plus tard, j’ai tout appris sur elle, sur ses origines, son père algérien kabyle, sa mère allemande. J’ai appris, grâce à cette grande actrice, que l’on pouvait être français en venant d’ailleurs. Être français, c’était une idée, Isabelle Adjani l’incarnait superbement. Elle l’incarne toujours. J’admire Isabelle Adjani. Naïvement, imbécile heureux, je me dis certains jours pour me remonter le moral : « Tu n’as pas le droit de déprimer ; après tout, tu vis sous le même ciel qu’Adjani… » C’est idiot, je sais. Je suis aussi comme ça, complètement idiot...

Tu as fait des études au Maroc…
Oui, j’ai fait presque toutes mes études au Maroc. Je voulais aller à Paris après le Bac pour entrer à la FEMIS. Je voulais devenir réalisateur. J’ai donc écrit à la FEMIS. Ils m’ont répondu. Il fallait avoir le DEUG pour pouvoir passer le concours d’entrée. Je me suis alors inscrit au département de littérature française à l’université Mohammed V, à Rabat. Dès le premier jour à la Faculté, je me suis rendu compte que mon niveau en français était vraiment très faible. Cette langue n’a jamais été la mienne, et ne le sera jamais peut-être.
À côté des étudiants qui venaient de la mission française, j’étais vraiment nul. Mon complexe d’infériorité est devenu énorme. Il fallait faire quelque chose… Arriver au même niveau que ces autres étudiants, les combattre dans cette langue étrangère, les dépasser. Et pour mener cette bataille en langue française, j’ai tenu un journal intime, qui n’en était pas un vraiment : des cahiers bleus dans lesquels j’écrivais des phrases en français, fausses, correctes, des phrases pour apprivoiser cette autre langue, la séduire, la « baiser », lui donner des coups, la mélanger à l’Arabe. Un journal intime pour tout réapprendre, tout redécouvrir dans un monde où les mots en français étaient vrais, bien dits. Maîtriser cette langue au sens propre, se familiariser avec sa grammaire, sa syntaxe. J’avais en moi, à ce moment-là, un désir fort d’aller vers cette langue pour la prendre, la « maltraiter », la posséder, la rendre mienne. Malgré sa supériorité et son snobisme. Ce sont ces batailles avec (et dans) la langue française qui m’ont amené à la littérature.
Un jour, j’ai découvert que ce que j’écrivais pouvait être transformé en quelque chose d’autre, une histoire, un texte, un petit poème, une autre forme. Et quelque chose d’autre est arrivé aussi, ce qu’on appelle le style. C’est-à-dire une autre manifestation de moi-même, une autre réalisation… J’ai compris que je pouvais faire quelque chose avec ça, intervenir dans mon monde avec un autre point de vue… C’est ce que j’ai fait… Entre temps j’avais obtenu le DEUG, mais mes parents étaient toujours pauvres : je ne pouvais pas aller à Paris passer le concours de la FEMIS. Pour aller à Paris, il fallait de l’argent, connaître des gens, avoir des liens... J’ai donc continué à étudier la littérature française, Maîtrise sur Guy de Maupassant, DEA sur Marcel Proust. Et la chance est arrivée : on me donne une bourse pour aller étudier à l’étranger. On trouve ce rêve, « monter à Paris », dans beaucoup de romans et de films français. Moi, du Maroc, je me suis senti aussi concerné par ce rêve. Il y a une légitimité à posséder ce rêve, à le réaliser, même quand on n’habite pas en France. Il doit y avoir quelque chose de fort, d’indestructible dans ce rêve parisien...
Quand j’ai débarqué à Paris fin 1998, je n’avais aucune connaissance de la réalité des classes sociales françaises, je n’avais pas du tout conscience que j’étais un Maghrébin dans une société française qui n’accueillait pas si bien que ça un Maghrébin et en plus homosexuel. Je ne voyais pas les difficultés et, les deux premières années, je me sentais fort. Plus que fort.
Je peux tout, je ferai tout : c’est ce que je me disais. Je sentais une audace en moi, une rage, une envie folle de faire, entreprendre, contacter des gens… Je pouvais écrire, j’ai continué à le faire. J’étais dans mon rêve : Paris. Le cinéma pas loin. À portée de mains. Le rêve possible, fort... Après, bien sûr, les difficultés sont arrivées. Émigré à Paris : qu’est-ce que cela veut-il bien dire ? Seul à Paris : comment à partir de cette nouvelle réalité se réinventer ? Et le Maroc : où le mettre, comment l’écrire ? Le renier ? Lui tourner le dos ? J’ai acquis à Paris une conscience politique, une vision politique du monde et de moi-même, ce que je suis, ce que j’étais au Maroc, ce que j’allais devenir en France… Ecrire. Publier. Crier. Faire bientôt un film, d’autres films. Me rapprocher de la vérité, ma vérité, tenter de la dire, de la partager. Être nu. Homosexuel et nu. C’est cela que je veux faire, à Paris, au Maroc, dans le monde. Être, comme Albert Camus, « le premier homme ».
Première publication : Minorités
Interview reproduite avec l'aimable autorisation de Marc Endeweld.
Tous droits réservés. Merci de ne pas reproduire sans l'autorisation de l'auteur.
Toutes les photographies sont © les auteurs. Avec l'autorisation
d'Abdellah Taïa.