Fiche technique :
Avec Peter Finch, Glenda Jackson, Murray Head, Peggy Ashcroft, Tony Britton, Maurice Denham, Bessie Love, Vivian Pickles, Frank Windsor et Thomas Baptiste. Réalisation : John Schlesinger. Scénario : John Schlesinger et Penelope Gilliat. Images : Billy Williams. Montage : Richard Marden. Musique originale : Ron Geesing.
Durée : 110 mn. Disponible en VO.
Résumé :
Lui, Daniel Hirsh dit Dany (Peter Finch), médecin prospère, la cinquantaine argentée, membre influent et estimé de la communauté juive à laquelle il appartient ; elle, Alex (Glenda Jackson), d’une très bonne famille de la bourgeoisie fortunée qui s’occupe à recycler ceux que l’âge condamne au « Bloody Sunday » du chômage. Elle et lui pourraient entretenir une liaison qui serait confortable si chacun n’avait pas une faille pour ces bonnes sociétés, du Londres de 1970, auxquelles ils appartiennent. Lui est homosexuel, elle est divorcée. Et puis il y a l’autre (Murray Head). Il se doit d’y avoir un autre pour qu’existe une histoire. Cet autre est un jeune homme qui partage tour à tour leur lit. Un téléphone omniprésent assure la liaison entre ces trois personnages. Un Dimanche comme les autres n'est pas une histoire d'amour triangulaire, mais plutôt deux histoires d'amour parallèles que nous suivons durant les dix derniers jours de ces relations. Daniel et Alex ne se connaissent pas, mais ils n’ignorent pas leur existence respective. Bob est tendu vers un espoir, le départ vers l’Amérique. Il abandonnera elle et lui à la solitude des dimanches où il ne se passe rien, sinon la mort d’un chien...
L’avis de Bernard Alapetite :
Il nous a fait courir ce film, il nous a ému. On en a parlé et reparlé. Beaucoup de jeune gays (le mot existait-il en France alors ? Je ne crois pas…) se sont identifiés à Bob. Ils voulaient eux aussi partir, même si l’Amérique d’alors faisait moins rêver les français que les jeunes anglais, mais ils sont restés et avec beaucoup de chance, ils ressemblent aujourd’hui à Daniel. Une vie est passée.

C’était sans doute la première fois que l’on voyait deux hommes nus s’embrasser dans un lit. L’un aurait pu être le fils de l’autre et ils s’aimaient ; ça, on ne l’a pas beaucoup revu depuis. Il est étonnant de voir combien le cinéma gay comporte peu d’histoires d’amour intergénérationnelles, comme on dit maintenant. Est-ce l’un des derniers tabous ?
Ce film, célèbre en son temps, a disparu des écrans. Pourquoi ? Est-il devenu obsolète ou dérangeant ? Il n’existe qu’un DVD américain mais dépourvu de sous-titres français.
Il se passe en un temps qui me parait si ancien, si différent de nos jours. La libération sexuelle balbutiait. Sida était quatre lettres dénuées de sens. Dans une Angleterre d’avant Margaret Thatcher et Tony Blair qui venait d’à peine prendre conscience que sa grandeur lui avait échappé et que son empire s’était évanoui, mais où pourtant on pouvait avoir le sentiment que s’inventaient les prémisses de la civilisation du lendemain. Mais le royaume se sentait surtout menacé par la grisaille de ce fameux dimanche britannique avec sa tacite loi qui voulait que le repos soit associé à l’ennui.
Le film a mûri de longues années et son tournage ne fut pas simple comme l’expliquait John Schlesinger à sa sortie : « L’histoire du film a commencé il y a presque dix ans, au moment où je venais d’achever Billy Liar, Penelope Gilliat m’avait apporté un scénario intéressant, que je n’ai pas retenu à l’époque mais dont les éléments de base m’ont amené beaucoup plus tard, à tourner Sunday Bloody Sunday. Aussi en 1967 j’ai demandé à Penelope Gilliat de préparer un nouveau script. Je voulais faire un film sur l’amour avec un homme et une femme d’un certain âge, ayant des racines dans une société stricte, lui parce qu’il était juif, elle parce que son père était banquier, et se trouvant chacun confronté à un garçon d’une vingtaine d’années, très moderne, sans attaches et psychologiquement disponible... Il était important pour moi que ce garçon rêve d’Amérique... J’ai travaillé en étroite collaboration avec Penelope Gilliat et nous avons fait ensemble quatre scénarios avant la version définitive. Dès le début néanmoins, nous étions d’accord pour montrer les dix dernières journées d’une crise et pour respecter l’unité de temps et de lieu... Après le tournage, lorsque nous avons vu le film bout à bout, ça n’allait plus. Le jeu de Glenda était trop fort et celui de Murray trop faible. Étant responsable de ce déséquilibre, j’ai coupé mais ce n’était pas suffisant et j’ai eu l’idée de donner du papier collant à Murray. Avec ce scotch enroulé autour de la main, il créait un objet, il pouvait ainsi montrer ce goût de la manipulation, des gadgets, en accord avec le métier de sculpteur qu’il incarne dans le film...
Je suis fatigué de voir des films où les homosexuels sont des hommes malheureux, hystériques et dont le public peut et doit penser qu’ils sont des monstres. Je crois qu’il était temps de montrer sans tricher un fait naturel de la vie...
C’est un film optimiste. Alex décide de rester seule, et c’est en définitive un choix. Quand au médecin, il sait que le garçon ne l’accompagnera pas en Italie, mais malgré tout, il apprend l’italien et il fera le voyage. À la fin du film, il s’adresse au spectateur et lui dit en substance : “Ne me jugez pas, ce n’était pas grand-chose.” et il ajoute : “Je suis seulement venu pour ma toux.” Cela parce que c’est lui qui est devenu le malade, mais sa maladie n’est pas bien grave. Seuls, nous le sommes tous, l’essentiel est de chercher, de trouver un compromis pour supporter cette condition. »

Plus que par l’intrigue, fort mince, le film est remarquable par sa plongée dans des milieux bien particuliers du Londres de 1970 : les drogués, la bohème artistique, la bourgeoisie la plus compassée... On constate alors que John Schlesinger est dans la droite ligne de la prestigieuse école du documentaire anglais qui doit tant à Robert Flahertie et qui a donné David Lean, John Grieson, Pat Jackson, Thorold Dickinson qui ont engendré le free cinéma des Tony Richardson, Richard Lester, Clive Donner dont John Schlesinger est l’héritier direct. Avant d’être un raconteur d’histoire, il est un observateur des mœurs et cela dès son premier film Terminus, un documentaire sur la gare de Waterloo à Londres qui lui valut un Lion d'Or à Venise en 1961, et plus encore avec Billy Laird qui racontait la découverte de Londres par un jeune provincial. Lorsque le réalisateur présente Un Dimanche comme les autres, il est auréolé de l’immense succès remporté l’année précédente par son Macadam Cowboy pour lequel il remporta trois Oscars, celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure adaptation. Il lui aura fallu aller aux USA pour instiller l’homosexualité dans un de ses films. Elle sera aussi présente, mais plus discrète dans Marathon man.
À son talent de cinéaste, Schlesinger ajoute celui de découvreur de talents ; Daniel Day-Lewis, âgé de treize ans fait sa première apparition à l’écran dans Un Dimanche comme les autres, c’est le garçon dont on célèbre la bar-mitsva. Julie Christie, Alan Bates, Tom Courtenay, Rita Tushingham lui doivent beaucoup, sans oublier Terence Stamp qui aurait sans doute été plus convaincant que Murray Head dans le rôle de Bob, l’objet de tous les désirs qui, en outre, parait un peu trop âgé pour incarner la légèreté de la jeunesse.

Le seul (peut-être) point faible du film est que nous avons un peu de mal à nous convaincre que Murray Head puisse provoquer une telle passion chez un homme et une femme de cette qualité, qu’il bouleverse la vie de l’un et de l’autre. Mais ne nous sommes nous jamais dit que l’objet de notre amour ne nous méritait pas ? Ainsi l’histoire d’amour passe au second plan derrière la subtile peinture de mœurs même si nous voyons bien que c’est pour échapper à la pesanteur de l’establishment que Alex et Dany s’entichent de ce médiocre gigolo.
Mais Bob est-il ce médiocre gigolo ? Se vit-il ainsi ? Ses velléités artistiques sont-elles sincères ou sont-elles des leurres pour se mentir comme pour mentir à ceux qui l’aiment ? Le film ne répond pas à ces questions et laisse le spectateur libre de son intime conviction. À la fin, il semble que Daniel, apaisé, se soit convaincu que la beauté de son amour résidait dans le pari qu’il avait fait sur le jeune homme. À ce moment, le film est aussi audacieux dans la forme que dans le fond puisque c’est en regardant la caméra que Daniel exprime la leçon de vie qu’il tire de cette aventure : « Les gens me disent : il ne t’a jamais rendu heureux. Moi je leur dit : mais je suis heureux. Excepté qu’il me manque. Toute ma vie j’ai cherché quelqu’un de courageux et de débrouillard. Il n’était pas ce quelqu’un. Mais il a quelque chose. Nous avions quelque chose. »
Peut-être plus que l’amour, le sujet profond du film est la solitude, la solitude des dimanches anglais d’alors. Bob, lui est à l’âge d’être hors dimanche. Pour lui cette solitude est une fête. Il est la disponibilité même, allant de Daniel à Alex, sans mensonge, en donnant ce qu’il appelle l’amour. Il donne ce qu’il peut donner, bien trop peu, par rapport à ce que Daniel et Alex espèrent...
L’intelligence du cinéaste est d’avoir réussi à personnifier cette solitude par le téléphone en en faisant un personnage à part entière, à la fois technologique mais surtout humain par l’intermédiaire de la standardiste (Bessie Love) des abonnés absents.
Le film nous suggère que la solitude serait le prix à payer pour la lucidité, pour la vérité... Pourtant Daniel dit : « Tout est préférable à l’absence d’amour. » Mais de quel amour parle-t-il ?
Schlesinger a l’art de nous en dire beaucoup par le seul truchement de l’image, comme dans cette scène où un prostitué arrête la voiture du docteur, bloquée à un feu rouge, la gêne de celui-ci, son geste impatient pour le faire monter quand l’arrivée d’un policeman risque de provoquer un scandale, son lâche soulagement quand il constate que le garçon s’est enfui... Nous en apprenons ainsi plus sur la psychologie de Dany et sur la société anglaise que par bien des dialogues.
Un Dimanche comme les autres est un film qui supporte de nombreuses visions sans en perdre complètement ses mystères comme celui, par exemple, de son titre original l’énigmatique : Bloody Sunday, soit « dimanche sanglant ». Il serait erroné d’y voir une allusion au tristement célèbre dimanche sanglant d’Irlande du nord, celui-ci s’étant déroulé en 1972, un an après la sortie du film. On ne voit pas bien ce qui le rapproche de l’autre célèbre dimanche sanglant de l’histoire celui du 22 janvier 1905 lorsque à Saint-Pétersbourg la troupe ouvrit le feu, faisant de nombreux morts parmi les ouvriers qui manifestaient pacifiquement, marchant vers le Palais d’hiver du tsar Nicolas II pour lui demander des réformes. Sinon qu’il pourrait arriver la même chose en Grande-Bretagne, frappée à ce moment-là par une grave récession économique, présente dans le film par des bulletins d’information de la radio et de la télévision, traitant de ce sujet, que l’on entend plusieurs fois en fond sonore.
Un Dimanche comme les autres est un film extrêmement ouvert qui ne juge pas et encore moins condamne, invitant ses spectateurs à considérer ces trois protagonistes à la recherche du bonheur (empêtrés dans les paradoxes, parfois drôles, parfois déchirants) de leur vie, selon leurs propres critères et leur propre histoire.
C’est l’œuvre la plus personnelle du cinéaste, d’ailleurs c’est ainsi qu’il le considérait. Le personnage de Daniel ressemble beaucoup au réalisateur, comme lui il est juif et homosexuel, comme lui il a une passion pour la musique classique et en particulier l’opéra. La musique de Mozart est très présente dans le film.
Plus de trente-cinq ans après sa sortie, alors que John Schlesinger, décédé en 2003, connaît un immérité purgatoire artistique, ce qui frappe en revoyant Un Dimanche comme les autres c’est que outre sa grande qualité, il n’a rien perdu de sa singularité cinématographique.
Pour plus d’informations :









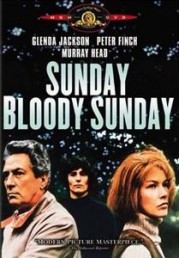





On voit John Schlesinger dans un téléfilm "le langage perdu des grues" tiré du beau roman de David Leavitt.