

05.
Se donner un genre
Philippe Ariño
Philippe Ariño, né en 1980 à Cholet, est professeur d’espagnol en région parisienne, écrivain
(il a publié aux éditions L’Harmattan un essai en quatre tomes sur les liens entre viol et désir homosexuel : www.araigneedudesert.fr),
chroniqueur radio sur Fréquence Paris Plurielle (106.3 FM) à l’émission HomoMicro, et comédien (il a 10 ans de théâtre derrière lui et s'est lancé dans
le one-man-show). Il offre un œil nouveau et étonnamment complet sur la culture homosexuelle.
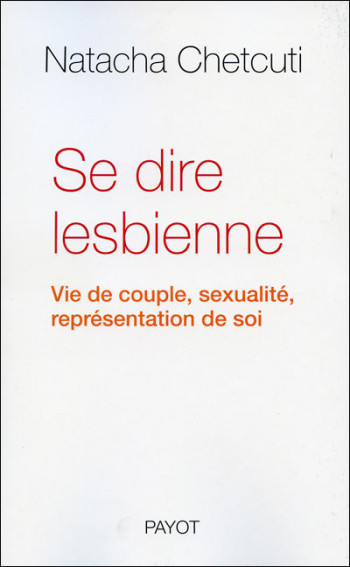
Critique de Se dire lesbienne : Vie de
couple, sexualité, représentation de soi (Éd. Payot, Paris, en librairie le 6 novembre 2010) de Natacha Chetcuti – par Philippe Ariño.
Petite phrase de résumé : L’ouvrage de
Natacha Chetcuti rentre dans le désormais classique sillon des Gender & Gay Studies, où la réalité du sexe est remplacée par le notion plus subjective, poétisante, et floue, de
« genre »… Peu convaincant.
Quand quelqu’un nie sa sexuation, son incarnation et le sens universel de la sexualité, il a tendance à s’inventer
un genre, de préférence indéfini et éclaté, pour se définir lui-même. Oui. En quelque sorte, il se « donne un genre », dans le sens propre du terme. Pas féminin, pas masculin, pas
butch, pas fem… : juste lesbien et antisocial. Du coup, on n’y croit pas (Qui peut croire celui qui se donne un genre comme il se donne un style ?). C’est l’impression
qui se dégage de la lecture de Se dire lesbienne de Natacha Chetcuti. Pourtant, l’auteure semble avoir tout mis en place pour soigner la forme et donner à son ouvrage une légitimité et
une crédibilité scientifique. « L’érudition de Natacha Chetcuti sur les théories du lesbianisme est sans faille » avance Michel Bozon dans la préface. Certes, son travail universitaire semble très propret, scolaire, et bien documenté. Chetcuti
explique clairement les différentes théories féministes, lesbiennes, et queer, du lesbianisme. Elle recadre bien son discours dans un contexte historique connu, et se garde de porter un
regard moralisant sur les différentes interviews qu’elle nous expose. Elle semble connaître parfaitement sa partition. Mais en y regardant de plus près, on s’aperçoit que tout cela n’est
qu’esbroufe. On la voit s’inscrire sagement dans une tradition idéologique queerisante qui sent le réchauffé. On retrouve par exemple les mêmes pirouettes lexicales à rallonge bien
intentionnées (ex : « les personnes LGBTQI »),
les formulations queer fonctionnant comme des slogans publicitaires (ex : le lexique de la « construction » et de la destruction identitaire ; la haine des clichés ; l’emphase sur le « devenir » plus que sur
l’« être » – c. f. le titre du chapitre « Devenir lesbienne » p. 51 – : elle prend modèle sur le « On ne naît pas femme : on le
devient » de Simone de Beauvoir), les sempiternelles références à Pierre Bourdieu et à Eve Sedgwick (alors que des intellectuels plus solides comme Alain Finkielkraut sont jetés aux
lions), toutes ces précautions verbales ronflantes pour prouver une
objectivité universitaire du constat (on a l’impression de lire le jargon intellectualisant d’un Louis-Georges Tin ! : « On constate que… », « étiologie »,
« épistémologique », etc.), les nombreuses tournures passives où le « je » n’est jamais risqué, etc. On reste dans le monde des réactions. Ce livre est presque réductible à un
recueil de témoignages. On nous laisse croire que le vécu va supplanter l’analyse. Au final, nous nous retrouvons uniquement face à une exposition de points de vue, de perceptions de soi, sans
apparente prise de position. Natacha Chetcuti ne dit pas ouvertement et courageusement si elle est d’accord ou non avec ce qu’elle rapporte : elle affiche juste une neutralité sociologique
distancée qui passe pour de la prudence intellectuelle alors qu’elle est un refus de se positionner, une lâcheté. Elle nous fait écouter les rengaines du militantisme homosexuel actuel (la
défense de la – pourtant mythique – « égalité entre femmes et hommes » ; le champ lexical relativiste du « déplacement » et de la « pluralité » ; la traditionnelle confusion entre sexe anatomique et « genre », qui
cantonne la sexualité uniquement sur le terrain de l’apparence ou du comportement).
Au final, avec Se dire lesbienne, on nous enjoint tacitement à applaudir à la désincarnation de la
sexualité, au nom de la lutte contre un « destin anatomique » fantôme, ou bien de la sacrosainte science sociologique : « L’ouvrage de Natacha Chetcuti est avant tout une
contribution remarquable à la sociologie de la sexualité. En sociologue, l’auteure envisage l’ensemble des pratiques et des enjeux matériels de la sexualité : les relations, les
représentations, les actes et les corps, inscrits dans les rapports de genre. Entendue en ce sens, la sexualité apparaît comme un des meilleurs indicateurs de ce qui distingue les lesbiennes des
autres femmes. » Derrière un discours planant sur l’amour, la
diversité, et la force des sentiments, se cache une réalité beaucoup moins rose : une désexualisation généralisée des êtres humains (« les » lesbiennes ne seraient même plus des
femmes…) sous couvert d’identité lesbienne (identité qui reste à prouver). C’est la sexualité – en tant que sexuation, puis ensuite identité et amour – qui est attaquée et gommée
(« Sortir de l’hétérosexualité, est-ce sortir de la catégorie de femme et en quoi ? Natacha Chetcuti donne chair à la fameuse proposition de Monique Wittig. »). On nous présente avec un beau sourire l’absence de prétention politique,
intellectuelle, ou didactique de l’ouvrage (« Il s’agit moins pour l’auteure d’élaborer une théorie politique du lesbianisme que de faire comprendre comment des femmes se mettent en
mouvement et entrent dans un processus de déshétérosexualisation. » L’hétérophobie est affichée sans détour. Le pire, c’est que cette déshétérosexualisation, dans l’idée, est une très bonne chose (s’identifier à
l’homme-objet et à la femme-objet cinématographiques ou de la médecine légale constitue, je le crois, un réel danger et une caricature des relations femme-homme réels, un véritable enjeu
politique) ; mais cet élan de remise en cause du modèle hétérosexuel peut être corrompu si d’une part on confond ensuite ces êtres mythiques hétérosexuels avec l’ensemble des couples
femme-homme réels, et si d’autre part on cherche ensuite à prouver l’authenticité très discutable de l’identité homosexuelle (en l’occurrence lesbienne ici) et de l’amour homosexuel en général
sur la base de l’artificialité de l’hétérosexualité. La déshétérosexualisation est à penser en des termes beaucoup moins particularistes, identitaristes, minoritaires, victimisants, et
poétisants. Ce qui est très gênant dans le cas de Se dire lesbienne, c’est qu’il ne s’agit pas de réfléchir sur l’existence de l’identité lesbienne, mais de nous la faire aimer et de
nous faire croire en son existence sans même la remettre en question. Chetcuti s’attache à nous décrire l’intimité des femmes lesbiennes en s’appuyant sur des « histoires de
vie », et à illustrer dans la relation amoureuse lesbienne
« la place donnée à l’autre ». Cuculand vous propose donc comme d’habitude de jolies « tranches de vie » pour noyer la réflexion sur le désir homosexuel dans
le témoignage « je » et l’émotionnel victimisant, tout cela en appliquant un vernis historique et « sociologique » de surface. Natacha Chetcuti nous parle au cœur : pas à
notre cerveau (« La grande richesse du livre est de prendre pour objet de parcours et des pratiques plutôt que de reprendre des discours généraux et des professions de
foi. »). Le « faire », le particulier, et les
bons sentiments, l’emportent sur l’« être », le désir, et une pensée plus universelle sur le sens de la sexualité.
C’est pourquoi, au niveau du contenu, Se dire lesbienne ne traite pas concrètement des vrais problèmes. Par
exemple, la question du viol en lien avec l’homosexualité est gentiment balayée après avoir été accidentellement esquissée. Natacha Chetcuti s’attache à aborder de fausses problématiques (on
apprend notamment que les catégories butch et fem ne sont pas immuables et intangibles : super novateur comme idée… personne ne l’avait dit avant elle…) pour mettre de côté
des questions plus pertinentes telles que l’identité homosexuelle, le sens et la nature du désir homosexuel, la réflexion et l’articulation entre les sexes femme ou homme, etc.. Elle insiste sans
cesse sur la prétendue « invisibilité du lesbianisme » mais n’explique pas, mis à part dans une dialectique de victimisation, pourquoi il est invisible (peut-être, finalement, par peur de s’avouer son
inconsistance…). Çà et là, on relève beaucoup de raccourcis et d’éléments de misandrie (haine des hommes), que ce soit à l’encontre des hommes dits « hétéros » que des hommes
homos : par exemple, le couple lesbien serait bien plus mâture et solide que le couple gay (« Parmi les femmes en couple, domine un discours de ferme refus de l’extraconjugalité. Le
scénario d’une sexualité récréative, très présent chez les gais, est absent parmi les lesbiennes interrogées par Natacha Chetcuti. »)… On ne doit pas avoir les mêmes références de couples lesbiens, alors… Par ailleurs, Natacha Chetcuti focalise
sur la « masculinité » et la « féminité », sur ce qui « fait en apparences homme » ou « en apparences femme », bref, sur
le paraître, pour s’éloigner des sexes anatomiques et de leur sens. Le sexe devient, à ses yeux, mauvais parce que « social », « culturel » (ne perdons pas de vue que selon la
théorie queer, le sexe ne serait qu’une construction sociale, non une réalité objectivable ni bien sûr positive). Dans le domaine de la sexualité, tout serait social, donc relatif,
mouvant, à construire, déconstruire, transgresser, transcender, inventer. Derrière ce système de pensée apparemment « ouvert » mais éjectant concrètement le symbolisme du Réel, on lit
une haine des corps, des traditions, des héritages, de la société. Natacha Chetcuti ne défend rien (à part la « diversité ») : elle ne fait qu’observer. Par exemple, elle ne se
positionne pas moralement à propos du phénomène de l’infidélité dans les couples lesbiens. Elle se contente de parler des différentes manières de concevoir la fidélité. Elle ne se risque pas
trop : elle reste sur le terrain mouvant, confortable, et fade, de la potentialité : « L’application de la norme dans le couple et la place donnée à la sexualité
peuvent être aussi vécues différemment selon le degré de relations qu’entretiennent les protagonistes avec les instances institutionnelles (famille, maternité, etc.). Sous
l’impact de toutes ces variables, la durée du couple peut s’en trouver modifiée. » Elle balaye scolairement l’éventail des possibles, nous présente ce qu’il y a en magasin, sans orienter plus vers
un choix que vers un autre, sans donner le goût de l’engagement. Elle ne s’aventure pas davantage sur le terrain de la réflexion sur l’identité quand elle décide de ne traiter la sexualité que
sous l’angle des pratiques sexuelles (c. f. le chapitre VI) et de leurs perceptions « intimes ».
Rien que dans le choix du titre – Se dire lesbienne –, on voit que Natacha Chetcuti bascule dans ce qui va
être le principal défaut de son livre : le plaisir narcissique de « se raconter » (même si le micro est toujours laissé démagogiquement aux autres), la focalisation sur le paraître
plus que sur l’être, la prévalence de la subjectivité et de la conscience individuelle sur l’objectivité et la quête de sens universel, la victoire des témoignages sur l’analyse, la mise en avant
de l’imaginaire (« les imaginaires » est le tout dernier mot de son essai : tout un symbole…) au détriment du Réel. Natacha Chetcuti s’attache à « la manière de se percevoir », à la « mise en scène de soi », au « processus d’énonciation ». Elle délaisse la question fondamentale du « Qui suis-je ? » pour lui
préférer celle du « Comment je me dis ? (…après m’être caricaturé et inventé une identité originale et inédite) », du « Comment je me vois et me
définis ? » : « Le terme d’autonomination est à considérer en tant que processus : il ne désigne ni un état, ni une condition des individus, mais bien au contraire
une définition de soi constamment rejouée ou renégociée. »
C’est le genre en tant qu’« allure, présentation de soi, manière d’être dans le corps » qui prime. Nous ne sommes plus dans la recherche de Vérité mais dans le plaisir de se raconter. Il s’agit pour Natacha Chetcuti d’« étudier
les modes d’autodéfinition qui permet de comprendre comment les lesbiennes se pensent et se construisent pour elles-mêmes. » La question de l’identité est transposée dans le domaine du paraître, de la perception de soi, de la subjectivité…
et non de la Nature, du corps, de l’universel, de l’objectivité, du don social positif. Selon l’essayiste, la différence des sexes n’a rien à nous apprendre, par exemple : elle l’envisage
uniquement sous l’angle de la victimisation (« Cette différence sexuelle qui émanerait du corps vient justifier une classification arbitraire qui structure et maintient le rapport
de pouvoir inégalitaire entre les hommes et les femmes. Elle est la base de la société hétérosexuelle. »). L’identité lesbienne serait, aux yeux de Natacha Chetcuti, une « identité marginalisée et
dévalorisée », victime du « système hétérosexiste
dominant », mais elle ne se demande pas pourquoi ni ne remet en cause ce postulat de base. « Ignorées socialement, elles le sont théoriquement. (…) Elles subissent
une ‘double peine’, comme femmes et comme homosexuelles. »
Elle nous met en garde contre les « prescriptions hégémoniques » des normes sur les sexes, sans voir que le « déploiement du genre » tant défendu par les nouveaux prosélytes du « genre sans sexualité » résulte de la même dynamique
hégémonique justement, même si s’il se dit en termes minorisants, inconstants, et est toujours conjugué au pluriel.
En dépit de l’impression d’étude scientifique et journalistique sérieuse que donne la fidèle retranscription des
ressentis, Natacha Chetcuti n’est pas si objective que cela. Elle interprète des propos de manière à prouver toujours un conditionnement, négatif s’il s’oppose à ce qu’elle présente comme LA
Vérité des personnes homosexuelles (à savoir l’identité – plurielle – lesbienne et la force de l’amour lesbien), positif s’il La défend. Il s’agit pour la sociologue de démontrer, par
l’intermédiaire des témoignages, « l’influence de l’oppression de genre sur les femmes ». C’est cela qui est très peu probant dans son essai. Elle semble, mine de rien, avoir une idée très précise du « comment il faut se dire ».
Certes, elle énonce qu’il y a 1001 manières de s’autodéfinir lesbienne, mais l’important pour elle, c’est quand même de se définir lesbienne, de reconnaître son identité « profonde » en
fonction de son orientation sexuelle. Peu importe les modalités finalement. La gêne par rapport à la relation lesbienne est interprétée non comme un problème objectif interne au désir homosexuel
mais comme un dangereux ennemi social à neutraliser ; elle est systématiquement extériorisée sur une soi-disant « création sociétale et culturelles », sur l’hétérosexisme
patriarcal ambiant, sur l’homophobie environnante (qui pourra par la suite s’intérioriser, mais uniquement dans un second mouvement : cette homophobie serait toujours originellement
extérieure aux personnes homosexuelles) : par exemple, si une femme lesbienne n’arrive pas à s’identifier positivement aux femmes lesbiennes, cela résulterait forcément pour Chetcuti
d’« une crainte du stigmate et d’une intériorisation de la dévalorisation des femmes. » Les interprétations de Natacha Chetcuti semblent constamment aller dans le sens d’une défense aveugle du lesbianisme. Mais que met-elle derrière ce
mot ? On ne le saura jamais. C’est embêtant pour un essai qui se propose de creuser à fond le concept…
Dès la préface, on nous vante que « ce livre fera date ». C’est justifié et humble de s’avancer ainsi quand on a les moyens de sa prétention. Mais
très tarte à la crème dans le cas où on a si peu à proposer en magasin… Alors on va se rassurer comme on peut : même s’ils ne font malheureusement pas l’objet d’une véritable analyse (ils
sont plutôt moralisés derrière une présentation sociologique et paraphrastique « parfaite »), tous ces entretiens réalisés par Natacha Chetcuti, dont la sincérité et l’intensité
émotionnelle ne sont pas à remettre en doute, constituent un patrimoine homosexuel très utile et certainement exploitables pour d’autres interprétations plus solides…
Natacha Chetcuti, Se dire lesbienne : Vie de couple, sexualité, représentation de soi, Éd. Payot, Paris, 2010, p. 40.









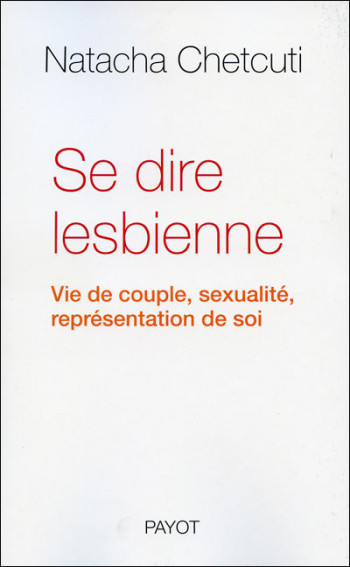

Commentaires