Résumé :
Québec, 1952, un évêque, monseigneur Bilodeau (Marcel Sabourin) est envoyé
dans une prison afin de confesser un ancien camarade de collège, Simon Doucet (Aubert Pallascio), prisonnier et malade. Il a été condamné à perpétuité, il y a quarante ans pour un meurtre. Mais le prisonnier ne se confesse pas. Avec la complicité de ses
codétenus, Simon Doucet parvient à séquestrer l'évêque dans la chapelle, où il l'oblige à regarder une pièce jouée par les prisonniers dans laquelle ils reproduisent des événements vieux
de quarante ans.
Elle lui raconte l'éveil et les premières expériences homosexuelles de
trois adolescents en 1912. Dès qu'il entend les noms des trois garçons: Vallier de Tilly (Danny Gilmore), Jean Bilodeau et Simon Doucet (Jason Cadieux), l'évêque reconnaît sa propre histoire et
comprend que sa vie est en danger. À cette époque, au collège catholique de
Roberval, Simon jouait une pièce évoquant le martyre de Saint-Sébastien dans une représentation scolaire avec son ami Vallier, dont il était éperdument amoureux. Vallier est le fils d'une
excentrique comtesse française (Brent Carver) exilée dans ces lointaines contrées dans l’attente d’une hypothétique restauration de la monarchie dans son pays, seule condition pour qu’ elle puisse daigner y revenir... Bilodeau, qui
essayait vainement de convaincre Simon d'aller au séminaire, était le spectateur jaloux des deux acteurs amoureux. Bilodeau, lui-même amoureux de Simon, brise leur union en provoquant un
incendie qui cause la mort de Vallier. Même s'il se dit innocent, c'est Simon que la justice condamne...
Lilies noue un inextricable réseau d'intrigues, d'alliances, de trahisons et de jalousies, qui mettront à jour un secret vieux de 40 ans.

L’avis de Bernard
Alapetite :
Peu de films nécessitent autant de patience. On met longtemps à se laisser
envoûter par ses superbes images et pour entrer dans la complexité du dispositif narratif, mais rares sont ceux qui offrent une si
belle récompense aux pugnaces et aux patients. Bientôt l’émotion finira par les submerger.
Baroque et bouleversant, romantique et rigoureux, Lilies joue sur
plusieurs registres, et gagne en chacun d'eux. On y trouvera aussi bien une
brûlante histoire d'amour qu’une remarquable métaphore sur la création. Ce qui aurait pu n'être qu'un Roméo et Juliette gay, devient, grâce à l'intelligence du scénario de Bouchard et
à la mise en scène inspirée de John Greyson une histoire, universelle et intemporelle, sur l'amour fou, le prix du secret et l'art de la dissimulation.

Le nœud du drame, la représentation du
Martyre de saint Sébastien nous ramène à l’âge d’or des collèges classiques, où l’on montait régulièrement des pièces du répertoire et
où les rôles de femmes étaient tenus par des garçons. Parabole du film, le Martyre de saint Sébastien métaphorise l’amour. Le scénario, qui passe du récit de prison au drame historique, offre
une structure de mise en abîme : l’évêque est spectateur de sa vie qui est transformée en une pièce de théâtre alors que le
déclenchement du drame qui bouleversa son existence était justement la représentation d’une pièce ; le tout est filmé et vu in
fine par nous, les spectateurs d’aujourd’hui. Cette construction en strates, l'histoire à l'intérieur
d'histoires, du scénario de Michel-Marc Bouchard, dramaturge célèbre au
Québec qui a adapté sa propre pièce Les feluettes , convient parfaitement à la propre démarche du réalisateur, grand amateur de dispositifs gigognes et d’aller et retour entre le
passé et le présent.

Petit aparté linguistique qui me parait indispensable. Le sous-titre du film, Feluette, vient d’une déformation de l’adjectif fluet, aujourd’hui en joual (langue majoritairement parlée au Québec), il a acquis une connotation péjorative pour désigner les homosexuels.
Le film évoque une situation historique peu perceptible pour un non
québécois : la continuité entre le Québec du début du XXe siècle et celui
des années 50, toujours étouffé par l’obscurantisme catholique, alors que le règne de Maurice Duplessis ne soulevait pas encore suffisamment de contestation pour être
renversé.

Pour la première fois avec Lilies, John Greyson ne filmait pas un de ses scénarios. Il a réussi à adapter pour l'écran une
pièce qui reposait davantage sur l'évocation que sur l'illustration, sans pour autant la trahir ou diluer sa charge romantique. Il a décloisonné le huis clos d'origine en le transposant dans un
lieu géographique imaginaire dans lequel des hommes, codétenus du héros, tiennent tous les rôles. Un artifice qui se fait vite oublier pour orienter les spectateurs vers l'essentiel du récit
axé sur les jeux de miroirs et les faux-semblants. Greyson a privilégié les images au symbolisme appuyé, en harmonie avec la photographie aux tons chauds.

Jouant sur le réalisme, le symbolisme et l'onirisme, ce film superbe, qui
allie la magie du cinéma à celle du théâtre, montre à quel point la vérité se cache derrière des masques.
Si l’on veut trouver une filiation cinématographique à
Lilies, c’est dans les œuvres les plus baroques de Fellini comme E la nave va, Amarcord ou Casanova
qu’on la trouvera.
La réalisation très soignée a visiblement bénéficié de gros moyens. Daniel
John, chef opérateur d’un autre très beau film gay, Handing
garden, virtuose du clair-obscur, a du regarder longuement les
œuvres du Caravage avant d’empoigner sa caméra. Il a bien fait, il en reste quelque chose dans ses magnifiques images où néanmoins parfois, il lui arrive de
perdre le point ! D’autres séquences comme celle de la mort de la mère en forêt ou encore celle de la torride scène d’amour entre les
deux garçons dans la baignoire sont directement inspirées de la peinture pré-raphaélite. La photographie possède une beauté visuelle qui donne une profondeur au sentiment de perte, d'espoir et de colère qui anime toute l'œuvre de
Greyson.

Nous sommes continuellement surpris par ces scènes où la toile peinte d’une
représentation de patronage se transforme soudain en un cossu décor victorien tout droit sorti d’un film de James Ivory ou bien en une rue d’un village canadien du début du XXe siècle. L’inventivité du montage fait constamment douter le spectateur de
l’époque qu’il découvre sur l’écran. Le lieu, même, est remis en question par le fait que les acteurs s’expriment en anglais alors que l’action est clairement située chez les canadiens
français, licence habituelle au cinéma mais d’autant plus perturbante cette fois que certains comédiens parlent l’anglais avec un fort accent français.

La direction d'acteurs est irréprochable. Brent Carver campe une
aristocrate déchue avec beaucoup de finesse. Quant aux deux acteurs jouant les adolescents amoureux, non seulement ils sont
bons, comme toute la distribution, mais ils sont aussi sublimes. Pour une fois, de manière pas trop subliminale, on peut admirer les
fesses de Danny Gilmore qui nous offre leur succulent pommé, mis en valeur par la délicate cambrure des reins. L’un des plus beaux fessiers qu’il m’ait été donné de pouvoir admirer au
cinéma !
Greyson convoque également la littérature. On peut voir dans le film une
réminiscence de Genet dans son homo-érotisme élégiaque de la prison. Film
culte dans les pays anglo-saxons Lilies n’a bizarrement jamais été distribué en France. Il a été récompensé par le prix "Génie du meilleur film", "Meilleur film 1997" au Festival du
film international gay et lesbien de San Francisco, et le prix du "meilleur film canadien" au Festival des Films du Monde de
Montréal.

Cette flamboyante adaptation de la pièce Les Feluettes, de Michel-Marc Bouchard, Lilies de John Greyson prouve avec éclat que le théâtre d'auteur a sa place au cinéma.
Les éditions Home screen ont édité un dvd en Belgique avec des sous-titres français mais sans le moindre supplément.
Pour plus
d’informations :







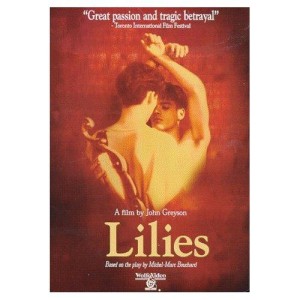
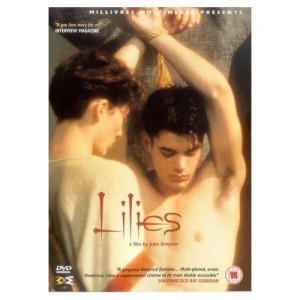









Commentaires