
Fiche technique :
Avec Louis Garrel, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Chiara Mastroianni, Brigitte Roüan, Grégoire Leprince-Ringuet , Jean-Marie Winling, Alice Butaud, Yannick Renier et Esteban Carvajal Alegria. Réalisation : Christophe Honoré. Scénario : Christophe Honoré. Photo : Rémy Chevrin. Musique : Alex Beaupain.
Durée : 100 mn. Actuellement en salles en VF.
Résumé :
Ismael vit avec Julie mais un jour cette dernière, pour pimenter leur relation, fait entrer dans leur lit Alice. S’installe alors un ménage à trois qui pratique ce que l’on appelait naguère « l’amour libre ». Mais Julie s’aperçoit bientôt qu’elle ne trouve pas son compte dans cette nouvelle géographie amoureuse, ce qu’elle confesse lors d’un repas de famille. Mais avant qu’elle prenne une décision sur le devenir de son couple, elle meurt brusquement d’un arrêt cardiaque au sortir d’un concert. Ismael et la famille de Julie parviennent mal à faire face au deuil. Heureusement, dans la vie d’Ismael surgit Erwann qui tombe immédiatement amoureux de lui et qui va le sauver du désespoir.

L’avis de Chori (Lieux Communs) :
Halte ! Ne bougez plus ! Reculez, s'il vous plaît, oui oui circulez, ceci est MON film, mon film à moi, rien qu'à moi... Dire que j'ai hésité l'autre soir, entre Après lui et Les Chansons d’amour (sot que j'étais, mais je ne savais pas, alors...) Les films de Christophe Honoré sont pour moi comme un ascenseur : il y a Louis Garrel presque à chaque étage, et, à chaque fois on monte un peu plus haut que la fois précédente. Là, en ce qui me concerne, j'ai le sentiment que le sommet est atteint. Oui oui je sais c'est vachement prétentieux et tout et tout mais c'est vraiment comme si il avait réalisé ce film-là rien que pour moi.
Je partais quand même avec un sentiment mitigé (une certaine méfiance vis à vis des films chantés, mais contrebalancée par quelques mots encourageants de Malou – genre ça devrait te plaire, mais on en reparlera...), d'autant plus que nous n'étions que trois dans la salle à la séance de 16 heures (grmblll ville de bourrins mais non mais non c'est peut-être l'orage qui les a dissuadés), mais dès le tout début vraiment j'étais plouf ! dedans, et si bien dedans qu'il m'a été un peu difficile à la fin de le quitter (et surtout avec les yeux secs ! si j'avais été une fille, j'aurais eu les joues toutes barbouillées de rimmel... ah bon ? maintenant c'est waterproof ?)
Un générique nocturne et tout en noms communs (pfff il faut qu'il fasse son malin cet Honoré, c'est plus fort que lui, hein ?) et hop c'est parti. Première surprise : tiens mais ils parlent ! Je pensais qu'il n'aurait pas fait les choses à demy, et que ça chanterait tout le temps... Mais non, au début, ils parlent, comme vous et moi. Et quand les chansons arrivent, c'est tout naturellement, sans hiatus. Et je dois dire que j'ai été bluffé par la qualité desdites chansons, et ce dès la première (j'ai commandé la BO aussitôt en sortant, vive le ouaibe !) C'est pop ? rock ? Plutôt ligne claire, en tout cas, ça sonne très juste, naturel. Je le redis (faudrait-il que je vous le chante ?) je n'avais encore jamais entendu de chansons aussi bien intégrées dans un film...
Et de quoi que ça cause, à part ça ? Et bien ça parle des relations entre les gens d'une façon générale et d'amour en particulier. D'amour boum quand votre cœur fait boum et de sexualité il faut bien que le corps exulte aussi. Mais d'une (bi)sexualité comment dirais-je... adolescente, angélique et... rêveuse (?) J'emploie à dessein le mot adolescent, non pour le côté acnéique et mal dans sa peau, mais plutôt pour son approche ludique, funambule, désinvolte... Décomplexée. Insoutenable légèreté et tout ça... Pourquoi rêveuse ? Euh juste parce que je trouvais que « angélique et rêveuse » ça sonnait bien...
Un ménage à trois, une famille, des collègues de travail, un voisin de concert, un couple hétéro, un couple homo... tout ça, ce sont juste des manières différentes d'être ensemble. Des regroupements affectifs. Pour ne pas vivre seul... Sans qu'il soit fait vraiment de hiérarchie morale sur ce qui est bien ou ce qui est mieux. Juste un besoin vital, quoi. Au début, Ismael (Louis Garrel, ce gars-là est énervant tellement il est bien) partage son lit (et sa vie) avec Julie (Ludivine Sagnier) et Alice (Clotilde Hesme). Et c'est assez joyeux, (et joyeusement filmé aussi) d'ailleurs. Première partie : on s'ébat.
Puis quelqu'un va mourir (tiens, encore un film où il est question de cimetière) et la donne affective est donc modifiée, l'équilibre (précaire) chamboulé. Séisme dans le couple, dans la famille, flottements... Deuxième partie : on se débat.
Le temps, justement, de réussir à faire son deuil, de se reconstituer, d'accepter de (re)prendre position (et figure humaine), et d'être capable d'aimer à nouveau, grâce à (oui c'est bien le mot) un genre de séraphin breton. Troisième partie : on combat ?
Ça a l'air théorique et chiant, dit comme ça, mais ça ne l'est pas du tout du tout. La pose dramatique est éludée (on y pleure très peu, finalement), le pathos n'est jamais lourdement surligné, bref sans cesse le film chantonne susurre fredonne (même quand les acteurs ne font que parler), avec peut-être ce genre de légèreté apparente, d'insouciance, qu'affectent les équilibristes. Qui sifflotent, mine de rien. Et se produit ainsi pour le spectateur une osmose empathique, une contamination positive. On m'a parlé de drame musical, de solitude glacée, désolé quand à moi je n'ai vu/entendu qu'une mélodie complice, un gazouillis (oui, parce que gay comme un pinson ?) une ritournelle de galopin dont le dernier couplet se terminerait par les histoires d'amour finissent mal en général mais ici pas vraiment. Et toc !
Oui, je le redis, cette chanson de gestes (et de mémoire aussi) fait un bien fou, peut-être parce que, comme dans les « vraies » chansons d'amour, on s'y retrouve on s'y reconnaît, on y entend des mots faciles des mots fragiles qui font écho, et surtout parce qu'elle est sans cesse tirée vers le positif, du côté de la lumière (alors que c'est un film plutôt nocturne), du côté de l'espoir. Oui, Ismael a beau zébulonner, faire le clown, le marionnettiste, sauver la face, il n'en est pas moins malheureux perdu pendant un certain temps. Parce que ça n'est jamais forcément facile de se donner les moyens d'être heureux. Je n'ai parlé jusqu'ici que de Louis Garrel mais ne vous y méprenez pas, tous les autres autour sont au diapason, à l'unisson (pour rester dans les métaphores choralesques) et tous chantent avec leur vraie voix et on a vraiment envie d'applaudir toutes ces belles âmes qui papillonnent de concert. Ludivine Sagnier, hyper parapluies de cherbouresque, Chiara Mastroianni retrouvée avec un immense plaisir, impériale, et le tit mimi Grégoire Leprince-Ringuet (le séraphin que j'évoquais plus haut), celui par qui l'amour (qui est un enfant de bohème) arrive (sur la pointe des pieds, la première fois on ne verra de lui que ses mollets velus) et qui va en faire fondre plus d'un(e).
Car ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ainsi représentée une relation entre deux mecs (donc homosexuelle) vécue aussi simplement, égalitairement, tendrement. Normalement devrais-je dire (devrait-on TOUJOURS dire). Et ce final de comédie musicale avec son duo d'amour sur le balcon me terrasse (!) complètement. « Il va falloir dire je t'aime... ». Et ce qui n'était qu'une scène banale (quoi de plus normal que deux mecs qui se chantent qu'ils s'aiment sur un rebord de fenêtre ?) se transfigure, grâce à un travelling arrière et le rond de lumière d'un coup de projo hollywoodien, en sublime moment de cinéma. Je vous jure, j'ai failli rester assis pour assister à la séance suivante. Je sais bien pourquoi Malou m'a dit que ça devrait me plaire...



L’avis de Matoo :
Christophe Honoré est un putain de bon réalisateur, et il le prouve encore dans ce film. Car non seulement il sert une très fine et remarquable comédie musicale, mais en plus il affirme encore ses talents de cinéaste, avec une photo superbe, des plans (des visages, des corps, des « liens » entres gens) et des mouvements de caméras très expressifs.
Autre chose aussi, comme dans Dans Paris, il choisit de montrer le « vrai » Paris, pas celui des cartes postales et des grands monuments, pas celui des rues proprettes et ensoleillées. Non là, il n’est plus dans le 15e arrondissement, mais dans le 10e et le 11e (Et comme certains l’ont remarqué, MA grisette est même au générique, yeaaaah !), donc j’ai été encore plus sensible à sa manière de saisir ces quartiers qui me sont si familiers, et c’est une sacrée réussite.
Par contre, il faut se rendre à l’évidence, et je n’attendais pas vraiment autre chose de sa part, c’est un film de bobo avec un scénario bobo et des personnages bobos, dans des quartiers bobos. Si à la base, c’est un truc qu’on ne peut pas supporter, autant ne pas se forcer à le regarder. Mais en se distanciant un peu de cela, on peut pleinement profiter d’une belle histoire, servie par une poignée de chansons de très bonne qualité, et surtout des interprètes, comédiens, comédiennes qui relèvent le défi avec brio.
Il y a trois parties dans cette comédie musicale, qui sent bon l’hommage à Jacques Demy, et c’est l’histoire (d’amour) d’un couple un peu atypique : Ismael (Louis Garrel) et Julie (Ludivine Sagnier). On comprend rapidement dans la première partie que les deux héros pimentent leur relation amoureuse, en y incluant Alice, qui travaille avec Ismael. Julie aime beaucoup Alice, mais Ismael commence sérieusement à prendre ombrage de ce trio. Et là, arrive un drame : Julie décède d’une crise cardiaque brutale et inattendue. Ismael gère alors son deuil, entre la famille de Julie qui tente de le soutenir, et une confusion des sentiments et d’orientation sexuelle qui prennent la forme d’un croquignolet lycéen breton (Grégoire Leprince-Ringuet, dont je me demande s’il est de la famille du scientifique).
Et au milieu de tout cela, des chansons, à la manière d’On connaît la chanson qui illustrent certaines parties du film, et sont plus comme des dialogues chantés (vraiment à la manière de Demy). L’histoire prend justement un tour un peu moins niais que dans une comédie musicale (bobo), ou bien dans un « film français », par ce décès de Ludivine Sagnier, qui représente une rupture d’une brutalité assez inattendue dans la narration. Et on peut apprécier encore plus le jeu et l’aura de Louis Garrel, que j’aime décidément beaucoup.
Christophe Honoré, en tout cas, ne rechigne pas sur l’expression d’une liberté sexuelle tout à fait assumée, que ce soit les couples libres, les relations homos et la valse des choix qui s’offre à des gens ouverts d’esprit. En cela, le film est très rafraîchissant, et il ose avec beaucoup de candeur et d’espièglerie, et pas d’artifices ou de symbolique surpondérée comme chez Ozon. Il nous rajoute même deux petits marins, avec pompons règlementaires, véritable vision de « Pierre & Gilles » qui tombe comme ça en plein milieu d’un plan de rue banal.
C’est un film vraiment agréable à voir, et qui a le mérite de montrer Paris, tel qu’elle est vraiment. Il s’agit surtout d’une comédie musicale réussie tant pour son histoire (d’amour pour midinettes romanticôôônnes que nous sommes), que ses chansons, et avec en plus un souffle moderne indéniable dans son propos.

Pour plus d’informations :
Lire la fiche n°1









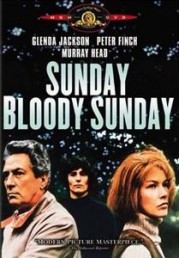




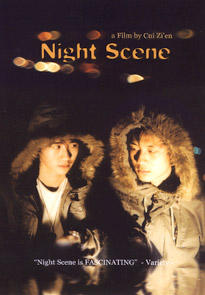
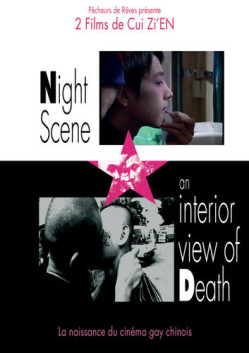


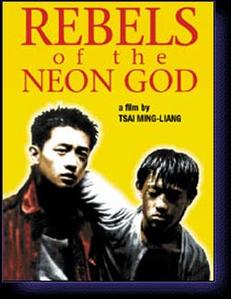

















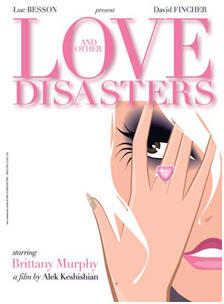




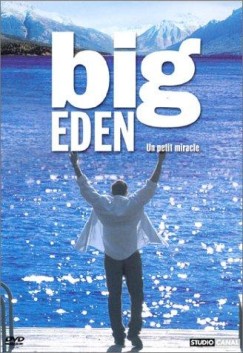
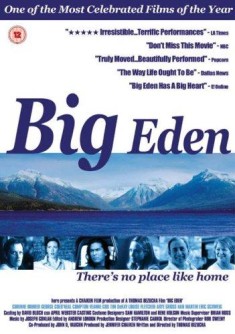
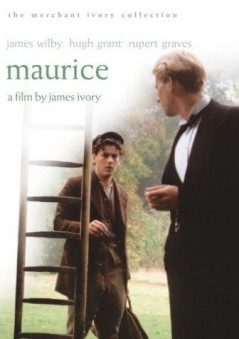

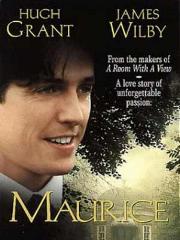





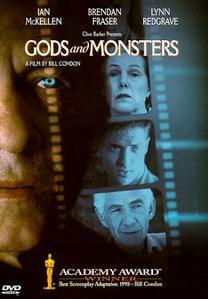

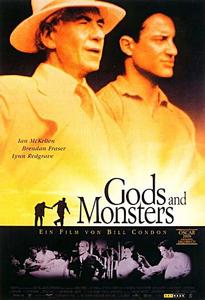





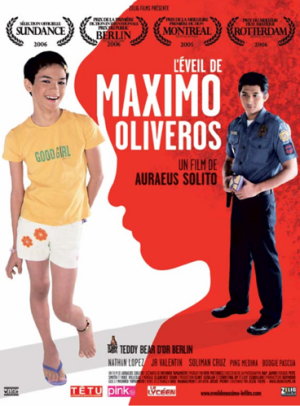 Fiche technique :
Fiche technique :


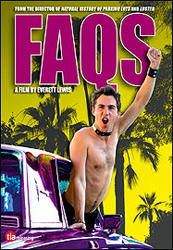

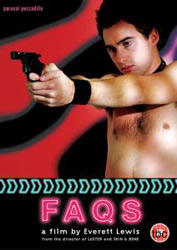




Commentaires