
Fiche technique :
Avec Lionel Baier, Natacha Koutchoumov, Alicja Bachleda-Curus, Stéphane Rentznik, Bernabé
Rico, Luc Andrié, Anne-Lise Tobagi, Lech Dyblik et Michal Rudnicki. Réalisation : Lionel Baier. Scénario : Lionel Baier. Directeur de la photographie : Séverine Barde.
Compositeur : Maurice Ravel. Interprète : Dominique Dalcan.
Durée : 112 mn. Actuellement en salles.
Résumé :
Un couple s’enfonce dans la nuit au volant d’une voiture «empruntée» à la Radio Suisse, comme des voleurs.
C’est Lucie et son frère Lionel, enfants d’un pasteur vaudois, et potentiellement descendants directs d’une famille polonaise. Mais rien n’est moins sûr. Ce qui est sûr, c’est la course-poursuite
en Slovaquie, les usines désaffectées de Silésie, la voiture volée, le mariage blanc, l’étudiant de Cracovie, les faux passeports, les vrais ennuis, la route pour Varsovie, l’aventure, enfin. Et
quelque part en Pologne un cheval qui se noie, nuit après nuit.

L’avis de Arnaud Hée du site Critikat.com :
Comme des voleurs (à l’Est) est le premier volet d’une tétralogie consacrée aux quatre points cardinaux et à l’Europe, elle s’avère aussi
prometteuse que le jeune réalisateur suisse qui l’entreprend. Omniprésent mais essentiellement hors champ dans son précédent film (Garçon stupide), Lionel Baier endosse cette
fois sans complexe l’habit du cinéaste-acteur-personnage et embarque le spectateur dans une aventure où l’emboîtement complexe des identités et la difficile construction des individus se mêlent
aux relations entre un frère et une sœur.

Première des nombreuses bonnes nouvelles, Comme des voleurs (à l’Est), histoire d’identités individuelles, collectives et familiales, ne se présente pas sous la forme d’un pensum
moralisateur ou plombant. Il s’agit plutôt d’un réjouissant et fantaisiste jeu de piste, finement écrit et interprété par des acteurs dont l’adhésion au projet et au propos crève joyeusement les
yeux. Le dispositif de mise en scène est ici moins sophistiqué que dans Garçon stupide. Dans ce dernier, Lionel Baier se maintenait, dans la scène
finale mise à part, hors champ, à la fois partie prenante de l’histoire et sorte d’interviewer distancié. Il se recentre ici sur un récit qui s’apparente à une aventure tout à fait assumée. Et la
présence de réalisateur en tant qu’acteur et personnage (son homonyme) à l’écran dicte ici, en quelque sorte, la mise en scène. De ces choix, il résulte un alliage de simplicité et de spontanéité
maîtrisées au service de la précision, de l’efficacité et de beaux moments de comédie, rares si rares sur les écrans.

Lionel, 30 ans, journaliste lunaire à la radio suisse romande, est bouleversé d’apprendre qu’une partie de sa famille est originaire de Pologne. Il se lance alors, entraînant en même temps qu’il
est entraîné par sa sœur Lucie, à la poursuite trépidante de son identité. Ce mouvement centrifuge travaillait déjà le film précédent, mais il est ici encore plus affirmé, et surtout le
décentrement géographique se réalise. Cette quête se fait sous le patronage de L ‘Or de l’écrivain franco-suisse Blaise Cendras que le personnage a toujours sous la main et qui se
termine ainsi : « Qui veut de l’or ? Qui veut de l’or ? ». Lionel bien sûr. Ce dernier vit la chose par le fantasme et l’imaginaire, notamment par l’intermédiaire de cet
ouvrage. Sa soeur Lucie, plus pragmatique, n’a de cesse de le tirer en dehors de ce rapport fictionnel au réel.
Un peu à la manière de poupées russes, le cinéaste organise une sorte d’emboîtement des identités. D’abord celle de Lionel Baier-personnage et de Lionel Baier-cinéaste, mais aussi celles de sa
sœur, de sa famille, de la Suisse et de l’Europe. Aimant « qu’un personnage soit la rencontre de deux entités : une créature fictionnelle et un être bien réel », c’est avec un
culot certain que le jeune réalisateur endosse ce statut de cinéaste-acteur-personnage. Mais la remarque vaut pour les autres personnages qu’il parvient à faire exister à l’écran. Outre le
patronyme du héros, la dimension autobiographique pointe puisqu’il faut souligner la ténuité du lien de parenté entre le personnage et le cinéaste qui partagent un grand-père polonais et le fait
d’être le fils d’un pasteur. Lionel Baier fait de cette permanente ambiguïté un jeu de piste, n’excluant pas le spectateur, au contraire le conviant toujours habilement et généreusement, laissant
à celui-ci le soin et la possibilité de déambuler dans les tours et détours de la fiction.

Cette découverte de ses origines polonaises est pour Lionel l’occasion de se réinventer une identité. Épousant la Pologne, il s’invente littéralement, devient autre : du point de vue
vestimentaire et linguistique, aussi en supporter de l’équipe nationale. Mais surtout, surprenant son monde, un nouveau genre sexuel s’impose à lui : il annonce son « mariage d’amour
arrangé » avec Ewa, belle et jeune fille au pair, travailleuse clandestine exploitée. Autour de ces questions, Lionel Baier flirte avec un joyeux politiquement incorrect lorsque son
personnage joue avec les pires clichés nationaux (fameux couple de hooligans slovaques !) ou interroge son entourage quant à son type physique : une forme des yeux et du crâne qui
feraient de lui un slave. Aussi, à mesure que son personnage et le film s’éloignent de la Suisse, il est aussi évident que le propos s’en rapproche. D’où ce double mouvement, à la fois centrifuge
(le départ) et centripète, qui traverse le film. Notamment une dénonciation, subtile car jamais formulée en tant que telle, du raidissement identitaire helvète qui a résonné dans les urnes en
octobre dernier. Le paradis helvète reçoit ainsi quelques coups de griffe bien sentis : lorsque Lionel demande à ses parents s’ils ont bien des origines polonaises, on lui répond qu’il vient
du canton de Vaud...
Comme des voleurs (à l’Est), par le biais de ces jeunes adultes que sont Lionel et Lucie, est aussi une superbe évocation du rapport entre un frère
et une soeur. Au tiers du film, le réalisateur se recentre sur cette relation qui prend la forme d’une échappé belle façon road-movie à travers l’Europe centrale avant d’aboutir en Pologne.
L’hétérosexualité « retrouvée » et le mariage à venir arrangent les parents, tout heureux de ce retour à la norme du fiston. Lionel Baier prolonge ainsi sa réflexion sur ce thème,
n’oublions pas que papa est pasteur et que l’on se trouve en Suisse. Seule Lucie, dont le couple est en échec, y voit une sorte de trahison matinée de jalousie. Troubles et ambigus sentiments
fraternels. C’est en tous les cas à ce moment que se produit le pétaradant départ, en contrebandiers de l’identité plus qu’en voleurs. Cette échappée entre frère et sœur est l’occasion, peut-être
la dernière, d’écrire, enfin, sa propre histoire et de s’inventer un futur. Les personnages saisissent cette chance au vol, celle d’être à part entière. Dans le roman de Blaise Cendrars, Johann
August Suter, dans un premier temps richissime pionnier américain, vit une chute tragique. Au terme de Comme des voleurs (à l’Est), c’est plutôt Lucie qui fait fortune. Mais Lionel,
dépouillé de tout, notamment de ses illusions, n’est pas perdant pour autant.

L’interview de Lionel Baier par Arnaud Hée :
A l’occasion de la sortie de Comme des voleurs (à l’est)
À 32 ans le lausannois Lionel Baier n’a pas perdu de temps. Après La Parade (2001) et Garçon stupide (2004), son troisième long métrage, Comme des
voleurs (à l’Est), sort en France le 5 décembre 2007. Il est également chef du Département cinéma de l’École Cantonnale d’Art de Lausanne depuis 2002. Une rencontre avec Lionel Baier est
l’occasion de saisir toute l’acuité d’un regard sur son propre travail de réalisateur, mais aussi sur le cinéma, la Suisse et le monde.

Vous dites aimer qu’un personnage soit la rencontre d’une créature fictionnelle et d’un être bien réel. Or, après votre omniprésence, mais essentiellement hors champ dans Garçon stupide,
dans Comme des voleurs (à l’Est) vous endossez complètement l’habit du réalisateur-acteur-personnage, ce dernier s’appelle Lionel Baier. Comment ce statut s’est-il imposé à
vous ?
Il était présent dès l’écriture avec Marina de Van, coscénariste, en sachant que j’allais le jouer. Les
situations ont été millimétrées pour que je puisse les faire. La narration a donc été pensée et organisée en le sachant. Le fait que le personnage principal porte mon nom, et que ce soit moi qui
l’incarne, permet d’aller beaucoup plus vite sur des éléments fictionnels habituels. Notamment d’apprendre que je suis polonais, ce qui dans un film normal, avec un autre acteur, demanderait à
être justifié : pourquoi maintenant ? Comment cela se fait que cela lui ait été caché ? Le fait que ce soit moi et en mon nom donne une sorte de vérité documentaire : le
spectateur adhère plus vite et plus facilement à cette idée. Si je prends la scène de discussion entre Lionel et son ami : est-ce que je ressemble à un Polonais ou pas ? Est-ce que j’ai
une tête de polonais ou pas ? Cette séquence fonctionne parce que c’est moi qui suis à l’image et non un acteur qui aurait été choisi parce qu’il ressemblerait à un Polonais. Ce qui
m’amusait et m’intéressait, c’est que la limite ou le vertige entre la réalité et la fiction soit poussée encore un peu plus loin, tout ça devient encore un peu plus opaque. Étonnamment, je crois
que ça aide la fiction à exister, ce que lui permet d’aller plus vite que si on devait créer complètement un personnage qui m’était extrêmement différent.
Y a t il des références cinématographiques en la matière qui auraient pu vous mettre sur cette
voie ?
La personne dont je me sens le plus proche sans qu’il y ait une volonté d’imitation, de pastiche ou autre,
est peut-être Nanni Moretti, même si dans la plupart de ses films son personnage se nomme Michele Apicella. Mais dans Caro Diario et Aprile, il joue son propre rôle et en son
nom. Toutefois, je n’ai pas réfléchi ma présence en ces termes, je ne voulais pas que le personnage soit réalisateur ou ait une profession directement liée au cinéma, imposant alors une mise en
abyme de la création cinématographique. On peut penser aussi à François Truffaut, particulièrement à Ferrand qu’il incarne dans La Nuit Américaine, ce n’est pas lui mais ils se
ressemblent par certains aspects. Le titre, Comme des voleurs, est d’ailleurs tiré de ce film puisque « partir la nuit comme des voleurs » est une phrase qui est prononcée dans le
film-support, Je vous présente Pamela, que Ferrand tourne. C’est un clin d’œil et un hommage à François Truffaut.
Le travail d’écriture est manifestement important dans Garçon stupide et Comme des
voleurs (à l’Est), vous obtenez pourtant une très grande spontanéité dans ce qui est rendu à l’écran. Comment procédez-vous à l’étape du scénario et des dialogues ?
Ce sont deux scénarii un peu atypiques. Quand les acteurs le reçoivent, il n’y a pas les dialogues. C’est
une sorte de grosse bible, comme pour une série de télévision, qui détaille toutes les caractéristiques des personnages, les choses qui leur sont possibles ainsi que celles qui leur sont
interdites. Puis il y a un grand séquencier détaillant les scènes à jouer, avec des indications, les intentions de jeu et de mise en scène. C’est donc là-dessus que l’on se base d’abord. Un jour
ou deux avant de jouer, ils reçoivent le texte cette fois dialogué, mais ne doivent surtout pas l’apprendre par cœur. On le lit ensemble, puis on le répète plusieurs fois, texte en main, jusqu’à
ce que certaines phrases disparaissent et que d’autres soient trouvées. On stabilise alors en se disant qu’on jouera à peu près ça. Souvent je m’empare de beaucoup de choses qui appartiennent aux
acteurs, ça m’intéresse de retravailler les personnages à partir des comédiens que j’ai trouvés et choisis. J’aime beaucoup passer du temps avec eux, faire du sport, aller au restaurant, au
théâtre, pour les entendre parler, afin de mieux savoir ce qu’ils peuvent donner aux personnages et ce que je vais pouvoir leur mettre dans la bouche.

Vous nourrissez donc la fiction de ce rapport ainsi noué dans le réel...
Je m’intéresse à ce qu’ils sont au-delà même de leur métier d’acteur, s’ils ont des passions, des habitudes.
Et souvent ça me donne beaucoup d’idées. Par exemple dans Comme des voleurs, le personnage dont la représentation à l’image est la plus redevable de cette méthode est Stanislaw,
l’étudiant polonais que mon personnage rencontre à son arrivée. Dans le scénario, c’est un personnage beaucoup plus baroque, un type qui écoute de l’électro, qui va dans des raves au fond de
mines désaffectées. Et en rencontrant l’acteur, un non professionnel, qui allait jouer le rôle, on a vraiment adapté à ce qu’il était : quelqu’un de plus sage, plus retenu, davantage
cinéphile que fêtard.
Votre triple casquette sur ce film a-t-elle compliqué votre action de metteur en scène et de
directeur d’acteur ?
Objectivement, c’était vraiment compliqué. Sur le moment, le plus difficile était de ne pas voir les acteurs
jouer. Si vous êtes bon, si vous êtes sincère dans ce que vous représentez à l’image, on ne voit pas ceux à côté de vous, vous n’avez pas conscience de ce qu’ils sont en train de faire. Il
fallait donc repasser de l’autre côté de la caméra, regarder sur le combo ce qui avait été tourné, pour comprendre ce qu’ils avaient fait et ce que j’avais fait, pour éventuellement retourner et
corriger la scène. Le lendemain, j’essayais de corriger ce qui avait été fait la veille, comme si j’avais constamment une guerre de retard. Cela a peut-être aussi créé de bonnes surprises, des
choses intéressantes qui m’ont échappé et qui sont ensuite réapparues au montage. Je pense qu’il faut faire confiance aux techniciens et aux comédiens qu’on a en face de soi pour pouvoir se
laisser aller à du jeu d’acteur pur pendant les prises. Mais je trouve ça physiquement fatigant, plus que mentalement. J’étais crevé, vraiment, avec l’impression de faire deux journées à la fois.
Mais je l’ai cherché...
Est-ce que cela a modifié votre rapport à la mise en scène ? Le dispositif de mise en scène de
Garçon stupide s’avère plus complexe que celui de Comme des voleurs, l’ancrage documentaire encore présent dans le précédent s’estompe...
Oui et non. Je vois très bien ce que vous voulez dire par rapport à l’absence de combinaisons entre des
éléments dits documentaires et fictionnels. Malgré tout, je pense que Comme des voleurs est plus compliqué pour un réalisateur, car il y a beaucoup de matériel fictionnel, beaucoup
d’interactions entre les personnages. Alors que Garçon stupide était assez simple dans le sens où toutes les relations se jouaient sur un mode binaire : entre Loïc et un autre, que
ce soit le personnage de Marie, moi-même hors champ ou bien un de ses multiples partenaires sexuels. Il s’agissait toujours d’un rapport bilatéral alors qu’ici le rapport est tripartite voire
davantage. C’était donc plus complexe en matière de mise en scène, disons au moins au moment du découpage.

Faut-il y voir le positionnement d’un cinéaste davantage axé sur le récit et l’envie de raconter une histoire tout simplement ou même une aventure, car Comme des voleurs en est une
authentique ?
C’est un film qui est plus traditionnel, qui a une narration plus linéaire. C’est le genre qui le veut,
puisqu’il s’agit d’un road-movie. J’avais envie de cette linéarité assez classique. Le fait que ce soit moins « collage » que dans Garçon stupide est tout à fait assumé.
Après La Salamandre d’Alain Tanner dans Garçon stupide, Comme des voleurs
se fait, en quelque sorte, sous le patronage de L’Or de Blaise Cendrars, ressentez-vous le besoin d’une sorte de parrain, dans les deux cas suisse, dans vos films ?
Tiens c’est vrai... Il y a toutefois dans Comme des voleurs une scène coupée qui contredit cela. Dans un
motel en Allemagne, Lucie et Lionel regardent un extrait de La Troisième génération de Fassbinder, donc un non suisse. On y retrouve d’ailleurs Bulle Ogier. Ce qui m’intéressait dans
Garçon stupide, c’est le fait que quelqu’un de non cinéphile, qui ne soit pas connaisseur des films d’Alain Tanner, puisse avoir accès à ce film alors qu’il est lui-même ouvrier. J’aime
cette espèce de retour d’un produit culturel sur le public. L’ouvrier qu’est Loïc commence à rire car la scène est cocasse (N.B. : il s’agit de l’extraordinaire scène où l’héroïne remplit
mécaniquement des boyaux de chair à saucisses). Mais comme la scène dure, il arrête de rire et se rend compte que c’est son miroir, qu’il s’agit de lui, de sa vie. C’est un moment très émouvant,
que j’aime beaucoup. Dans Comme des voleurs, je pense que ça s’explique par le besoin très fort du personnage principal de s’appuyer sur des éléments littéraires, ce qu’il pense comme
étant la vie. Il dit lui-même à la fin du film qu’il a l’impression d’être dans un roman, alors que sa sœur, plus ancrée dans le réel, l’extirpe de cette attitude. Comme il a une connaissance
livresque de tout et qu’il ne connaît réellement rien, le fait d’avoir recours à l’exotisme de L’Or était intéressant. D’abord par rapport à la vie de Blaise Cendrars lui-même, très
étonnante et romanesque, il change de nom, part en France. Je pense aussi que le rapport à L’Or est lié aussi à mon enfance en Suisse. À l’école, on fait systématiquement lire vers 14 ou
15 ans, quand on est trop jeune, un bouquin de Cendrars, et souvent L’Or. Je ne l’ai pas bien compris quand je l’ai lu, j’ai juste été fasciné par le personnage de Johann August Suter
qui part de Suisse pour faire fortune en Californie, avant de perdre tout son argent. Je me souviens que la prof nous a expliqué, avec un ton un peu menaçant : voilà ce qui arrive à ceux qui
partent, qui s’imaginent, comme atteint de bovarysme, un destin plus grand. Moi j’étais fasciné par cet anti-héros en me disant qu’il avait bien fait d’essayer. Pour moi, c’était l’exemple
inverse de Guillaume Tell, le héros national labellisé : un héros fasciste, réactionnaire, protectionniste, qui est resté pour défendre les siens. Je me suis senti très proche de ce type qui
était parti, abandonnant les siens, essayant de découvrir d’autres choses.
On peut penser, d’une certaine manière, que la trajectoire de votre personnage suit,
sentimentalement et du point de vue de la construction son l’identité, celle de Johann August Suter. D’abord très riche lorsqu’il découvre ses origines polonaises, on le retrouve en quelque sorte
ruiné à son départ de Pologne...
Le livre de Cendrars s’arrête effectivement sur la chute du héros, il meurt sur les marches du Congrès
américain. Le mien a perdu ce qu’il avait gagné et imaginé de la Pologne, mais il obtient une relation sincère avec sa sœur, ce qui est le but caché du film. Mais aussi une nouvelle relation à la
réalité, puisqu’il est sorti d’un savoir livresque pour parvenir à appréhender le réel. Je pense qu’il gagne beaucoup en perdant. Il a fallu qu’il soit dépouillé au sens propre comme au sens
figuré pour regagner quelque chose. C’est un arc assez traditionnel dans le cinéma.
Des dynamiques centrifuges marquent profondément vos personnages, le garçon stupide évoque un assez
vague désir de départ, ce qu’il ne fera pas en recentrant finalement son regard sur son environnement direct. Par contre, ce départ vers d’autres contrées est effectif pour Lionel et Lucie dans
"Comme des voleurs". Pourquoi cette tendance dans votre cinéma ? Qu’est-ce qui la motive ?
Cela est sans doute très lié à un helvétisme dans le sens où si on a un tant soit peu d’ambition... Comment
dire ?... En Suisse, on vit dans un espace qui est incroyablement protégé, sans doute formidable pour élever des enfants ou que sais-je, mais, c’est un peu idiot à dire, mais ce n’est pas
vraiment la vie, ce n’est pas le monde. On le voit avec la situation en Europe, il s’agit d’une île, d’un espace protégé de tout, qui a un repli constant sur des valeurs dites suisses, même si je
ne sais pas ce que ça veut dire. Quand on a 20 ans, on ne peut avoir qu’une envie, c’est d’en partir, de se barrer. Il n’est pas logique que quelqu’un d’intelligent reste dans ce pays toute sa
vie, parce que c’est trop petit, trop confortable. Je pense que ce sentiment est celui du personnage de Lionel, issu d’une famille bourgeoise et qui se pose une question d’enfant gâté :
est-ce que je n’aurais pas envie d’être polonais ? Pour les autres pays, certains en souffrent beaucoup, l’appartenance nationale est une réalité intangible. Ce mouvement est une manière
pour moi de sauver les personnages. Ils ont tout mais se mettent en danger en partant à la rencontre d’un ailleurs. Or partir à la rencontre, c’est un mouvement que la Suisse ne fait pas depuis
longtemps, c’est un pays de repli et qui sert de repli pour plein de personnes. Ce n’est pas du tout ainsi que j’envisage ma vie et ni celle des personnages que je fantasme. Ces derniers ne
peuvent avoir envie que de partir, de bouger. J’aime l’idée du road movie, que les personnages soient toujours dans l’action, en mouvement...Moi même, l’idée de rester plus de 5 ou 6 jours au
même endroit m’angoisse.

Mais, les dynamiques sont aussi centripètes, vous parlez beaucoup dans vos films de ce pays marqué par une identité complexe qu’est la Suisse. Vous semblez très travaillé par votre
pays...
(il hésite)...c’est le mien, celui dans lequel j’ai un passeport, même si je n’ai pas l’impression d’être suisse, je me sens par
contre très lausannois. Chaque fois que je passe un poste frontière, et même à l’intérieur de la Suisse on en passe encore, je sors ma carte d’identité sur laquelle il y a un drapeau à croix
blanche. Et à chaque fois ça m’interroge, parce que j’ai vraiment honte, mais vraiment ! J’aimerais bien pouvoir la cacher, mais je ne sais pas tout à fait pourquoi... Peut être par
réaction. Mon grand père polonais disait que la seule chose qu’il ait fait de bien était de prendre la nationalité suisse, moi ça me terrifie plutôt. Et comme la Suisse est entourée de pays et de
douanes, j’ai un vrai problème... Sur la Suisse elle même, je ne saurais pas dire grand chose sur le pays dans son ensemble... J’aurais de la peine à faire un film sur LA Suisse. Même si le fait
que les personnages soient suisses détermine forcément beaucoup de choses. S’ils étaient parisiens, le rapport à l’étranger, et même à la province, serait très différent. En France, un cinéaste
parisien qui ne tournerait qu’à Paris avec des acteurs et techniciens parisiens sur des thématiques parisiennes, est complètement intégré. C’est d’ailleurs ce que font beaucoup de mes collègues,
mais aussi beaucoup de français dans leur vie de tous les jours, et au fond c’est normal. En étant suisse, c’est impossible de ne pas avoir un rapport à l’étranger, ou alors vous vendez du
macramé dans une boutique au bord de la Nationale, et encore... Le fait de se poser la question de savoir où est-on par rapport aux autres s’impose, elle est presque obligatoire.
Comme des voleurs est aussi l’histoire du rapport d’un frère et d’une sœur, vous êtes visiblement très attaché à l’enfance, une période de
la vie qu’il ne faut pas trahir. Est-ce de la nostalgie ? Est-ce la peur de grandir, d’être adulte ?
Surtout pas, surtout pas, tout l’inverse ! Je suis très pointilleux à ne pas trahir l’enfance pour ne
surtout pas oublier l’horreur que c’était. J’ai pourtant eu des parents aimants, on m’a donné tout ce qu’on pouvait me donner, culture et ouverture sur le monde, mais je pense que c’est une
période d’une violence absolue. On parlait de Truffaut tout à l’heure, c’est le seul, peut être avec Doillon, qui a parlé de cette violence dans des films noirs, très durs et désabusés, comme
Les 400 coups ou L’Argent de poche. Je n’ai donc pas du tout le syndrome de Peter Pan, surtout pas. J’ai l’impression que les rapports frères-sœurs sont monstrueux dans le cadre
de l’enfance. Je me suis battu avec mon frère et ma sœur, je crois comme dans toutes les familles saines, pendant toutes ces années. Avant de les redécouvrir à l’âge adulte et maintenant j’ai une
vraie relation avec eux. Mais jamais j’aurais envie de les revoir enfants et moi de le redevenir. Par contre, il y a des choses à rattraper, réussir son âge adulte, c’est aussi vivre mieux son
enfance.
Vous évoquez dans votre film une peur des « enfants qui pompent les idées comme des moustiques
géants », pourquoi cette peur alors ?
C’est surtout celle du personnage... Même si je peux partager avec lui un certain nombre de choses. Il y a
en effet de la part des enfants en bas âge une sorte d’omniscience qui est assez troublante. Ils semblent comprendre et capter des choses de l’ordre de l’indicible. Je suis très intéressé par ce
qui est de l’ordre de la communication non verbale. L’histoire du cheval dans le film renvoie à cela : le frère et la sœur semblent avoir eu la même idée sans en avoir parler entre eux. J’ai
l’impression que les enfants, les très petits, sont très au courant de tout ça, très éveillés à ce genre de communication. Les enfants m’angoissent assez...
Comme des voleurs ressemble un peu à un jeu de piste, avec ses emboîtements d’identités complexes.
J’aime envisager les films comme des mille-feuilles, sur lesquels il y a plusieurs couches. On peut les
manger d’un coup sans se demander ce qui le compose, ou, au contraire, s’amuser à les détailler en se demandant ce qui fait le glaçage, les différentes strates de crème et de pâte. J’aime quand
ça fonctionne comme ça, quand le film fait des tours et détours, revient en arrière, donne un indice, en retire un autre. Cela permet au spectateur de cheminer à l’intérieur de celui-ci. J’aime
imaginer que le spectateur est intelligent, qu’il va se mettre en relation avec le film, prendre des pistes et pas d’autres. Je déteste le cinéma figé où il n’y a qu’une voie à suivre et à
comprendre, ce qui est d’ailleurs plus le cas du film d’auteur que des films commerciaux...
...où il n’y a pas d’espaces de liberté...
...oui tout à fait, où il n’y a pas de sens multiple. Ou bien un sens multiple tellement évident que cela
lui ôte tout intérêt, et c’est régulièrement le cas du cinéma européen. Alors que le cinéma commercial dominant, notamment américain, par sa complexité industrielle et sa nécessité de plaire au
plus grand nombre, au contraire, stratifie beaucoup plus. On a souvent des niveaux de conscience et de compréhension plus forts et dynamiques que dans un film d’auteur où le type se serait fait
plaisir en le réalisant.

Par rapport à votre documentaire La Parade et Garçon stupide, la question de l’identité sexuelle et de l’homosexualité, toujours présente dans votre dernier film, est toutefois
reléguée au second plan, un sujet parmi d’autres, cela a-t-il une signification particulière ? Est-ce le signe d’une évolution ?
Je n’ai jamais eu l’impression que l’homosexualité soit un thème, pas dans mes films en tous cas. Je pense
que La Parade, un film qui parle de l’organisation d’une gay pride, s’intéresse surtout au militantisme, à propos duquel j’étais plutôt dubitatif. J’avais envie de tester de l’intérieur,
de savoir comment fonctionnait ce militantisme. Garçon stupide non plus, même si évidemment le personnage est homosexuel et se pose la question de son homosexualité. Mais j’ai
l’impression que c’est très transversal à toutes les pratiques sexuelles. Quand on a 18, 19 ou 20 ans, on se demande si on a envie de s’envoyer en l’air avec tout le monde, si on doit coucher
avec quelqu’un avant le mariage, si on croit à la fidélité... C’est une question que tout le monde se pose : qu’est-ce que je fais de mon corps ? Mon prochain film met en scène un
couple hétérosexuel ; sensuellement, il est pourtant le plus proche de ce que je suis. Je n’ai donc pas l’impression que ce soit un thème, mais il se faufile au travers de mes films. Je ne
sais pas s’il s’agit d’une évolution, mais j’aurais de la peine à déterminer, dans un de mes films, une thématique qui ne serait qu’homosexuelle.
Il s’agit donc avant tout d’une réflexion sur la norme...
C’est peut-être ça, sans doute... Suivre la voie de ses parents ou pas, la vraie grande question de
l’homosexualité est celle-là : prendre la décision de ne pas reproduire le modèle. C’est la première dissension qui se vit pour beaucoup de gens, parfois très tôt. Cela permet de réinventer
quelque chose, c’est un peu ce que font les personnages à la fin du film. Ils dessinent leur arbre généalogique pour montrer d’où ils viennent, mais décident que ça commence là. Le passé est
réglé, maintenant j’en invente ce que je veux. C’est un peu lacanien : la réalité objective des faits importe moins que ce que je peux en raconter. J’ai l’impression que l’homosexualité est
un peu la même chose pour le personnage de Lionel.
Vous êtes présent dans de nombreux festivals internationaux, la liste est longue, les choses
semblent donc bien marcher pour vous...
Je dois répondre oui ?! (rires)
Sauf si la réponse est non...
Non, oui oui oui ! Mais au-delà des festivals et de la sortie des films, j’ai la chance de vivre de ce
que j’aime, d’exercer ma passion. Je pense que le premier jour où j’ai fait une image puis reçu un salaire pour elle à la fin du mois, je m’estime le roi du monde. Je trouve que les choses
commencent de là.
Vous avez évoqué un projet en cours, Comme des voleurs est le premier volet d’une
tétralogie, comptez-vous la poursuivre dès maintenant ?
Je suis pour l’instant en train de terminer un film qui ne fait pas partie de cette tétralogie. Un tout
petit film tourné très vite en noir et blanc l’hiver dernier. Il a neigé la semaine dernière en Suisse, on a retourné des choses dont j’avais besoin. Ce film se déroule dans le milieu du
journalisme et reprend la thématique de Bel ami. On suit un journaliste qui parvient à comprendre et à faire connaissance avec la complexité des différentes classes sociales. Et ceci non
par sa plume ou ses qualités intellectuelles, mais plutôt par sa capacité d’intrigue et de séduction.
C’est un long métrage ?
Oui. J’ai fait la caméra comme pour Garçon stupide, il y a très très peu d’acteurs, mais toujours
Natacha Koutchoumov. C’est un tout petit film... J’écris aussi le deuxième volet de la tétralogie. Rien d’aimable (au Sud) se déroule dans le sud de l’Italie, mais n’a rien à voir avec
Comme des voleurs. Ce n’est pas une comédie, il s’avère même plutôt sombre et s’inspire d’un fait divers. Concernant cette tétralogie, l’idée est qu’à travers quatre films qui ne sont
pas joints par des thématiques communes, on arrive à tracer une sorte de cartographie affective des européens entre eux. Je mène cela avec l’idée que l’Europe existe en dehors de l’euro, du
conseil de l’Europe, et on en sait quelque chose en Suisse puisque nous ne faisons part de rien. Je m’intéresse aux liens que les européens ont tissé entre eux et continuent de tisser.
Modestement, je m’attache à faire une sorte d’instantané, au début du XXIe siècle, du continent sur lequel je vis et qui m’est cher.
Propos recueillis par Arnaud Hée, à Paris le 18 novembre 2007.
Un grand merci à Arnaud pour sa gentillesse et son
autorisation.
Pour plus d’informations :







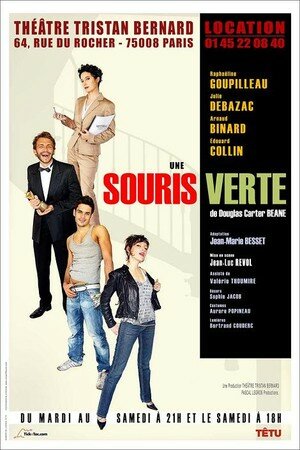


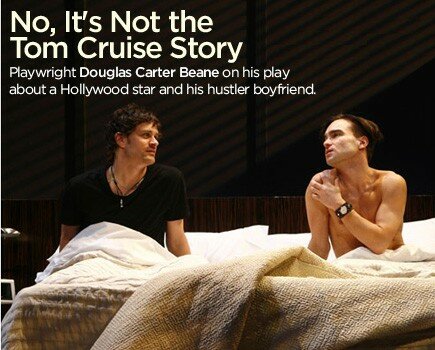
























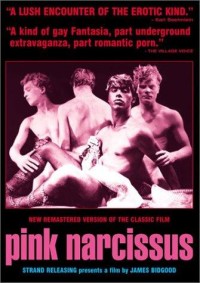
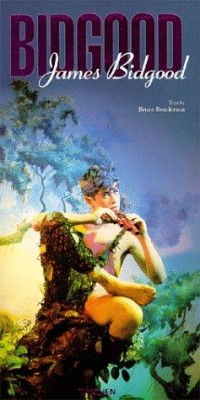














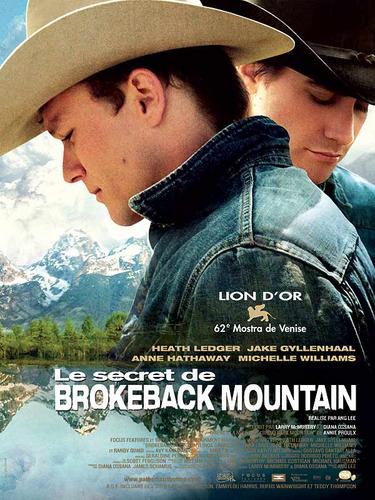





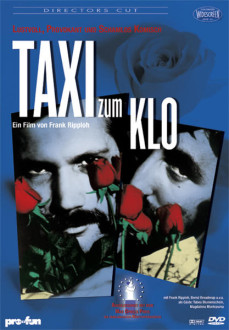

















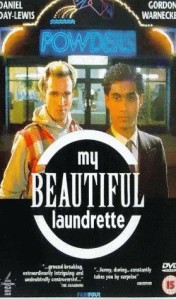
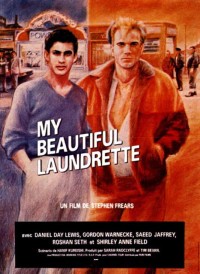
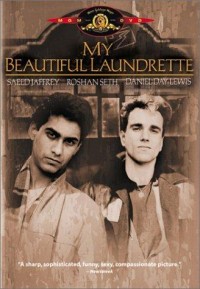

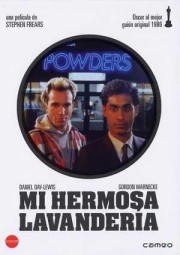

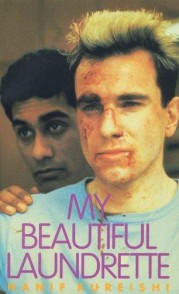




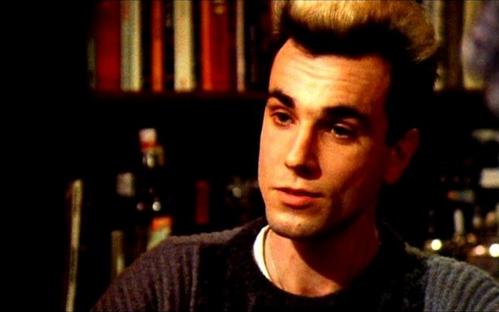














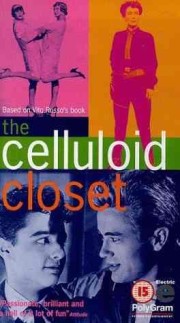
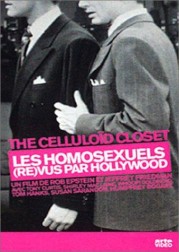
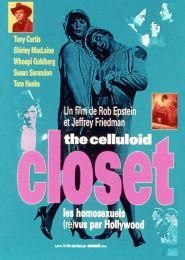
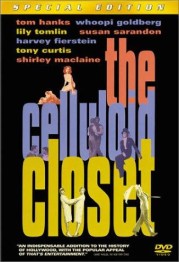
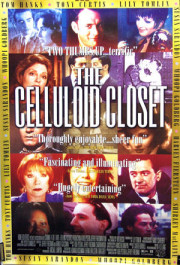
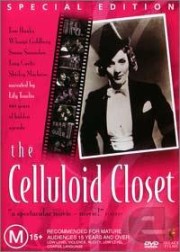
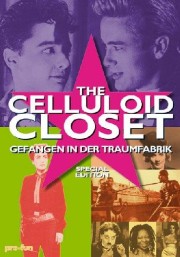










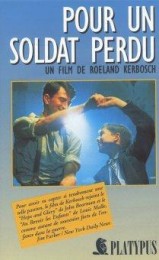





























Commentaires