Fiche technique :
Avec Melvil Poupaud, Valeria Bruni-Tedeschi, Jeanne Moreau, Daniel Duval, Marie Rivière, Christian Sengewald, Louise-Anne Hippeau, Henri de Lorme, Walter Pagano et Ugo Soussan Trabelsi. Réalisé par François Ozon. Scénario : François Ozon. Directeur de la photographie : Jeanne Lapoirie.
Durée : 85 mn. Disponible en VF.
L'avis de Jean Yves :
Suite à un malaise, Romain (Melvil Poupaud), un jeune photographe homo, apprend qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Un médecin lui a annoncé la nouvelle : cancer généralisé. « 5 % de survie et encore, en suivant un traitement. » Traitement refusé par Romain. Le temps qui reste se consacre aux dernières semaines d'un homme condamné par la maladie et s'attache à ces moments où la vie s'échappe de manière inexorable.
Romain n'est pas toujours aimable. Avant de connaître sa maladie, il est même méprisant envers les autres. Après, il se débat avec ses contradictions. Durant tout le film, il reste, tour à tour, irritant et attachant. Il n'a que peu de temps : la mort l'a pris en otage.
Comment réagit-on quand on vous annonce votre mort prochaine ?
Peut-on faire le deuil de sa propre vie ? Et si oui, comment ?
François Ozon a su éviter deux écueils :
– le premier aurait été de raconter l'histoire d'un mec qui en profiterait au maximum à l'image des Nuits fauves (1992) de Cyril Collard.
– le second étant la réconciliation avec toute la famille et tous les amis qui seraient là le jour de sa mort, comme le larmoyant Philadelphia (1993) de Jonathan Demme.
Malgré le caractère détestable de Romain, je me suis attaché à ce jeune homme torturé et malheureux qui va vers quelque chose de plus simple : la scène où il photographie son neveu, à l'insu de sa sœur, est une pure merveille d'émotions retenues.
À un moment de son parcours, Romain se rend chez sa grand-mère paternelle incarnée par Jeanne Moreau. Des petits trucs, comme le fait de prendre des vitamines ou de dormir nue, nourrissent son personnage de façon lumineuse alors même qu'elle n'a pas le rôle principal (elle apparaît dans une seule courte séquence). Quand elle demande à son petit-fils pourquoi elle est la seule personne à connaître sa maladie, Romain lui répond :
« Parce que tu es comme moi, tu vas bientôt mourir. »
Elle, de sourire, et d’ajouter :
« Tu sais Romain, cette nuit, j'aimerais partir avec toi. »
Avant de mourir, Romain va transmettre la vie à travers une serveuse de restaurant (fabuleuse Valeria Bruni-Tedeschi) dont le mari est stérile. J'aurais personnellement supprimé la scène chez le notaire où Romain désigne l'enfant à naître comme son héritier. Je ne comprends pas ce qu'elle apporte et aurait pu rester dans le « hors champ ».
Ce n'est pas la première fois que François Ozon « invite » la mort dans ses films. Sous le sable en 2001 et Le temps qui reste sont des films complémentaires qui représentent les deux faces de la même médaille : celle de la disparition de l'autre.
Avec François Ozon, on comprend que le cinéma peut être autre chose que du divertissement. Le temps qui reste n'a pourtant rien de désespérant.
À la fin du film, réconcilié avec lui-même, il ne reste plus à Romain qu'à s'allonger sur une plage. Poignant et superbe plan final où tout se retire progressivement : les vacanciers, la mer, la vie. Au loin, le soleil plonge dans l'océan. Un homme a vécu. Au moment où Romain part, je me suis dit que je venais de voir un très beau film.
L’avis de Matoo :
Autant j’avais aimé Sous le sable qui pourtant était un film plutôt contemplatif et introspectif, autant je n’ai pas été totalement emballé par celui-ci. Malgré une superbe photo et de bons comédiens, je n’ai pas vraiment aimé l’histoire et n’ai pas accroché aux rapports humains et intimes pourtant habilement mis en exergue. J’y vois pourtant beaucoup de qualités, mais manifestement je n’ai pas eu de déclic.
Le magnifique Melvil Poupaud, magnifié par l’œil d’Ozon qui devait le trouver aussi beau que nous, est un photographe de mode homo, assez connard dans le genre, qui apprend soudainement qu’il va mourir d’une tumeur maligne dans les trois mois. On suit le personnage jusqu’au bout de son existence raccourcie par la maladie, dans son rapport avec sa famille, son petit ami et certaines préoccupations existentielles.
J’ai bien aimé le personnage de Poupaud qui n’est pas le petit pédé lisse et convenu auquel on aurait pu s’attendre, mais une bonne pédale hautaine et une connasse de première avec sa famille et ses relations. De même, ses réactions lorsqu’il apprend son agonie prochaine sont finement interprétées par le comédien, et rendues par les plans d’Ozon. Ce dernier qui filme toujours aussi bien, on retrouve un goût esthétique aussi léché et raffiné. Romain (Melvil Poupaud) vit comme il le peut ses dernières semaines, et tente de trouver une manière de se comporter face à son entourage.
Le film a cette qualité de ne pas tomber dans le pathos, de ne pas jouer les tire-larmes ou la mièvrerie, pour mieux nous entraîner dans cette inextricable fin de parcours. Un cheminement rectiligne et inexorable qu’emprunte Romain avec une sobriété dérangeante et digne à la fois.
Mais les attitudes des parents et du personnage à ses parents, la frangine, la grand-mère (Jeanne Moreau ressemble quand même de plus en plus au docteur Zaïus - lifté - dans la planète des singes !) ou la rencontre inopinée et capillotractée avec Valéria Bruni-Tedeschi ne m’ont vraiment pas convaincu. Je ne sais pas… pas vraiment crédible, trop convenu finalement.
Il reste un film à la réalisation impeccable et à l’image d’une saisissante beauté, mais pas plus que ça. Il me semblait que Sous le sable explorait le deuil avec une pertinence hallucinante et un foisonnement de sentiments et sensations. Et tout cela par un battement de cil ou un regard, une manière de filmer, des petits riens qui font beaucoup. Mais là, je n’ai pas perçu autre chose qu’une description prosaïque et un peu stérile, sans relief. Je ne dis pas que le film est mauvais, mais un peu décevant par rapport à ce que j’attends d’Ozon (dont je suis fan depuis longtemps).
L’avis d’Oli :
Après avoir découpé rétrochronologiquement en cinq parties la période allant du mariage à la rupture, François Ozon s'intéresse à un autre moment de la vie, celui qui démarre à l'instant où on vous annonce que vous souffrez d'un cancer généralisé incurable. L'ambiance sera plus lourde, forcément.
Cette fois, Ozon découpera l'expérience de l'individu en deux étapes se succédant tout en douceur : la rupture, puis la réconciliation. Sous le choc, on n'ose pas en parler, on préfère se fâcher avec les autres, histoire de se détacher lâchement plutôt que d'avoir à affronter une vérité due aux intimes. Mais une fois qu'on est en rupture avec tout le monde, il faut bien se ressaisir, et c'est l'étape de la réconciliation, avec ou sans annonce de la vérité d'ailleurs. On peut continuer à cacher les choses, mais on ne peut pas rester seul. Cette jolie analyse, Ozon [je me rends compte à l'instant de la signification de son nom de famille en allemand... = ozone] l'illustre de façon ozonienne : du gay (même du sexe gay, là !), une musique choisie avec soin (mais pas avec son Philippe Rombi habituel), et une histoire assez dense – même si l'intrigue est chétive – pour qu'on ne s'ennuie pas une seconde et qu'on reste là à suivre l'histoire avec plaisir, avec plus ou moins d'empathie, mais jusqu'au bout. J'ai d'ailleurs trouvé la fin particulièrement réussie.
Matoo me dit que Melvil Poupaud est hétérosexuel. C'est donc une belle performance d'acteur de sa part, je ne sais pas si j'aurais pu en faire autant J. Un sexe en érection à un moment : le sien, ou un faux ? Valéria Bruni-Tedeschi est par contre un peu trop Valéria Bruni-Tedeschi, un peu trop Emmanuelle Devos, un peu trop inapprochable pour qu'on puisse l'apprécier. Jeanne Moreau, pour sa part, magnifique et chaleureuse : son apparition aux côtés de Melvil Poupaud réussit carrément à la scène.
Bref, c'est bien pensé, bien construit, bien filmé, bien accompagné par la musique, bien joué, et ça m'a bien plu. À voir à deux, calmement.
L’avis de Mérovingien02 :
Qu'on le veuille ou non, il existe aujourd'hui un label François Ozon pour définir le cinéma d'auteur français. Est-ce un label de qualité ? Pas forcément. Après une série de courts et de longs métrages assez trash, le cinéaste a opéré un virage plus ou moins bien négocié vers des œuvres plus bourgeoises aussi émouvantes qu'un rien prétentieuses. On aime ou on n'aime pas. Les nouveaux défenseurs du cinéaste ne sont en tout cas pas les mêmes que ceux qui l'ont soutenu à ses débuts. C'est donc sans trop de surprise qu'avec Le Temps qui Passe, Ozon tente de concilier ses pendants trash et l'intellectualisation parisienne pour réconcilier les deux camps.
Hélas, il risque bien ne pas mettre grand monde d'accord puisque le sujet facile est traité sur un mode difficilement accessible qui touche autant qu'il irrite. Confondant parfois le réalisme avec le glauque (la scène à trois) et l'épuration narrative avec l'abstraction psychologique (la volonté d'avoir un enfant arrive comme un cheveu sur la soupe), Ozon mène sa barque avec des hauts et des bas, convainc autant qu'il laisse dubitatif. Sans doute que la volonté de sortir un film par an a entraîné une baisse de rigueur dans l'écriture du scénario... Le réalisateur défini lui-même son nouveau film comme le deuxième volet d'une trilogie basée sur la Mort. Sous le Sable évoquait le deuil, Le Temps qui Reste traite de sa propre mort (le troisième film devrait évoquer la mort d'un enfant).
Romain est un photographe trentenaire qui découvre qu'il a un cancer généralisé et qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. On aurait pu craindre une série d'effusions lacrymales bateau genre « réconcilions-nous avec nos proches avant la fin » mais l'angle choisi met de côté toute notion de pardon aux autres pour se concentrer sur le pardon envers soi-même. C'est là la principale originalité du récit qui ose aller à contre-courant des facilités du mélodrame, au risque toutefois de laisser une partie de la salle sur le carreau. Première couleuvre difficile à avaler : Romain n'est pas un gentil garçon et il est par conséquent bien difficile de s'y attacher. Superficiel, agressif envers sa sœur, aimant ses parents mais refusant de leur parler de sa maladie, parfois cruel lorsqu'il balance sans détour à sa grand-mère qu'elle aussi va bientôt mourir... On aura de cesse de s'interroger sur les raisons de son attitude désagréable et sur ce point, Ozon joue la carte de la suggestion.
Ce n'est certainement pas un hasard si le héros est un photographe de mode. Son rapport au monde est pour le moins frivole et le milieu dans lequel il évolue le fait vivre à 100 à l'heure. On peut donc supposer que les mondanités, les voyages de luxe et les grands magazines l'ont fait baigner dans un univers décadent sans réelle signification (Romain se drogue régulièrement et affirme lui-même que ses photos sont à chier et qu'il a perdu l'innocence de son enfance). François Ozon va donc volontairement placer la photographie au cœur même du parcours du héros. Celui-ci sera présenté lors d'un shooting de deux pin-up observées dans l'œil d'un énorme objectif, métaphore d'un travail encombrant et vide de sens (tout est calculé : les costumes, les coiffures, le cadre). Après avoir appris la mort future, Romain entretiendra un tout autre rapport à la photographie : débarrassé du lourd matériel, il capture la simplicité de la vie à l'aide d'un simple appareil numérique. Il immortalise le temps, le cristallise comme pour le retenir et profite du peu de temps qui lui reste pour trouver une signification à son travail, et par corollaire, à sa vie. C'est lors d'une visite à sa grand-mère, alors qu'il feuillette un album de photos, qu'il aura alors des flashs précis de son passé et d'une époque où tout était simple et beau. Le montage de ce passage voyant défiler des instantanés en gros plans soulignera à la fois la nécessité de revenir au passé pour comprendre ce qui nous a transformé ainsi qu'une recherche de l'enfance perdue à retrouver d'urgence.
Pour appuyer sa démonstration, Ozon intercalera à intervalles réguliers des flashs sur Romain se remémorant le garçon qu'il était. Si cette opposition entre la naissance et la mort est pour le moins cliché, elle mettra en perspective le rapport qu'entretient le personnage principal aux choses comme la foi (un cierge brûlé contre une blague scato), l'innocence (le sempiternel miroir au reflet déformé) ou la mort (la lapin mort retournant à la nature annonçant le final sur la plage). Pour Romain, il y a un évident cheminement intellectuel couplé aux transformations du corps. Dans la première partie du film (la plus réussie), Romain est encore extrêmement beau et la caméra s'attardera volontairement sur son visage angélique et son corps musclé, allant jusqu'à montrer sans honte l'érection précédant la pénétration lors d'une scène de sexe sans chichi (il est rare de voir une relation physique entre deux homme filmée dans toute sa crudité). L'acte sexuel sera alors interrompu par une pulsion de mort révélatrice de la pulsion destructrice qui anime Romain, celui-ci étranglant son petit ami pour exprimer sa colère de mourir. Il ne fait en vérité que s'en prendre à lui-même, n'acceptant pas son destin. Il commencera alors une descente symbolique vers la mort lors d'une superbe séquence de backroom avec la possibilité d'abandonner totalement son corps au plaisir charnel un rien extrême mais aussi libérateur (un fist-fucking suggéré sur fond de musique classique, éliminant toute idée de perversion). C'est un choix que finira par rejeter Romain qui commencera alors un cheminement pour accepter sa situation et qui s'exprimera dans la douleur lors d'un long passage où le personnage errera en slip dans son appartement, vomissant dans les toilettes et se cognant la tête contre un mur.
C'est là que le film s'égare un peu dans une sous intrigue maladroite, avec une histoire de bébé mal introduite car reposant sur une thématique clichée (la vie, c'est mieux que la mort) et une rabâchement accessoire de la volonté de Romain d'être totalement seul (le plan où, après l'amour à 3, le couple s'embrasse en laissant le troisième larron seul). On préfèrera largement la conclusion du film, et plus spécifiquement l'avant-dernier plan qui marque nettement l'anonymat dans lequel a sombré (mais qu'à choisi) Romain, lorsqu'une plage se vide autour d'un corps qui jamais plus ne se relèvera (avec une acceptation du corps malade exposé au grand jour). Une jolie conclusion qui entre en résonance avec celles de Sous le Sable et 5 Fois 2 puisque encore une fois, la plage et la mer acquièrent le statut symbolique de passage vers un ailleurs intemporel.
On pourra reprocher à Ozon de se répéter un peu, ce qui ne serait pas tout à fait faux, Le Temps qui Reste évoquant souvent le court-métrage La Petite Mort dans lequel un jeune homo prenait des photos d'hommes se masturbant ainsi que les dénouements des deux œuvres précitées. De même, l'utilisation du format Scope (une première pour Ozon) ne change pas énormément de choses et le côté téléfilm est toujours prégnant. Pourtant, en dépit d'un léger manque d'inspiration flagrant, le nouveau métrage du réalisateur finit par se révéler attachant, essentiellement grâce à un casting sans fausse note où le méconnu Melvil Poupaud impose un charisme impressionnant en se livrant sans complexe face à l'objectif de la caméra, portant solidement le film sur ses épaules et nous rassurant sur la capacité d'Ozon à filmer des hommes (son cinéma était jusque là essentiellement féminin). Les seconds rôles parviennent quand à eux à s'imposer dans des scènes pas évidentes puisqu'anti-dramatiques et au temps de présence limité, mention spéciale à une Jeanne Moreau se montrant bouleversante en moins de dix minutes et nourrissant son personnage d'elle-même (l'actrice dors vraiment nue et l'idée des médicaments vient également de son goût pour les produits pharmaceutiques).
En dépit d'une approche réaliste du sujet, d'une réalisation sobre et d'un montage sec, Le Temps qui Reste marque à la fois une redite dans la filmographie de François Ozon ainsi qu'une impression de tournant. Le style dépouillé mêle audaces réjouissantes (choix dramatique, sexe brut) et maladresses (les flash-back) mais parvient finalement à créer une œuvre captivante qui regarde la mort en face.
Pour plus d’informations :







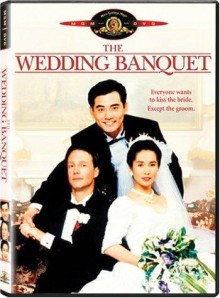
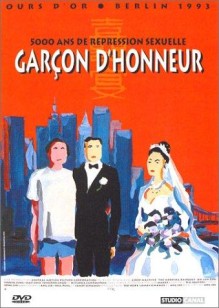
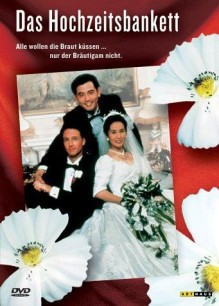
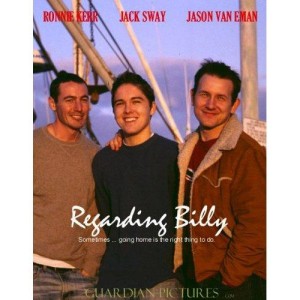
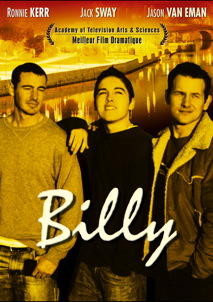

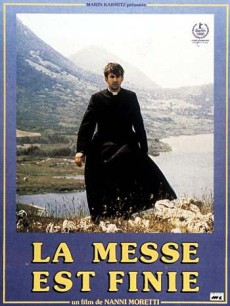
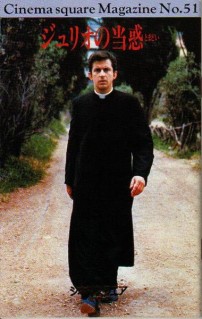



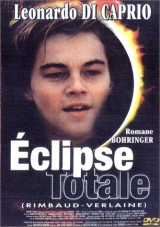


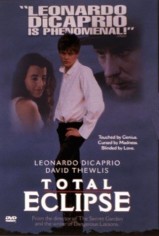

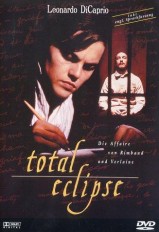
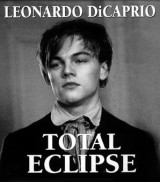

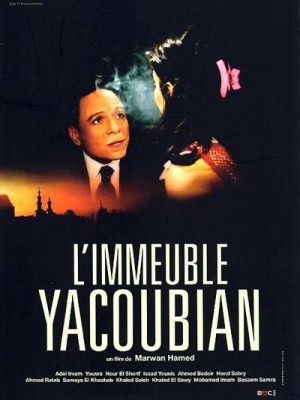

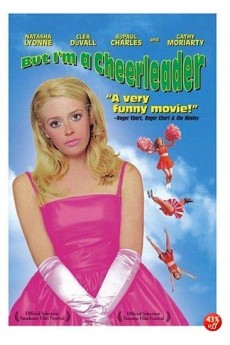
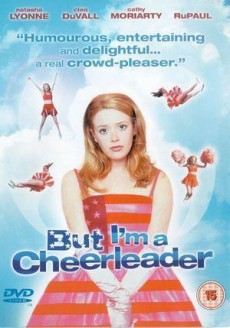
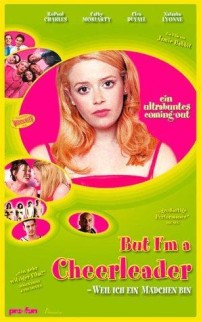




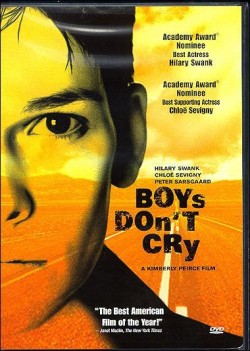
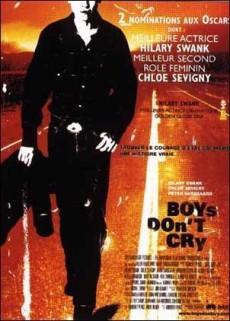
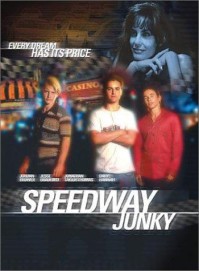
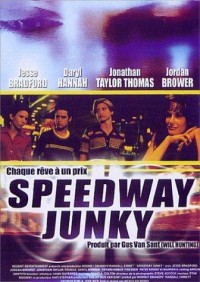
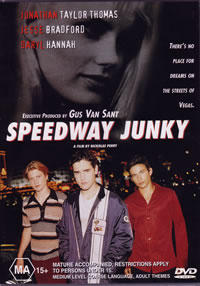

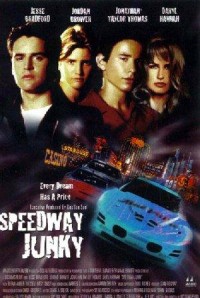
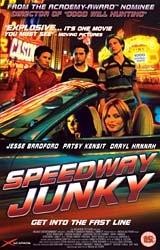

Commentaires