
Résumé :
Space Gays est une compilation de courts-métrages d’horizons variés mais en grande partie francophones, de tous formats, qui se regroupent autour de deux thèmes centraux : la réalité homosexuelle et la Science-Fiction. Récompensés par de nombreux prix, salués par la critique spécialisée et les maîtres du fantastique contemporain comme Clive Barker, ces films, qu'ils soient expérimentaux ou professionnels, ont en commun un humour décapant, un sens inné du "kitch", tout en délivrant des messages contre l’homophobie (Les gays Envahisseurs 2 de Myriam Donnasice), ou même en critiquant certains comportements homosexuels (Suroh, l’E.T. auto-stoppeur de Patrick McGuinn).
L’avis de Samuel Minne (HomoSF) :
Désireux de distribuer un cinéma « queer » indépendant, Rémi Lange propose une collection de courts-métrages qui mêlent science-fiction et homosexualité. L’ensemble se révèle, comme souvent dans les réunions de courts (voir Courts mais gays), inégal, mêlant pépites et déceptions. Ainsi, la SF peut ne servir que de prétexte à une reprise superficielle de clichés qui prétendent à la parodie (« Interstellar Cruise Control », « SPF 2000 »). Mais une connaissance profonde de la SF peut aussi apporter de vrais bijoux (« Split », « Stargay »). De la même manière, l’homosexualité peut recevoir un traitement anecdotique voire largement décevant (« Destination Saturne »), ou plus satisfaisant et même jubilatoire (« Les Gays envahisseurs », « Stargay » à nouveau).
« Les PD dans l’espace » de Rob Clarke (USA, 2005, 2 min.) est un petit clip d’animation réalisé pour internet par un dessinateur facétieux. Il entre tout à fait dans la mouvance hédoniste des comics gays.
« Les Gays envahisseurs » de Myriam Donnasice (France, 2003, 6 min.) milite de façon sympathique, vu le peu de moyens, par le biais de l’ironie. Les thèmes homophobes de l’invasion et de la contamination y sont tournés en dérision, et en musique s’il vous plaît.
« Interstellar Cruise Control 4000 » de Michael Velliquette (USA, 2005, 10 min.), malgré le travail sur les images brouillées et recolorées, ne fait pas oublier le propos xénophobe : l’extermination d’un clone, sous le prétexte de défendre les droits sexuels. C’est peu dire que l’humour tombe à plat.
« SPF 2000 » de Patrick McGuinn (USA, 1997, 11 min.), qui se déroule au bord d’une rivière, montre une scène de drague très amusante, avec une mère involontairement complice. Mais à côté de la fraîcheur et de la justesse du début, l’arrivée de l’extraterrestre apparaît comme plaquée et artificielle. L’extraterrestre qui tente d’entrer en contact revient dans l’autre court du même réalisateur, « Suroh ».
« Split » d’Erik Deutschman (USA, 1997, 12 min.) se place dans la lignée du David Lynch d’Eraserhead. Énigmatique et profondément original, avec une bande son très travaillée et une utilisation de l’image avant-gardiste et pleine de sens, ce court-métrage livre une réflexion sur le corps et les rapports entre extérieur et intérieur assez angoissante, pour ne pas dire éprouvante. « Split » arrive de plus à entrer véritablement dans une problématique gay. On ne peut que souscrire aux louanges de Clive Barker, qui encense ce film fascinant !
« Stargay » de Stephan Deraucroix (1999, 15 min.) est un film français mais il est majoritairement parlé en anglais. Dans une base spatiale isolée, les gays sont ultra-minoritaires. Pertinent et ingénieux, « Stargay » exploite avec intelligence le cadre SF, dont on ne peut extraire l’histoire, tout en rendant transposable la solitude du héros. Et en plus, c’est drôle ! Malgré des moyens limités, une réussite incontestable.
« Destination Saturne » de Carnior (Canada, 2003, 17 min.) fait sourire d’abord, car les feuilletons de SF des années 50 font l’objet d’une parodie savoureuse : filmé en noir et blanc, le court recycle les clichés. Mais l’humour montre vite ses limites, et l’homosexualité, reléguée à l’arrière-plan, est traitée avec indigence.
« Suroh, l’E. T. auto-stoppeur » de Patrick McGuinn (USA, 2000-2005, 33 min.) semble mélanger l’esthétique du porno gay des années 80, le film de SF de série Z et le cinéma underground. Un gay S/M recueille un extra-terrestre qui s’est écrasé sur Terre. L’image est laide, les effets spéciaux artisanaux, et le discours pompeux. Propos et images hétérogènes n’apportent guère plus de crédibilité à cette confrontation de différences. On peut cependant saluer l’entreprise rarement tentée de trouver une sexualité commune entre un humain et un extraterrestre.
On peut regretter la quasi absence de lesbiennes dans ce premier bouquet : seul « Les Gays envahisseurs » les prend en compte… Initiative passionnante, cette collection permet cependant de révéler des courts-métrages souvent talentueux, novateurs ou audacieux. Ils ont le mérite de chercher leur propre langage, et ne peuvent qu’encourager de nouvelles créations. Les homos n’ont pas fini de secouer la SF, et la SF n’a pas fini d’interroger la sexualité…
Pour plus d’informations :
Le site des Films de l’Ange













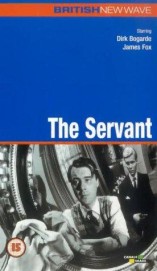
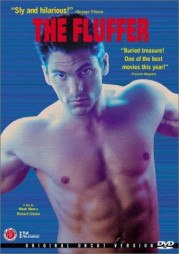
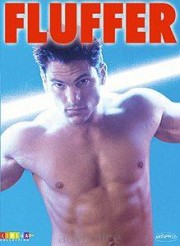

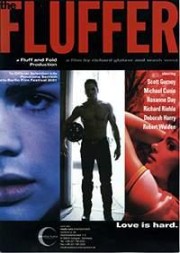
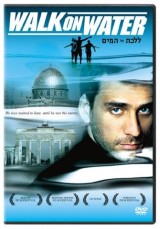

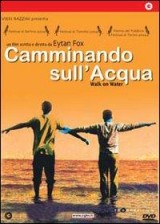

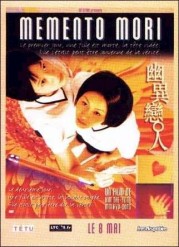


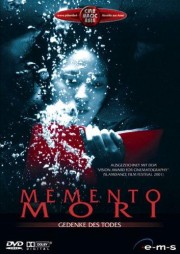
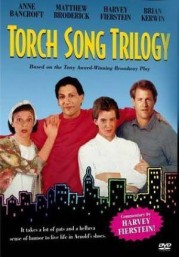



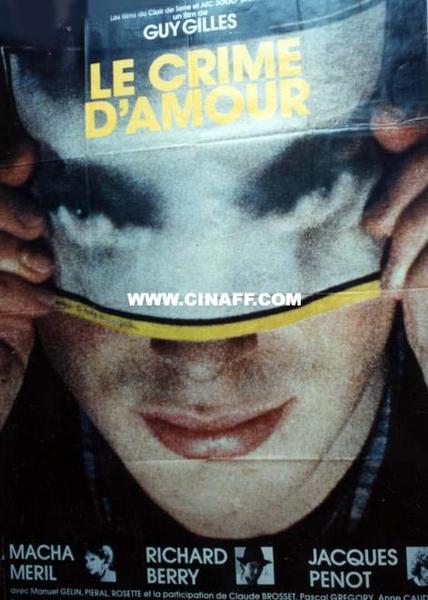

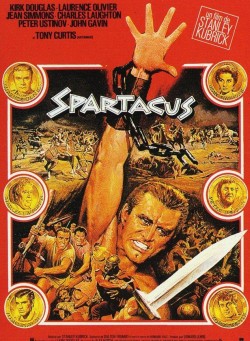
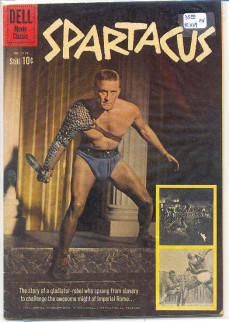

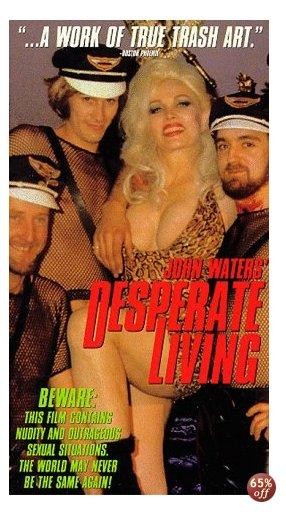
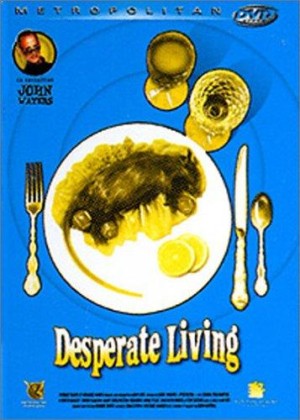



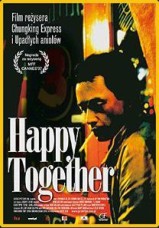
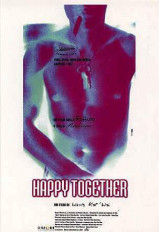



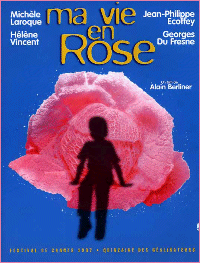


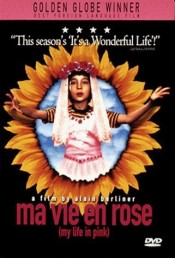

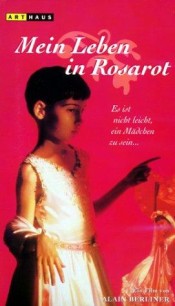

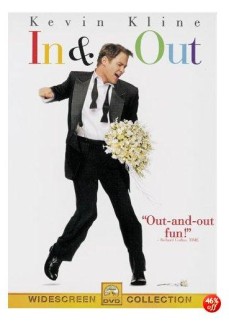



Commentaires