Fiche technique :
Avec Jean-Claude Adelin, Claude Brasseur, Jacques Bonnaffé, Marianne Denicourt, Thierry Lhermitte, Didier Bezace, Daniele Lebrun, Jean-Pierre Cassel, François Berléand, Laurent Malet et Maurice Barrier. Réalisé par Marcel Bluwal. Scénario de Jean-Claude Carrière. Compositeur : Antoine Duhamel. Directeur de la photographie : Philippe Pavans de Ceccaty.
Durée : 120 mn. Disponible en VF.
L'avis de Bernard Alapetite (Eklipse) :
Les films français sur le cinéma sont rares (La Nuit américaine, Le Schpountz ...). Les films sur Vichy aussi. Ce passé, qui ne passe pas, s’est assez bien passé pour la grande famille du cinéma français – tout du moins pour ses membres qui n’étaient pas juifs... La période n’a engendré que peu d’œuvres, qu’il ne faut pas confondre avec le cinéma sur la résistance pour ne pas dire résistansialiste (La Ligne de démarcation, La Bataille du rail, L’Armée des ombres...), ni avec les film qui prennent cette époque comme toile de fond. Il y a bien sûr le Pétain de Chabrol, le très beau Hôtel du parc, on peut citer aussi moins centraux mais passionnants Drancy Avenir d’Arnaud Pallières en 1997 et Milice, film noir d’Alain Ferrari en 1998 et quelques autres, c’est peu. Le Plus beau pays du monde, le titre sous-entend le cinéma qui était dans ces années noires l’incontestable plus beau pays du monde et un refuge virtuel pour beaucoup, défriche un terrain vierge de notre cinématographie. Il y a eu depuis Laissez-passer, le chef-d’œuvre de Tavernier.
Le film nous raconte une histoire vraie : la naissance d’un film, Mermoz, de l’idée de départ jusqu’à sa sortie en passant par son tournage. En cela il serait déjà un exceptionnel document pédagogique et l’on peut faire confiance à Marcel Bluwal en la matière, si cette histoire se situait en une période historique normale, inscrite en pleine occupation ce film sage devient un brûlot tant il peint la grande famille du cinéma français comme un conglomérat d’opportunistes égoïstes. Le film se hisse à la tragédie lorsque l’on apprend que la vedette de Mermoz, Robert Hugues-Lambert est arrêté en plein tournage par la police allemande à cause de son homosexualité affichée (?). Jean-Claude Adelin, que l’on avait découvert incandescent dans le beau Buisson ardent de Laurent Perrin en 1987, compose un Lambert candide, courageux... et acteur médiocre. On passe au burlesque le plus noir dans la scène dans laquelle on tend au malheureux prisonnier un micro par-dessus les barbelés de son camp, le camp de transit de Compiègne, à deux heures de vélo de Paris, pour qu’il sonorise une scène qui avait été tournée mais était restée muette. Le metteur en scène n’hésite pas à lui demander d’y mettre un peu plus d’entrain ! Entre autre « détail » sinistre, on apprend horrifié qu’un hôtelier louait les chambres de son établissement qui avait vue sur le camp à tous ceux qui voulaient jeter un dernier regard sur un être cher avant qu’il soit déporté !
Le Plus beau pays du monde est paradoxalement un hommage au cinéma des années 40, dans le sens d’une certaine justesse des dialogues, et surtout de la manière dont il met merveilleusement en valeur les seconds rôles. Il n’y a d’ailleurs pas vraiment de premier rôle dans ce film. Chacun des 25 personnages parlants possèdent une épaisseur et donnent autant de directions différentes au film, le relançant à chaque scène. Bien sûr la mise en scène n’a pas la fluidité de celle du Dernier métro de Truffaut, auquel on ne peut s’empêcher de penser. Le talent de Bluwal n’est pas seul en cause : la différence majeure entre les deux films est que les protagonistes du Plus beau pays du monde n’ont pas le même désir de cinéma que ceux du Dernier métro avaient de désir de théâtre et d’amour, les deux désirs à l’unisson l’un de l’autre étaient immenses.
En montrant mille détails de la vie quotidienne des parisiens pendant l’occupation, Marcel Bluwal réussit à nous faire ressentir le climat de ces années-là. Il rend tangible cette peur de perdre le peu de liberté et de libre arbitre qu’il reste, la peur de ne pas avoir à manger, la peur d’être dénoncé, la peur de perdre la vie, peur d’être pris pour un autre. Là où Losey dans le beau Monsieur Klein montrait la lente descente d’un homme unique vers l’oubli (inoubliable Alain Delon), Marcel Bluwal filme un groupe, ici le petit milieu cinématographique, ni meilleur ni pire qu’un autre et représentatif du moral de la plupart des Français d’alors avec toutes ces petites lâchetés et vilenies qui émaillent le quotidien de ces gens et qui ne font que traduire cette terreur (non dénuée de fondement) de plonger dans l’oubli de la déportation, dont on ignore les modalités mais que l’on pressent horrible, ce qui est au premier comme au second degré le thème majeur du film. Il est toutefois dommage que ce ne soit que dans les dix dernières minutes du long métrage que l’on apprenne par des documents d’archives que ce Lambert a réellement existé et qu’il a été arrêté une semaine avant la fin du tournage pour « oisiveté », en réalité à cause de son homosexualité et qu’il est mort en déportation.
Le scénario de Jean-Claude Grumberg utilise habilement, même si il prend des libertés avec la réalité, le mystère qui entoure Lambert (est-il un résistant, un espion ?) L’intérêt est constamment soutenu grâce, entre autre, aux scènes de comédie sur le fil du rasoir un peu à la manière de celles de La Traversée de Paris et de la pièce du même Grumberg: L’atelier.
C’est toute une époque du cinéma que fait revivre Le Plus beau pays du monde… Il nous montre un cinéma encore en lutte contre le théâtre, comme si l’un était le parent pauvre de l’autre. Il dénonce aussi l’aveuglement qui saisit des artistes qui sont prêts à toutes les compromissions pour que leur œuvre, même médiocre, voie le jour. Si le cinéma prend ses repères dans la vie, il n’est pas la vie. Il peut embellir la réalité mais aussi l’ignorer.
Parlant de Mermoz, le colonel Valogne (Thierry Lhermitte) dit à son réalisateur (Didier Bezace) : « Notre film est destiné à la jeunesse française. » Marcel Bluwal destine son film à la jeunesse pour qu’elle ne soit pas oublieuse, à ceux qui ont vécu cette époque et surtout à tous les fous de cinéma. Jacques Lourcelle, qui pour une fois quitte l’âge d’or du cinéma américain, résume bien ce qu’il faut penser du film. « À travers beaucoup de bassesses parfois même comiques, le tragique néanmoins affleure ! Il y a un aspect, une dimension dérisoire typique des milieux traités qui fait l’originalité de ce film. Le film de Bluwal écrit par Jean-Claude Grumberg est habilement et brillamment interprété: Riche en personnages et détails significatifs. Il brasse une matière à la fois douloureuse et passionnante insérée dans une très authentique reconstitution de tournage. » On peut regretter que Marcel Bluwal ait cru bon de changer les nom des protagonistes à l’exception de celui de Lambert.
En 1943, Robert Hugues-Lambert interprète le rôle du plus célèbre des aviateurs français dans le film Mermoz de Louis Cuny. L’un des seuls films de toute la production cinématographique française de l’occupation que l’on peut qualifier de vichyste. La première du film a lieu le 14 octobre 1943 à l’Opéra de Paris. Dans le palais Garnier, le tout-Paris de la collaboration se presse, même Max Bonnafous, ministre de Vichy a fait le déplacement. Dans la revue Le Film, le gala est évoqué en ces termes : « Pour la première fois depuis la guerre l’Opéra de Paris a servi de cadre à une grande manifestation cinématographique... » Il y a pourtant un grand absent à ce grand raout : Robert Hugues-Lambert, l’interprète du rôle titre. Il se trouve au même moment au camp de concentration de Buchenwald sous le matricule 21623. Il a été arrêté 7 mois plus tôt par la police allemande en plein tournage de Mermoz. Qui était-il et pourquoi a t-il été arrêté ?
Il naît à Paris le 1er avril 1908, son vrai nom est Lambert tout court, Hugues n’est encore que son prénom et Robert que son deuxième prénom. Ses parents sont tous deux employés au BHV. Après une enfance sage, il passe son brevet à 15 ans. Le collégien joue déjà au théâtre dans une troupe d’amateurs dont son père fait partie. Il suit des cours de théâtre. À 18 ans, il part au service militaire chez les chasseurs alpins. À son retour, il tente sa chance sur les planches. Il est engagé à l’Odéon mais il oublie de se présenter le jour de la première ! Il rejoint ensuite une tournée qui joue dans la France entière : la tournée Barret. Drôle, léger et inconscient, dans cette France du début des années 30, il affiche son homosexualité et parle de sa vie sexuelle comme un hétérosexuel parlerait de la sienne. Ce naturel, cette absence de honte sont perçus, à l’époque, comme de la provocation. En 1939 il est mobilisé et envoyé au front pendant la Drôle de guerre. Il revient à Paris après la défaite. En 1941, il remplace Alain Cuny dans Le bout de la route au théâtre des Noctambules, rue Champollion. En 1942, à la grande surprise de ses camarades, il abandonne la pièce car il est choisi pour jouer le rôle titre dans le Mermoz que va réaliser Louis Cuny. Son élection ne tient pas tant à son talent qu’à son étonnante ressemblance avec le héros de l’aviation disparu en 1936 et... compagnon de route du mouvement droitier du colonel de la Rocque (pour en savoir plus sur cet épisode, il faut lire la somme de Jacques Nobécourt : Le colonel de la Rocque 1885-1946 ou les pièges du nationalisme chrétien chez Fayard), puis du PPF de Jacques Doriot. Il doit aussi sa chance aux prétentions financières exorbitantes de Pierre-Richard Willm, alors grande vedette, qui avait été contacté en premier pour interpréter le rôle. Lambert se trouve pour sa toute première apparition à l’écran dans un premier rôle aux côtés de comédiens chevronnés : Héléna Manson (l’infirmière dans Le Corbeau de Clouzot), Jean Marchat (le méchant du Remorque de Grémillon), Lucien Nat, alors au sommet de sa carrière (on le retrouvera bien des années après dans Les Amitiés particulières).
Le cinéma français se porte très bien en ces années de guerre ; certains ont même parlé d’un Âge d’Or du cinéma français. Les allemands, comme Vichy, tiennent à donner aux Français une impression de normalité et surtout à les distraire pour oublier les privations et surtout, il faut bien le dire, pour les empêcher de réfléchir. La production des films entre dans cette stratégie. Dans cette optique, les films légers sont les films les plus aidés. La plupart des œuvres de l’époque sont aidées par des subventions diverses. Mermoz ne fait pas exception à la règle. La production reçoit plus d’un million de francs. Ce que niera ensuite le producteur du film : André Tranché. Si le montage du film fut difficile, c’est peut-être qu’il était un des rares films vraiment vichystes de l’époque. Jean-Pierre Bertin-Maghit, l’auteur du meilleur livre sur le cinéma de cette période : Le Cinéma français sous l’occupation aux PUF, parle de Mermoz en ces termes : « Mermoz est l’un des rares films de la période où soient réunis un ensemble de signes fascisants : le pilote de l’aéronautique, en particulier, est un héros solitaire, engagé dans une œuvre d’utilité collective au prix d’une lutte contre la bureaucratie et les forces d’argent qui lèsent les intérêts de l’individu comme de la nation entière. » Pourtant, lors de la sortie du film, la centrale catholique émettra tout de même une réserve : « Bon film qui montre l’énergie et le courage au service d’une grande tâche et qui magnifie l’effort. Cependant présence d’une fille, allusions grivoises, jurons, mots grossiers. »
Le monde du cinéma d’alors était surtout opportuniste. Pour s’en convaincre, il suffit de lire le stupéfiant Journal 1942-1945 de Jean Cocteau paru en 1989 chez Gallimard. La persécution des juifs, nombreux dans les métiers du cinéma, comme le dénonçait Lucien Rebatet, le très écouté critique de cinéma de l’hebdomadaire ultra collaborationniste Je suis partout, dans son pamphlet antisémite : La tribu du cinéma. Les combattants (Gabin, Jean-Pierre Aumont, Claude Dauphin...), les prisonniers de guerre (Bernard Blier, Pierre Bost...) et les exilés (Jouvet...) avaient créé de larges béances dans les rangs de « la famille du cinéma ».
Le maréchal Pétain s’intéresse au projet. Il charge le sculpteur François Cogné (celui-là même qui avait réalisé le buste du chef de l’État français qui devait remplacer le buste de Marianne dans toutes les mairies de France) de veiller à sa bonne exécution ! Il y aura une avant-première à Vichy le 11 octobre 1943, en présence du maréchal Pétain et de la mère de Mermoz. Mais pour en arriver là, ce n’aura pas été sans mal. Les problèmes viennent surtout du jeu de Lambert trop théâtral, trop « Comédie Française ». Le réalisateur, lui aussi débutant, devait faire de nombreuses prises pour chaque scène à une époque où la pellicule était rare. Mais le problème le plus aigu est le filmage de la scène figurant l’accident d’avion dans la Cordillère des Andes. Le tournage de cette scène était prévu au départ en décor naturel, mais il s’avère bientôt impossible de transporter un avion des années 30 dans les Alpes. Il faut donc tourner en studio. Un panorama de montagnes enneigées est construit dans le studio de la rue François 1er, aujourd’hui les locaux de la radio Europe n°1, pour la somme exorbitante de 1 200 000 francs. En outre, certaines scènes devaient être tournées dans la zone libre, mais l’invasion de celle-ci en novembre 1942 rend le tournage impossible. Tous ces contretemps allongent la durée du tournage. Les comédiens en profitent pour réviser leurs exigences à la hausse.
Mais la vraie catastrophe, c’est l’arrestation le 3 mars 1943 de Lambert. Il reste encore plusieurs scènes à tourner ! Comment finir un film sur Mermoz, sans Mermoz ? L’équipe de production trouve une solution de colmatage. Dans les scènes qui restent à tourner Mermoz n’apparaîtra que de dos. Il sera interprété par Henri Vidal qui, de dos, ressemble à Lambert. Tranché aurait eu cette idée après qu’un barman d’un café, le Silène, près du studio de la rue François 1er, lui eut parlé de la ressemblance entre les deux hommes. Curieusement, Henri Vidal, qui épousera Michèle Morgan en 1949, n’a jamais évoqué cet épisode de sa vie à celle-ci. L’idéal serait de doubler les images d’Henri Vidal avec la voix de Lambert. La production apprend que ce dernier est enfermé au camp militaire de Compiègne-Royallieu, rebaptisé Front Stalag 122. Seule solution : se rendre sur place pour enregistrer la voix du prisonnier.
André Tranché est alors un jeune producteur de 29 ans qui a beaucoup misé sur Mermoz. Il raconte : « J’ai téléphoné à un ami qui habitait Compiègne et qui avait le bras long. Il a tout arrangé. Je suis parti pour Compiègne accompagné d’André Cottet, le patron des studios des Buttes Chaumont. Mon ami m’avait indiqué le chemin vers le camp de prisonniers. J’ai approché le cul de la camionnette d’enregistrement le long du mur et je suis monté sur le toit. Tout était prévu. Lambert nous attendait de l’autre coté. J’ai déployé la perche au-dessus de l’enceinte et des barbelés avec le micro au bout. Hugues avait 10 ou 12 phrases à dire et il avait le texte en main ; je lui avais fait parvenir par un intermédiaire qui lui avait expliqué que je voulais le faire relâcher. Après l’enregistrement, j’ai dû lancer : Allez, à très bientôt ! »
En réalité, pas plus Tranché qu’un autre ne fera de démarches pour libérer Lambert. Tranché fait en 1999 cette déclaration ignoble à Marc Epstein de l’Express : « De mon point de vue, le film était terminé. Dans les années 30, un grand producteur américain m’avait donné un conseil : « Mon petit, si vous voulez faire du cinéma, dites-vous bien qu’un acteur, c’est un ouvrier, il est comme le plombier qui vient réparer le robinet. Il doit travailler. Ces gens-là, c’est rien. Ça ne sert à rien d’être copain avec eux. » Je ne l’ai jamais oublié. » On ne saurait mieux dire ! À noter que le sieur Tranché a sévit dans le cinéma jusque dans les années 70 comme scénariste. On lui doit entre autres la version française du Grand silence de Corbucci. Ils avaient obtenu ce qu’ils voulaient : le film était sauvé, peu leur importait le destin de Lambert. Alors que très probablement la moindre démarche un peu appuyée aurait permis de le faire libérer. Le père de l’acteur comptait sur les messieurs du cinéma pour le faire libérer.
Le réalisateur, lui aussi, continua de tourner en tout une dizaine de films dont le dernier en 1959 s’intitule Symphonie pour un homme seul, il est peu probable malgré le titre qu’il ait alors songé au malheureux Lambert.
Le mystère des raisons et des conditions de son arrestation demeure. Il n’est pas certain, comme le dit Tranché, que Lambert ait été raflé dans un bar homosexuel. Une rumeur voudrait qu’il ait eu une liaison avec un officier allemand et qu’il aurait été dénoncé comme homosexuel par un autre officier allemand jaloux de son camarade ! Une chose est certaine : si son arrestation est due probablement indirectement à son homosexualité, celle-ci ne peut pas en être la cause directe et encore moins officielle. Les homosexuels, nombreux dans le monde du spectacle du Paris de l’occupation, n’ont jamais été inquiétés. Dans la distribution même de Mermoz, Jean Marchat qui joue le rôle de Saint-Exupéry vécu toute sa vie avec Marcel Herrand, l’interprète de Lacenaire dans Les Enfants du paradis ; Jean Weber, qui présenta une partie de la soirée de gala à l’Opéra de Paris, fut l’un des premiers acteurs français à évoquer ouvertement, dès 1935, son attirance pour les hommes. Serge Lifar, qui dansa le même soir sur une musique originale d’Arthur Honegger, était l’ancien amant de Serge Diaghilev, le créateur des Ballets russes.
Pour plus d’informations :







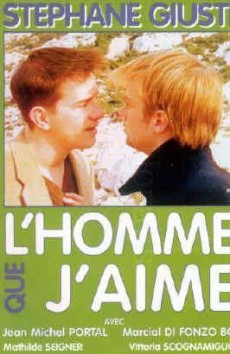
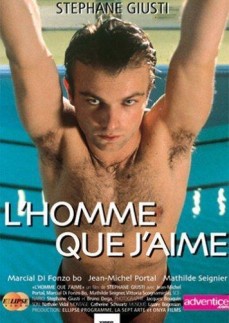
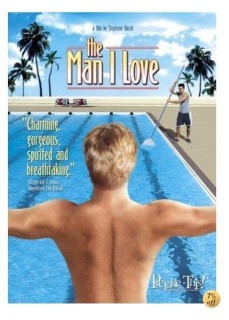

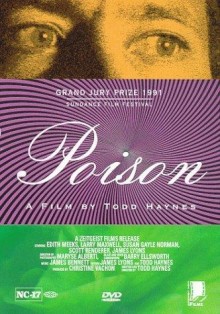




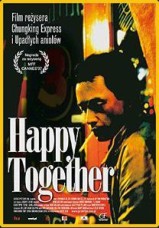
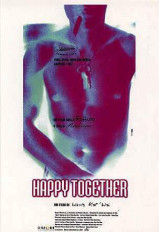

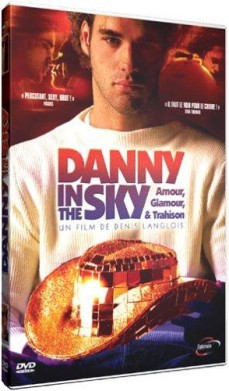
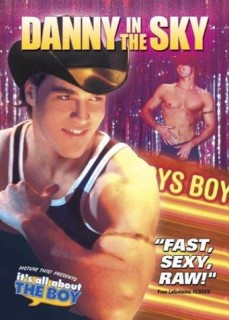
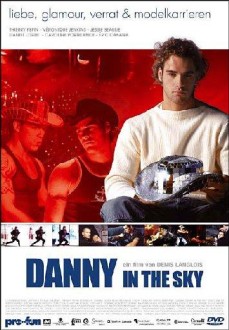
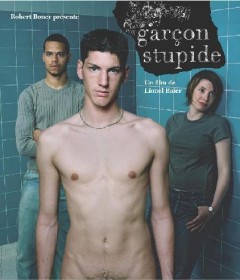
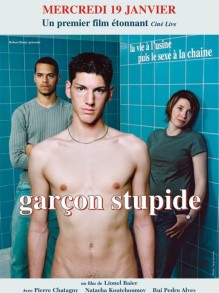

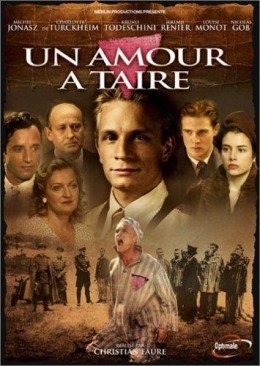
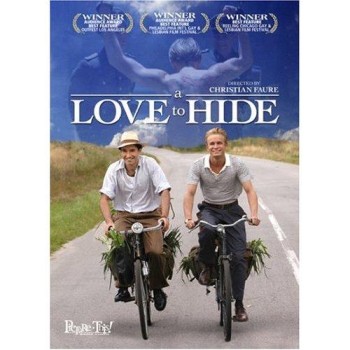

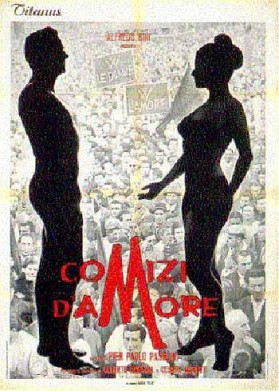
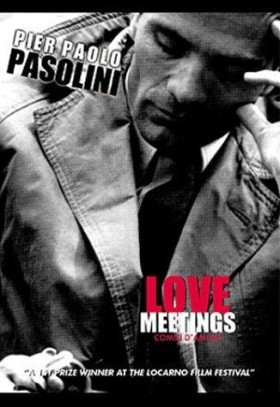

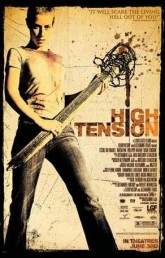

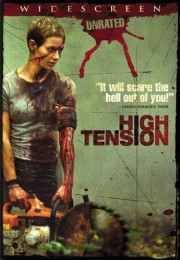




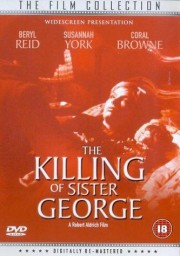

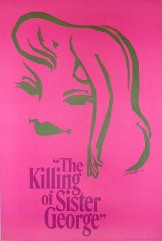


Commentaires