Fiche technique :
Avec Naomi Watts, Laura Elena Harring, Justin Theroux, Ann Miller, Dan Hedaya, Brent Briscoe, Robert Forster, Katharine Towne, Lee Grant, Scott Coffey et Billy Ray Cyrus. Réalisé par David Lynch. Scénario : David Lynch. Directeur de la photographie : Peter Deming. Compositeur : Angelo Badalamenti.
Durée : 146 mn. Disponible en VO, VOST et VF.
Résumé :
À Hollywood, durant la nuit, Rita, une jeune femme, devient amnésique suite à un accident de voiture sur la route de Mulholland Drive. Elle fait la rencontre de Betty Elms, une actrice en devenir qui vient juste de débarquer à Los Angeles. Aidée par celle-ci, Rita tente de retrouver la mémoire ainsi que son identité.
L’avis de Petit Ian :
Entre amnésie, fantasme, cauchemar et réalité, deux jeunes femmes sans âme abritent en elles divers personnages métallescents, incandescents, mais pas forcément attendrissants... avec des « sans », il y a bien des vides à combler par de l'hallucinant. Déroutant ? C'est Lynch qui conduit...
Mulholland Dr., où bien des âmes ont péri, où bien des étoiles se sont décollées. Là haut dans la montagne, les lettres d'HOLLYWOOD pourrissent. Une musique lancinante, à vous tordre les boyaux. Sur la route, une femme sublime avance comme elle le peut, dernière victime en date de la malédiction qui y pèse. En bas, les rêves poussent et fanent à la même allure, une jeune actrice croit encore à la lune. Les deux âmes se rencontrent et vont partir à la recherche de ce qu'elles sont. Un soir, leurs chairs s'unissent. Vers le chaos, comprenez que nous avons bien des choses à exorciser.
Mulholland Drive... Voici un incroyable feuilleton. Voici également un film d'horreur à la fois soft et puissant. Et parmi les phobies qui vous dévorent, celui-ci pourrait peut-être bien en faire partie. Avez-vous jamais désiré entrevoir, une fraction de seconde, la forme de vos peurs ? Une forme bestiale qui dévoile son visage du mur derrière lequel elle est cachée. C'est une des images du film de David Lynch, un de ses délires.
Dans Mulholland Drive, l'amour précède le désordre, l'onanisme précède la mort. C'est le prix pour arracher hors de soi ses pulsions homosexuelles, son désir de masturbation, sa gloire rêvée, sa gloire ratée. La mémoire que l'on perd, les corps que l'on désire, l'humiliation que l'on subit, que l'on finit par s'infliger. Durant ces deux heures et demi, peut-être reconnaîtrez-vous vos fantasmes inavoués, votre désarroi enfoui.
Mettre en scène du n'importe quoi, c'est aussi facile que fascinant.
Il y a des scènes magnifiques. Il y a aussi une profonde obstination à souligner la psychose de façon grotesque.
Vous l'aurez compris, sur Mulholland Drive, on fait parfois de mauvais rêves. Devant aussi.
L’avis de Philippe Serve :
Silencio
La ligne droite et simplissime d'Une Histoire vraie (A Straight Story, 1999) n'aura donc bien été qu'une parenthèse, inattendue et quasi iconoclaste dans la filmographie de David Lynch. Avec Mulholland Drive le cinéaste revient à sa veine la plus personnelle, celle des démons cachés de Twin Peaks (feuilleton et film, 1992), Blue Velvet (1986) ou Lost Highway (1996)…
Si ce nouvel opus lynchien contient lui aussi sa part importante d'ombres et de mystère, aller jusqu'à affirmer comme la plupart des critiques qu'il débouche à l'arrivée sur un chef d'œuvre incompréhensible me paraît assez étonnant. « Chef d'œuvre », oui, aucun doute tant le film est achevé, maîtrisé, inquiétant et passionnant de la première à la dernière de ses 146 minutes… Mais incompréhensible ? Je ne crois pas… Attention ! Je ne prétends pas être sorti de la salle de projection habité de la plus grande certitude sur ce que je venais de voir. Non. Mais au fil des heures, revoyant et reconstruisant mentalement le film, il me semble être parvenu à ce qui ressemble à « une » lecture possible de Mulholland Drive. Le film ne m'a plus alors seulement parlé aux sens mais aussi à l'intelligence, ultime marque de respect et de considération de David Lynch à son public.
Je ne livrerai pas mes hypothèses personnelles au sein de cette critique ne voulant pas gâcher le plaisir du futur spectateur.
Le projet de Mulholland Drive tenait à cœur de David Lynch depuis longtemps, en fait juste après qu'il en eut fini avec Twin Peaks, la série (puis le film Twin Peaks: Fire Walks With Me) qui établit sa réputation à l'échelle mondiale et consacra surtout l'univers lynchien, si spécial. La chaîne de télévision ABC lui passa commande pour un « pilote » destiné à un nouveau feuilleton qui surferait sur le succès phénoménal de Twin Peaks. Hélas, le projet capota, le média US n'aimant à peu près rien de ce qui lui fut proposé, à l'exception du titre, "MULHOLLAND DRIVE"… Il faut ici préciser à quoi renvoie ce titre. Mulholland Drive est une route qui serpente sur la colline surplombant Los Angeles et Hollywood. Sans feux de signalisation, sans Stop, elle semble mener nulle part. Lynch assure qu'elle doit sa réputation mythique (à l'égale d'Hollywood Boulevard) à tous les mystères, plus étranges les uns que les autres, qui y sont attachés… Après le rejet de ABC, le projet aurait pu disparaître à jamais sans l'intervention du Studio Canal Plus qui reprit l'idée et demanda à Lynch de réaliser non plus un feuilleton mais un film.
Les thèmes évoqués par le film ? (je vais essayer de ne pas déflorer l'essentiel): Hollywood, ses mirages, les rêves et espoirs insensés qu'il génère, les déceptions et désespoirs qu'il provoque, la Vie, la Mort, l'Amour, la passion, la jalousie, la frustration et encore et toujours le choc frontal entre rêve et réalité (s'agissant de l'univers si particulier à Lynch, on pourrait presque dire « entre cauchemar rêvé et cauchemar éveillé »)…
Mulholland Drive est un film en forme de puzzle dont chaque pièce nous passe sous le nez sans que nous le sachions durant les deux premiers tiers du film. Ce n'est que dans la dernière partie (le dernier tiers), alors que tout bascule et que le scénario rebondit cul par-dessus tête que nous commençons à réaliser que le cinéaste nous a manipulés depuis le début et que vite, vite, il faut rassembler les pièces éparses auxquelles nous n'avions pas prêté attention. Disons en gros que la première partie du film nous rend spectateur passif (mais complètement sous le charme vénéneux d'un film noir superbe) tandis que la dernière agit sur nous comme un électrochoc visant à nous faire participer pleinement dans une sorte de relation interactive.
Que voyons-nous à l'écran ?
Tout d'abord, succédant au générique, une séquence endiablée de Jitterbug (sorte de boogie des années 50) dont l'explication viendra beaucoup plus tard dans le film… Une jeune femme brune, superbe (Laura Elena Harring), dans une limousine qui grimpe les lacets de Mulholland Drive. La voiture s'arrête et le chauffeur pointe un revolver sur la femme. Il semble s'apprêter à la tuer quand une voiture filant à toute allure et emplie de jeunes fêtards vient violemment heurter la limousine. Seule, la jeune femme survit dans le choc et s'extrait, hagarde, de la carcasse de la voiture. Elle descend la colline menant aux lumières de L.A. et trouve refuge dans une maison que vient de quitter sa propriétaire… Le lendemain matin, une autre jeune femme, blonde celle-là, Betty (Naomi Watts) débarque à l'aéroport de la ville et vient emménager dans cette même maison dont la propriétaire est sa tante. Betty vient à L.A. pour y embrasser une carrière d'actrice, elle se montre pleine d'enthousiasme et de fraîcheur. Visitant la maison, elle découvre la jeune femme brune sous la douche. Celle-ci se révèle amnésique, ignorant jusqu'à sa propre identité, « volant » le prénom "Rita" à l'actrice Rita Hayworth dont le nom s'affiche sur un poster du mythique Gilda. Dans son sac, les deux jeunes femmes découvrent 50 000 dollars. Dès lors, Betty et "Rita" décident de mener l'enquête pour découvrir la mémoire oubliée de la seconde nommée, à commencer par les raisons de l'accident… Pendant ce temps, un jeune réalisateur, Adam Kesher (Justin Theroux) se voit imposer par des maffieux contre sa volonté et sous la menace, l'engagement d'une jeune actrice avant de trouver son épouse au lit avec un autre homme qui le rosse…
Aller plus loin dans le résumé serait criminel… Un conseil au spectateur potentiel: regardez TRÈS attentivement chaque plan, écoutez religieusement chaque réplique, chaque son, retenez bien le moindre visage et le nom qui lui est attaché. Car tous ces éléments sont autant de pièces indispensables à la formation finale du puzzle…
David Lynch parie donc sur l'attention et l'intelligence du spectateur, n'hésitant pas à semer son film de multiples références cinématographiques, telles que le célèbre Vertigo (Sueurs froides, 1957) d'Alfred Hitchcock, Boulevard du Crépuscule (Sunset Boulevard, 1950) de Billy Wilder ou le cultissime En quatrième vitesse (Kiss Me Deadly, 1955) de Robert Aldrich, via une étrange boîte (de Pandore ?), voire le plus récent Pulp Fiction de Quentin Tarentino (1994), sans oublier ses propres films. Ainsi de la séquence (primordiale à la bonne compréhension du film) du théâtre où un acteur-bonimenteur affirme, play-back et chanteuse à l'appui, que tout est déjà enregistré, autrement dit que rien n'est vrai et qu'il faut se méfier des apparences. Lynch, cinéaste, peintre, photographe mais aussi musicien, a toujours aimé insérer des scènes de cabaret, de chansons dans ses films. Que l'on songe à la "Dame du radiateur" chantant sa berceuse dans Eraserhead (1977), à la représentation théâtrale qui fait pleurer John Merrick, l'Elephant Man (1980), à Isabella Rossellini susurrant "Blue Velvet" dans le film du même nom ou, dans la même œuvre, à Dean Stockwell mimant le "Dreams " de Roy Orbison, ou à d'autres scènes dans Twin Peaks ou Lost Highway…
Mulholland Drive est aussi une étonnante leçon de cinéma et le Prix de la Mise en Scène attribué au film au Festival de Cannes 2001 (ex-aequo avec The Barber de Joel Coen) est entièrement mérité, ainsi que le César du meilleur film étranger ! Mulholland Drive est une œuvre d'une très grande beauté, aux images léchées, aux couleurs magnifiques et on retrouve une fois de plus avec un énorme plaisir les partitions musicales du fidèle et ô combien talentueux Angelo Badalamenti (employé pour la première fois comme acteur dans le rôle d'un producteur).
Les deux actrices principales du film, largement inconnues du grand public, font merveille. Laura Elena Harring, brune piquante, dans un registre à mi-chemin entre Rita Hayworth (on l'imagine aisément dans un remake de Gilda) et Ava Gardner, joue comme un oiseau de nuit fragile et apeuré avant de retrouver une assurance de femme fatale en fin de film… Naomi Watts, la blonde très hitchockienne (entre Tippi Hedren et Grace Kelly), hérite du meilleur rôle par sa complexité et ses rebondissements, ce qui lui permet de faire preuve d'une versatilité d'actrice assez remarquable…
Tous les autres acteurs assurent parfaitement leurs rôles, à commencer par Justin Theroux dans le rôle du jeune cinéaste Adam ou Ann Miller, ex-reine des claquettes des années 50…
Mulholland Drive intrigue, inquiète, angoisse, amuse (une scène étonnante de tuerie, les maffieux, l'adultère…). En un mot, excite l'intérêt du spectateur. Si vous n'aimez que les histoires mâchées et remâchées, bien rationnelles et sur lesquelles vous pouvez vous reposer sans avoir à réfléchir, alors passez votre chemin, ce film n'est pas pour vous… À l'inverse, si vous vous régalez à vous retrouver baladés entre ombres et lumière, à plonger dans un délire d'inventivité scénaristique et cinématographique, précipitez-vous sur ce Mulholland Drive, vous en sortirez ébloui !
Pour plus d’informations :







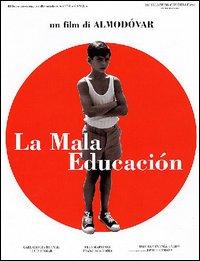
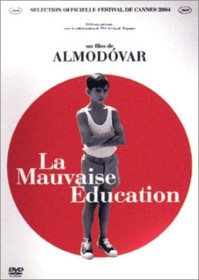
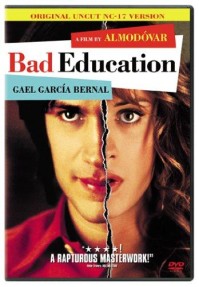
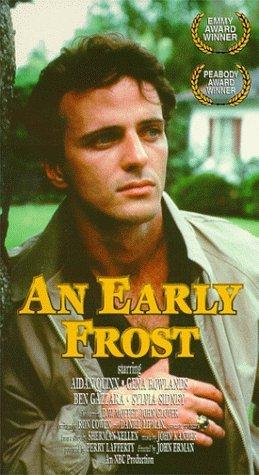




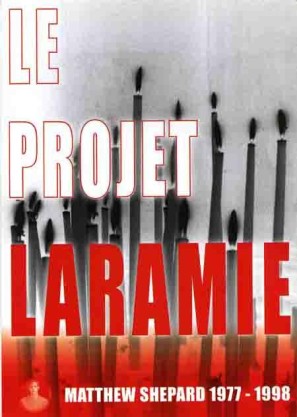
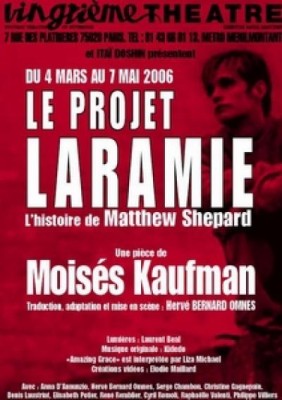

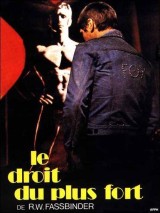

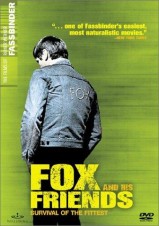

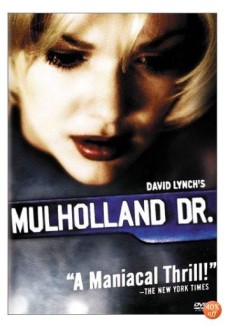






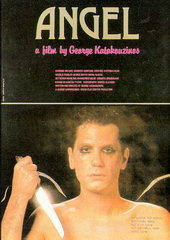

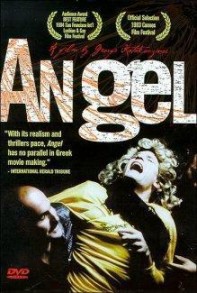
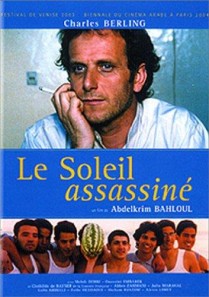



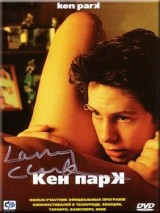
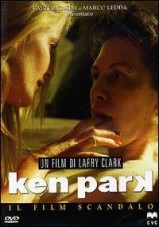



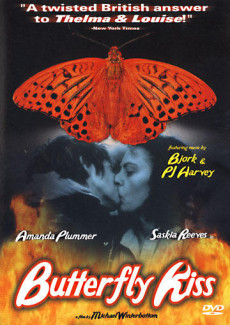
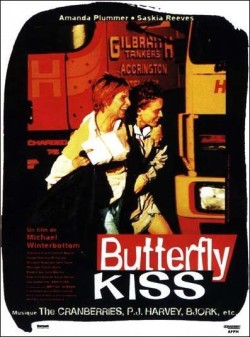

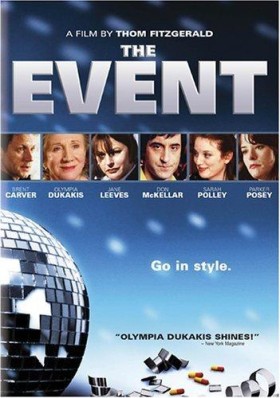
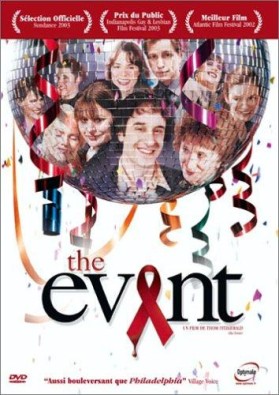

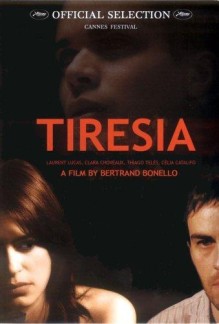
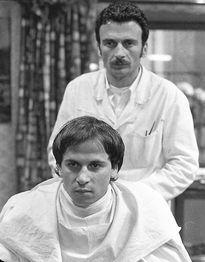

Commentaires