
Fiche technique :
Avec Laetitia Casta, Yannick Renier, Yann Trégouët, Christine Citti, Marc Citti, Sabrina Seyvecou, Théo Frilet, Edouard Collin, Kate Moran,
Fejria Deliba, Gaetan Gallier, Osman Elkharraz, Slimane Yefsah, Matthias Van Khache, Thibault Vincon, Marilyne Canto, Alain Fromager et Gabriel Willem. Réalisation : Olivier Ducastel &
Jacques Matineau. Scénario : Olivier Ducastel & Jacques Martineau. Musique : Philippe Miller. Image : Matthieu Poirot-Delpech. Montage : Dominique Galliéni.
Durée : 177 mn. Actuellement en salles en VF.
Résumé :
Catherine, Yves et Hervé (Yann Tregouët) ont une vingtaine d’années. Ils sont étudiants à Paris et ils s'aiment. Mai 68 bouleverse leur
existence. Séduits par l'utopie communautaire, ils partent avec quelques amis s'installer dans une ferme abandonnée du Lot. Loin des préoccupations du capitalisme, ils refusent le diktat de
l'accumulation des richesses et de l'individualisme. Cependant, très vite, l'utopie communautaire révèle ses limites, celles de l'expression des ego et de l'amour qui ne souffre d'aucun partage.
Le groupe se désagrège mais Catherine refuse de se soumettre. Elle continue à être fidèle à ses idéaux et tient la ferme seule. Elle y élève ses enfants.

1989. Les enfants de Catherine et Yves entrent dans l'âge adulte. Ils affrontent un monde qui a profondément changé : entre la fin du Communisme et l'explosion de l'épidémie du sida, l'héritage
militant de la génération précédente doit être revisité...

L’avis de Bernard Alapetite :
Nés en 68 (il faut comprendre le titre dans le sens où les protagonistes
sont véritablement nés au monde sur les barricades, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans) a tous les défauts et toutes les qualités d’un premier film d’un réalisateur qui a un cœur « gros comme
ça » et qui a voulu tout mettre dans son premier long métrage, craignant que ce soit le seul. On peut dire sans craindre de se tromper que c’est un vrai film d’auteur avec ce que devrait
toujours signifier ce terme : l’urgence vitale pour le réalisateur de le faire sien. Le cœur à gauche, il y a mis toutes les luttes, tous les espoirs et aussi toutes les déceptions des
quarante dernières années de son camp, qui se vit et s’imagine toujours floué par l’histoire. Ça commence avec les barricades de mai 68, ça continue par les espoirs mis en Mitterrand, pour se
terminer dans l’affirmation que les sectateurs du grand soir sont toujours prêts à bouter l’actuel président, qui lui se rêve en fossoyeur de mai 68... Mais le réalisateur a peut-être voulu
surtout, à travers de cette fresque généreuse faire un beau portrait de femme, celui de Catherine, qu’incarne merveilleusement Laetitia Casta. Peut-être est-ce celui de sa mère, si le cinéaste
est né en 1968 ? À moins que les chapitres qui lui tiennent le plus à cœur soient ceux de la saga du combat des homosexuels, d’abord pour leur affirmation, puis pour leur survie et enfin pour
leur devenir... À moins encore que ce qui lui importe le plus, soit de nous parler avec pudeur de son amour de jeunesse, fauché par le sida à quelques semaines de la mise en service des
trithérapies... Voilà ce que j’aurais écrit si je n'avais pas su que Né en 68 a été réalisé par Ducastel et Martineau et que leurs précédents films, dans l’ordre chronologique Jeanne
et le garçon formidable, Drôle de Félix, Ma vraie vie à Rouen et Crustacés & Coquillage, sont en bonne place dans ma dévéthèque.

Nés en 68 contient deux films. Il est distinctement divisé en deux parties.
La première consiste surtout à décrire l’expérience de la communauté agricole qu’ont fondée le groupe de gauchistes autour de Catherine (Laetitia Casta). Elle se termine lorsqu’arrive sur l’écran
le panneau « 8 ans plus tard ». La deuxième est plus politique et se focalise surtout sur la geste des homosexuels, de la libération jusqu’à la quasi banalisation en passant par le
drame du sida, la lutte pour le PaCs et l’avènement des trithérapies et n'échappe pas toujours au didactisme.
La première est la plus dense et la plus réussie. Ducastel et Martineau réussissent, comme je ne l’ai jamais vu au cinéma, à capter l’esprit de mai 68 (beaucoup mieux que le très très très...
sur-coté Garrel dans son super chiant Les Amants réguliers) ou plutôt celui de l’immédiat après mai. Curieusement, c’est dans la première moitié du film qu'à la fois, la prestation
collective des acteurs est la meilleure mais c’est aussi dans celle-ci que certains sont mauvais dans certaines scènes ou transparents. Les cinéastes peinent à individualiser les protagonistes de
la communauté, certains ne font que passer ou disparaissent arbitrairement.

Contrairement à Renaud Bertrand, le réalisateur de Sa raison d’être, avec lequel on ne peut faire que la comparaison, Martineau et Ducastel n’ont pas eu le projet fou de mettre tous les
grands événements de ces quarante dernières années dans leur film. Ils réussissent souvent à les intégrer subtilement à leur récit, c’est le cas pour le 11 septembre, c’est d’ailleurs presque la
seule intrusion de la politique internationale dans le film, qui est trop centré sur la seule petite France. On voit les images de l’attentat contre le World Trade Center sur une télévision
pendant qu'à côté, Boris (Théo Frilet) et Vincent (Thibault Vincon) font l’amour avec passion, leur histoire personnelle est si forte qu’elle les ferme à cet instant au monde et leur font rater
l’événement. Mais le spectateur sait qu’ils verront ces images après...
Si chez Renaud Bertrand on sentait derrière la réalisation le cahier des charges de la production, en l’occurrence la chaîne de télévision qui allait diffuser le film, rien de tel chez nos deux
cinéastes qui ont pourtant eux aussi beaucoup (trop ?) chargé la barque de leur scénario et ont eu également la tentation du mélodrame. Genre qui revient en ce moment en force dans toutes les
cinématographies. Si on croit à ce qui arrive aux personnages, c’est qu’ils ont réussi à inscrire les péripéties de leur vie dans leur propre logique.
Une des scènes m’a beaucoup fait réfléchir, en particulier sur sa réception, est celle de l’amour libre entre fleurs et prés dans laquelle les membres de la communauté et des amis de passage
s’ébattent nus dans une sorte de ronde dionysiaque. Elle est sans doute une des plus naturalistes du film, oui c’était comme ça, et pourtant il est probable qu’elle paraîtra to much pour la
plupart des spectateurs. On voit en cela combien à la fois la liberté sexuelle a régressé et combien la perception du corps a changé. À ce propos, si la réalisation dans cette séquence ne se
montre pas pudibonde, elle manque d’audace et de vérisme dans les scènes de sexe qu’elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles.

Ducastel et Martineau se prennent un peu les pieds dans le tapis de la chronologie, en particulier pour le personnage de Gilles (Yannick Renier) dont le conseil de révision me parait arriver bien
tard dans son histoire ; par ailleurs, cette bonne scène montre que l’armée n’est pas qu’un ramassis de ganaches. Souvent ainsi avec bonheur le scénario prend le contre-pied des clichés. Il
serait bon que les scénaristes, lorsqu'ils ont à « gérer » un grand nombre de personnages, comme ici, se souviennent de la méthode de Roger Martin du Gard lorsqu'il préparait Les
Thibault. Il écrivait la biographie séparément et complète pour de chacun de ses personnages, y compris pour des périodes qui ne se trouveraient pas dans le roman, puis les confrontaient
pour les faire coïncider.
Gilles, qui semble à peine vieillir durant quarante ans, soulève le problème récurrent du vieillissement des acteurs lorsqu’on suit les personnages qu’ils incarnent sur une longue période.
Ducastel et Martineau ne s’en tirent pas mal, même si le temps est un peu trop clément pour leurs créatures. Peut-être est-ce pour équilibrer la cruauté des vies qu’ils mettent en scène ?
Peu de films parviennent comme celui-ci à nous faire ressentir le poids des ans et des malheurs qui accablent toute vie sur sa durée.

Le mot durée me fait venir à envisager celle du film qui ne parait pas trop longue, jamais l’ennui pointe ; néanmoins, il aurait du s’arrêter en 2002, comme cela était prévu initialement, ce qui
aurait évité le pathos filandreux de la dernière séquence et l’anti sarkozisme de rigueur qui ne fait qu’alourdir le message qui est beaucoup moins manichéen qu’on pourrait le croire.
Tout d’abord, Nés en 68 a été pensé et écrit pour la télévision. Il y aura prochainement une diffusion sur Arte, dans un format plus long, remonté pour l’occasion. À ce sujet, Olivier
Ducastel déclare : « Le propos initial était de produire deux longs métrages pour la télévision, qui fonctionnent en diptyque, coproduits par Arte et France 2. Une fois les films tournés, le
producteur a fait lire les scénarios à Pyramide, le distributeur, qui a choisi de donner sa chance au film sur grand écran, à condition qu’on puisse couper entre trois quarts d’heure et une
heure. Le fait que le film sorte au cinéma nous a permis de pouvoir obtenir des moyens supplémentaires, notamment pour la musique. Nous avons tourné beaucoup. Pour ce film, qui fait un peu moins
de trois heures, nous avions un premier montage, avec tout le matériel mis bout à bout, de près de quatre heures trente. Les comédiens ont donc joué beaucoup plus que ce qui apparaît à l’écran et
cela les a énormément nourris. Ça a nourri leur parcours, ça les a aidés à porter le poids du temps qui passe. C’est toujours un peu désespérant de couper autant mais, en réalité ces scènes
coupées restent dans le film, en creux. Je pense qu’elles aident à la perception de la durée et à la fluidité de l’ensemble. » Espérons que les scènes coupées figureront dans la
diffusion télévisée et surtout sur le DVD. Nous aurons ainsi sans doute une meilleure perception de certains personnages qui ont du être sacrifiés au montage.
Malheureusement, le film n'échappe pas non plus à la maladie la plus fréquente qui accable le cinéma : celle des fausses fins.

Si Théo Frilet, qui joue Boris, a le plus beau cul que j’ai vu au cinéma depuis, disons celui aperçu dans le Lilies de
John Greyson en 1996, il a surtout beaucoup de talent. Il devrait prochainement interpréter Guy Mocquet à la télévision. Avec Laetitia Casta, d’une présence exceptionnelle, il est le seul à être
bon dans toutes ses scènes. Ce qui n’est malheureusement pas le cas, en particulier, des interprètes masculins qui sont parfois époustouflants dans une scène mais médiocres dans la suivante, sans
doute à cause d’un manque de répétitions ? Ou est-ce du à une trop grande impatience des réalisateurs qui ne voulaient (ou ne pouvaient) pas faire trop de prises ? Théo Frilet, outre qu’il soit
bien mignon (ce que l’on peut vérifier sur l’affiche), a comme la plupart de ses camarades du casting, un physique inhabituel dans le cinéma français, ce qui n’est pas le moindre charme du film.
Les réalisateurs font aussi preuve de fidélité, puisqu’ils retrouvent Sabrina Seyvecou et Edouard Collin, qui assure dans le rôle de Christophe, mais sans nous surprendre, tant celui-ci est dans
la ligne de plusieurs de ses prestations, tant au théâtre qu’à l’écran ; deux acteurs qu'ils avaient dirigés dans Crustacés et Coquillages.
Les déclarations des deux cinéastes, dans le dossier de presse, sur leur dernier opus sont des modèles d’honnêteté et de
clairvoyance : « Écrire et réaliser un film sur cette période, c’était pour nous une façon de reprendre possession d’une partie de notre existence qui appartient déjà à l’Histoire, et
même, pour l’essentiel, à l’Histoire révolue. C’est un retour sur notre passé personnel et collectif. Le film propose ainsi comme une recomposition, à partir d’aujourd’hui, de ce passé. Il
n’était pas question pour nous d’aborder ces quarante dernières années d’un point de vue d’historiens, mais d’un point de vue très intime, à la lumière de ce que nous sommes aujourd’hui... C’est
donc nettement le romanesque et le destin des personnages qui ont primé par rapport à la chronique historique... La grande technique du roman historique, c’est de prendre un personnage, de le
faire entrer dans les événements de l’Histoire, et, dès lors, il devient support à un récit historique. Ce n’est pas cette démarche que nous avons adoptée. Par exemple, Mai 68 est pratiquement
toujours perçu dans des intérieurs, ou par la radio… Et les personnages ne sont pas trois meneurs de Mai. Ce sont trois étudiants anonymes... quelque chose change entre les années 1960 et 1970 et
les années 1990. Après Mai 68, même s’ils sont dans une certaine attitude de « retrait » du monde dans leur communauté, les personnages vont volontairement vers l’Histoire. Alors que dans les
années 1990, c’est l’Histoire qui a tendance à rattraper violemment les personnages, qui les confronte à l’histoire politique. »

On ne peut qu’être d’accord avec le message que veut délivrer le film : « Il s’agit de mettre fin à ce discours qui consiste à dire
que l’arrivée du sida doit mettre fin à l’amour libre et renforcer les positions réactionnaires. Non ! Il suffit juste de se protéger. Et ce n’est rien qu’un petit bout de latex ! Il faut arrêter
d’être victimes de ce discours ultra réactionnaire, qui profite littéralement de cette épidémie pour liquider une liberté qui dérange. »
On peut être surpris des conditions de sortie en salles de Nés en 68. La vie d’un film ne s’arrête pas lorsque la post production est terminée, au contraire elle commence. On peut donc
se poser la question de la date de sortie du film, qui me parait aberrante, en plein festival de Cannes, face au dernier Indiana Jones, et surtout confronté au dernier Desplechin qui a
« la carte » du triangle des Bermudes de la critique cinématographique française (Les Inrockuptibles, Télérama, Les Cahiers du cinéma), il suffit de voir la
honteuse différence de traitement faite dans les Inrockuptibles entre Un Conte de Noël et Nés en 68.
Nés en 68, un projet fou au départ et qui à l’arrivée donne un film
généreux et intelligent, malgré quelques faiblesses. Il démontre que le cœur peut transformer une utopie artistique en une courageuse réussite.
L’avis de nicco :
Dites-le avec des fleurs…
Elle est moche cette affiche, non ? Face à la grosse Bertha rouillée Indy 4, il faut une sacrée dose de témérité pour tenter d'attirer ainsi le chaland qui, dès connaissance de la durée
de la chose (pratiquement trois heures), sera définitivement convaincu d'aller batifoler avec les chiens de prairie numériques et les singes gominés de tonton goitre. Dommage, car ce Nés en
68 est un vrai bijou.
Nous sommes en 68, donc, en mai exactement. Catherine fait des bisous à Yves, puis fait des bisous à Hervé ; ils sont étudiants, contestataires, ils s'aiment. Sous les barricades et les pavés
parisiens, non pas la plage, mais la campagne. Le Lot, où le trio, accompagné de l'immanquable bonne (dans les deux sens du terme) copine anglaise et quelques amis fondent une communauté hippie
dans une ferme abandonnée. La vie en groupe et les conditions précaires auront raison au fil du temps des convictions les moins fortes, des doutes les plus profonds et de la confection de fromage
de chèvre sur les airs mièvres du barde de la bande.
Succession des saisons, élection de Mitterrand, les années 80 : les enfants de Catherine héritent des succès de leurs combattants d'aînés, mais doivent faire face à de nouvelles embûches, telles
les contrecoups d'un traitement de choc se répercutant jusqu'à nos jours.
La représentation de Mai 68 au cinéma a ceci de particulièrement français que du plus important mouvement populaire hexagonal d'après-guerre, les cinéastes, à quelques exceptions près (L'An
01 par exemple) n'en ont majoritairement produit que d'austères objets destinés aux ciné-clubs et à un public de festival, aussi excitants que des tracts coco de 180 pages tirés à la
photocopieuse à alcool. Le charme discret de notre culture en quelques sortes… (un ami plus pessimiste y voit un symbole de la spoliation des acquis du peuple d'en bas pour le plaisir feutré de
celui du haut. Soit).
Là-dessus, le duo à l'origine du très demyesque Jeanne et le Garçon Formidable se dit qu'il serait bienvenu de proposer un film
ouvertement romanesque et ambitieux non seulement sur les évènements, mais surtout sur ses conséquences, à travers une saga familiale s'étalant sur quarante années, permettant d'ouvrir ainsi un
champs de contrastes et de perspectives rarement vu sur les bandes françaises contemporaines. Intention hautement louable qui se verra targuée de « cours d'histoire de France pour les
nuls » (20 Minutes) gavé des « clichés et poncifs habituels » (Le Figaroscope). Rassurez-vous, la presse de gauche est tout autant à l'ouest pour défendre ce film,
voire même pour simplement en parler ; il faut croire qu'elle préfère hurler au génie lorsque les mêmes Ducastel & Martineau filment à la MiniDV un ado faire du patin à Rouen…
Nés en 68 est une fresque imbriquant ses personnages dans l'Histoire avec
du grand hasch, procédé classique visant à impliquer le spectateur dans la découverte de périodes et évènements passés. Mais le procédé développe ici une grande puissance émotionnelle, par le
biais du montage tout d'abord, qui ne souligne jamais ses multiples ellipses (mise à part la plus grande à mi-métrage, sûrement prévue dans l'optique du projet télé qu'était Nés en 68 à
l'origine), laissant ainsi le spectateur découvrir seul les changements survenus dans l'entourage des héros et être témoin comme eux du temps qui passe et des évolutions diverses de la société,
le rythme quasi parfait du film nous emportant dans l'inéluctabilité des destinées croisées de la bande révolutionnaire (les trois heures passent d'ailleurs comme une lettre à la poste). Et
ensuite par la performance superbe du casting, Laetitia Casta en tête, interprétant avec justesse et ambivalence des personnages attachants, devenant de fait, par la logique du projet, des
figures synedoctiques des époques traversées. Difficile dès lors d'échapper aux clichés dès que l'on illustre la période hippie tant ses codes esthétiques ont marqué l'inconscient collectif. Il
faut donc savoir faire la part des choses et ne pas mélanger un décorum pouvant difficilement s'éloigner de la réalité (ben oui les hippies partouzaient dans les champs avec des fleurs peintes
sur les seins, et alors ?) et les motivations des personnages, bien particulières à la présente fiction, affranchies de toute caricature : au-delà de la traite des chèvres et de la confection de
pulls en chanvre, ici nos hippies s'engueulent, se critiquent, font des erreurs, repoussent des camarades demandeurs de cul pour raison de sale gueule et grosse bedaine, et fraternisent avec les
paysans du coin, même s'ils sont de droite. Vachement « clichés »… (sic).
Car même si Ducastel & Martineau adoptent dans un premier temps un point de vue naïf et idyllique de l'après mai 68, reflétant les espoirs de cette génération, ils ne font pas l'impasse sur
une critique de ce mouvement. Ainsi Yves, le père des enfants de Catherine (Laetitia Casta), se demande comment changer le monde en vivant repliés sur soi-même en haut d'une colline du Lot. Dans
la deuxième partie du métrage, celle des désillusions (il faut voir la tête du même Yves au soir du 21 avril 2002…) son fils lui lancera un cinglant « Vous imaginez avoir transformé en
profondeur la société en pratiquant l'amour libre ? » Cruelle ironie que de voir ce même fils confronté au VIH, se retrouvant alors à devoir se battre pour pratiquer cet amour libre…
Parallèlement, sa sœur, devenue working girl, impose ses choix à son mari, tandis que sa mère devait risquer sa vie pour avorter. Autant de comparaisons et d'observations sur l'évolution des
mœurs et de la société intelligemment agencées par les auteurs, dont la mise en scène s'échine à ne jamais surligner quoi que ce soit pour mieux exposer les contrastes (une captation à plat qui
trouve quelques fois ses limites sur la durée). Et si les réalisateurs de Drôle de Félix n'apprennent pas grand-chose à ceux qui ont vécu ces époques, ils ont le mérite d'appliquer la
force du récit et le romantisme de la fresque au service d'une synthèse mettant en relief quarante années de luttes diverses que certains voudraient bien "liquider".
Et lorsque nos deux révoltés de 68, Yves et Hervé, se retrouvent en 2007, ils tentent de réveiller les morts (vraiment !) pour reprendre le flambeau, mais comprendront qu'en fait l'Histoire est
un éternellement recommencement : le dernier plan du film, un long travelling autour d'un rond-point (un cercle) sur lequel manifestent des étudiants (et autour duquel évoluent Yves et Hervé,
comme mis en orbite) illustre cette superbe phrase taguée sur un mur du Buena Vista Social Club : « Cette révolution est éternelle ».
Pour plus d’informations :







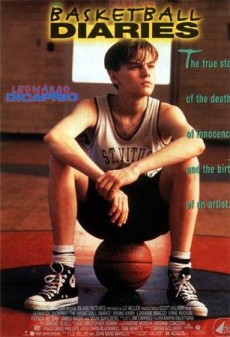
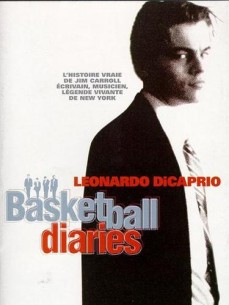
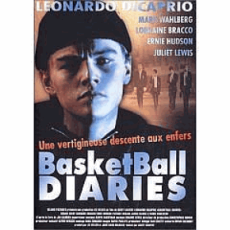
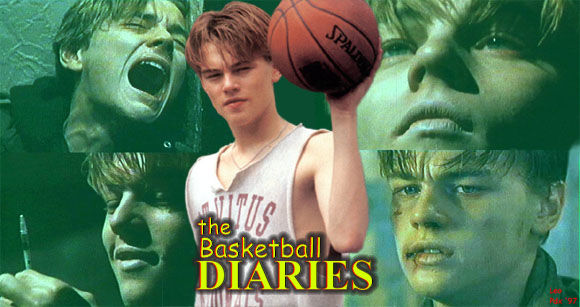





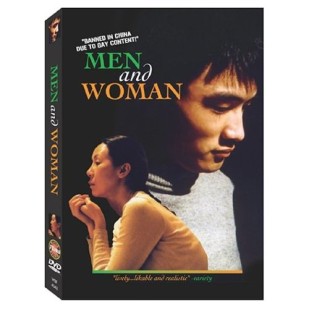



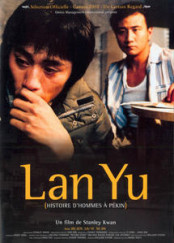

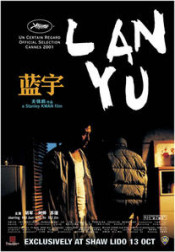
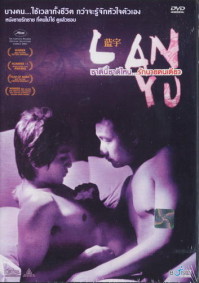










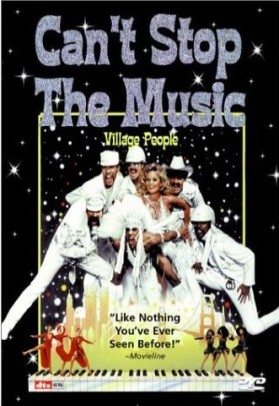















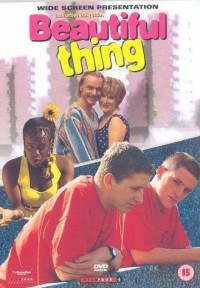
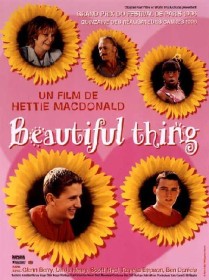
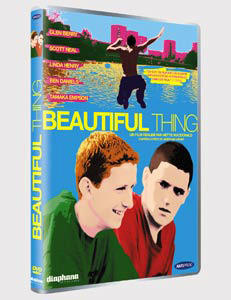









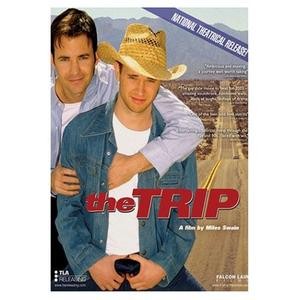



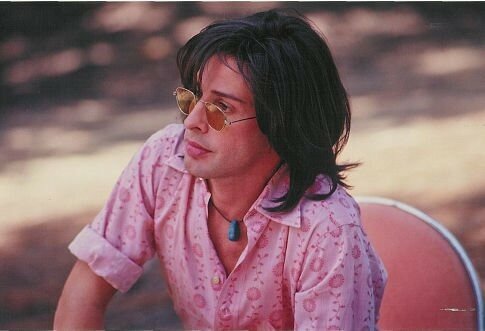





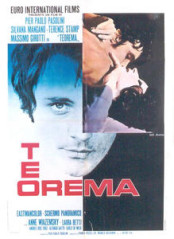
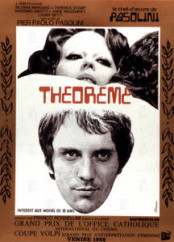
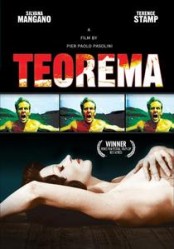








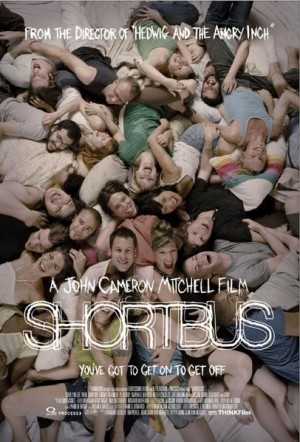
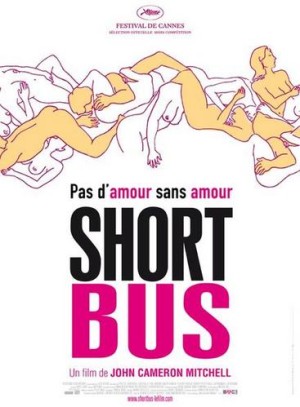















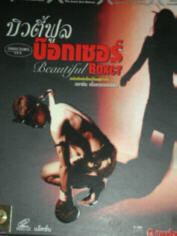


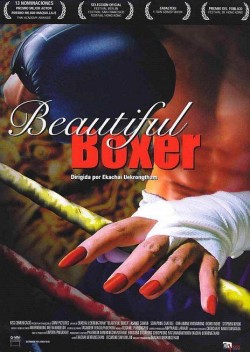






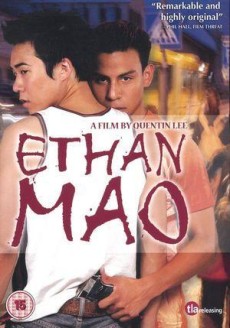
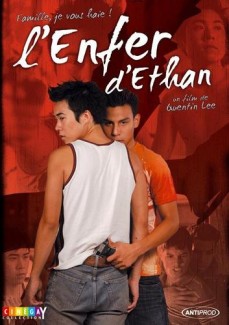
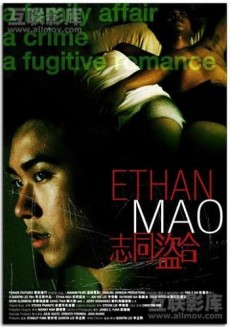































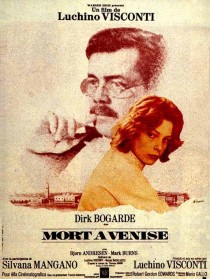
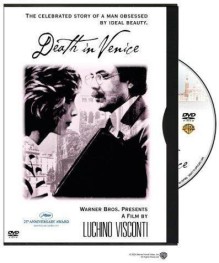





















Commentaires