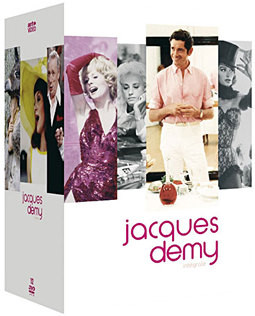
Fiche technique :
Editeur : Arte vidéo, novembre 2008. 12 DVD + 1CD audio. Livret de textes inédits et de photos des films et
des tournages. Coffret de l'intégrale des films de Jacques Demy. Le coffret comporte les trois films d'animation très rares réalisés entre 1944 et 1953 : Le Pont de Mauves, La
Ballerine, Attaque nocturne et les quatre courts réalisés entre 1951 et 1961 : Les Horizons morts (film de fin d'études à l'école de Vaugirard), Le Sabotier du
Val-de-Loire, Ars et La Luxure (sketch tiré des 7 pêchés capitaux).
Il semble toutefois manquer : Musée Grevin 1958 avec Jean-Louis Barrault, Louison Bobet, Jean
Cocteau, Michel Serrault et Ludmilla Tchérina (0h21) et La Mère et l'enfant (1959, 0h22).
Tous les films ont été restaurés de façon échelonnée depuis 1992 ce qui garantit l'enchantement pour
Le bel indifférent, Lola, Model Shop , La Baie des anges , Les parapluies de Cherbourg , Les
demoiselles de Rochefort , Peau d'âne , La
naissance du jour , Une chambre en ville et Trois places pour le 26 .
Seuls quelques films restent un peu moins réussis : The Pied Pipper , Lady Oscar L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune et Parking.
Suppléments :
Reportages d'époque : DVD1 : Interview de Jacques Demy sur Les 7 pêchés capitaux (1962).
Documentaire d'Agnès Varda : L'univers de Jacques Demy (90min - 1995). DVD2 : Documentaire : Cinéastes de notre temps : Jacques Demy à propos de Lola (1964). Reportage : Chronique
cinéma : Jacques Demy à propos de Model Shop (1969). DVD4 : Extrait du documentaire : Il était une fois... Les Parapluies de Cherbourg. DVD5 : Documentaire d'Agnès
Varda : Les Demoiselles ont eu 25 ans (64min). DVD 6 : Entretien : Peau d'âne raconté par des enfants. Jeu : La Princesse en chemise (il faut l'habiller). Documentaire :
Une productrice passionnée : Mag Bodart. Dessins : Le petit Peau d'âne illustré. Documentaire : Peau d'âne et les penseurs. BD : Peau de bique de Claire Brétécher. Court-métrage :
Peau d'âne d'Albert Capellani (1908). Karaoké : Les Chansons du film. DVD 7 : Reportage : Le Journal du cinéma : Jacques Demy et le joueur de flûte (1971). DVD8 : Entretien
avec Alain Coiffier, directeur de production : Sur le tournage de Lady Oscar. DVD 10 : Entretien : Autour de la sortie du film par Gérard Vaugeois. Reportage : Cinéma, cinémas :
Jacques Demy tourne Une chambre en ville (1982). DVD 11 : Reportage : Alsace soir FR3 : Sur le tournage de Parking (1985). DVD 12 Documentaire : Jacques Demy ou
l'arbre gémeau. Emission : L'art en tête : Portrait de Jacques Demy.

L’avis de Raphaël Lefèvre, Nicolas Maille et Alissa Wenz :
C’est ce qu’il faut bien appeler un événement : un joli coffret vient mettre fin à l’époque de la
traque acharnée des projections uniques et des VHS pourries des films de Demy. Si le plaisir secret d’avoir mis la main sur des introuvables disparaît, éclate au grand jour la folle cohérence
d’une œuvre pourtant bigarrée ayant renoncé en cours de route à son projet inaugural : cinquante films qui seraient reliés les un aux autres par leurs personnages communs...
Il y a une difficulté à parler de Demy, qui tient à l’écart entre la sentimentalité que son œuvre suscite
presque chimiquement et la lecture plus cérébrale que l’on peut donner de son univers torturé. Il y a surtout un risque qui consiste à donner de l’importance à des films au seul titre du rôle
qu’ils tiennent dans la cohésion de l’œuvre d’un auteur. Or celle de Demy, l’une des plus belles et des plus passionnantes que le cinéma français nous ait données, est incontestablement inégale,
en dents de scie, avec une tendance générale à la pente... Mais que voulez-vous, même en bas de la pente, étourdis, la tête pleine de couleurs, de chansons et de saveurs aigres-douces, on reste
heureux. Petit voyage en trois temps dans ce qu’il est désormais convenu d’appeler le demy-monde.

Un moderne très discret
Les courts métrages d’animation contenus dans la première galette du coffret – films de jeunesse perdus et
recréés à l’occasion du Jacquot de Nantes d’Agnès Varda – causeront sans nul doute quelque émoi chez les demyphiles, qu’ils soient sentimentaux ou cérébraux. Mais Le Pont de
Mauves (évocation du bombardement de Nantes sous forme de dessins tressautant sur pellicule, à la manière d’un Norman MacLaren naïf), Attaque nocturne et La Ballerine
(animations de figurines bricolées), s’ils ouvrent une porte sur la psyché du jeune Demy et laissent entrevoir quelque chose des films futurs (le soin apporté au décor, le petit monde menacé par
la forclusion), ont peu de chance de passionner les néophytes.
Plus captivant, déjà, est Les Horizons morts, film écrit, réalisé et joué par Demy lors de ses
études à l’école Vaugirard. Habilement construit en termes de structure temporelle, de composition des cadres et de contrepoints sonores, il est un rien compassé mais révèle quelque chose de très
touchant sur une certaine jeunesse – celle qui, grave, solennelle et douloureuse, à l’opposé de la spontanéité et de l’insouciance des garçons spirituels et libidineux de La Luxure
(délicieux épisode du film à sketches Les Sept péchés capitaux), prend la vie, l’amour et la mort très au sérieux. Ce tempérament excessif persistera chez Demy (voir la manière
magnifique dont Les Parapluies de Cherbourg transforme la banalité du quotidien et du devenir amoureux en tragédie emphatique), mais prend ici la forme attendrissante, à travers un
parcours ténébreux artificiellement touché par la grâce, de l’hommage un peu gauche de l’étudiant au maître admiré – Bresson, en l’occurrence.
Un rapport au religieux dont son cinéma se défera très vite. Ars, évocation de la vie d’un prêtre
canonisé (dont Bernanos s’est d’ailleurs inspiré pour Le Journal d’un curé de campagne, adapté – tout se tient ! – par qui l’on sait) touche à un point limite de ce qui deviendra
une attitude fréquente du cinéaste : ne pas juger. Ce qui rend le film ambigu, impossible à cataloguer : factuel, hagiographique ou distancié ? Les trois à la fois. Un peu
illustratif, aussi, dans le rapport image-son, même si sa manière de ne filmer, sur le récit de la vie de ce curé du début du XIXe siècle, que des décors, des rues vides, des objets, ou à
l’inverse les habitants contemporains du village, inscrit Ars dans un sillon cinématographique résolument moderne.
Filmer des lieux dépositaires du passé, Demy s’y livra plus qu’à son tour, s’offrant un travelling chaloupé
dans le passage Pommeraye quand Roland Cassard évoque Lola dans Les Parapluies de Cherbourg ou tournant son adaptation de La Naissance du jour à l’endroit même où Colette
l’écrivit. Comme dans Ars, on trouve dans cette dernière quelques déconcertantes redondances entre la parole et l’image, dans lesquelles il faut sans doute moins voir un manque de
confiance en l’imagination du spectateur qu’une traque des sentiments et des souvenirs dans les objets, les murs, les fleurs, les visages, l’écrit ; une croyance obsessionnelle en la
puissance du chromo ; un goût pour le mariage de la trace et de sa mise en scène, de la photo et du coup de pinceau. D’où un montage en flash-backs où le mot flash a tout son
sens : celui de bribes de passé, d’images mentales trouant le présent. Reste que lorsqu’il ne filme pas la chose dite, Demy filme le regard qui la dit, et c’est alors deux fois plus beau.
Beau comme ces scènes où se donne à voir le travail de l’écriture. Beau comme la voix-off de l’écrivaine sur laquelle vient parfois se poser à l’image, comme des mots sur les notes d’une chanson,
la bouche de celle qui l’incarne (Danièle Delorme). Beau comme la façon dont elle exprime le renoncement comme choix individuel, comme assomption d’une sérénité hors des tracas de l’amour et non
comme fatalité résignée. Beau comme le respect qui se love dans la fidélité maladroite à l’artiste adaptée.
Colette ne fut pas la seule à être traitée de la sorte : dès ses débuts, Demy adaptait avec déférence
Cocteau, le poète-cinéaste tant admiré chez qui il allait trouver une figure-clé de son cinéma, Orphée. Le Bel indifférent marque le début de la plus riche collaboration qui ait jamais
existé entre un cinéaste et un décorateur. L’apport de Bernard Evein dans ce film inauguré, comme Le Carrosse d’or de Renoir, par un lever de rideau, est décisif. Murs rouge vif, rideaux
verts sapin, peinture fraîche : il y a dans cette chambre en ville où, face à un amant irrémédiablement muet, une femme se débat entre amour et désespoir, humiliation et dignité,
vérité et mensonge, une présence indiscutable des corps, des choses et des sentiments. À des lieues de l’interprétation tremblante et impudique de la grande Anna Magnani dans La Voix
humaine de Rossellini, adapté du même Cocteau quelques années plus tôt, Jeanne Allard, d’une voix traînante et blasée à mi-chemin entre Maria Casarès et Dominique Sanda, dit le
texte et lui donne corps plus qu’elle ne le joue. Moins dévastatrice que chez Rossellini, s’accordant avec la rigueur absolue de la mise en scène – frontale, géométrique,
picturale, théâtrale –, la blessure du personnage n’en est que plus poignante.
Demy fut tout à la fois : modeste artisan et artiste têtu, classique flamboyant et moderne timide,
homme et femme, puritain et libertaire, conservateur, progressiste et radical… Dans Le Sabotier du Val-de-Loire, où, filmant à la manière de Georges Rouquier des traditions paysannes
appelées à disparaître, il se livre surtout à une splendide méditation sur le temps qui passe, frappe une acceptation nostalgique de la nature des choses (« C’est dans
l’ordre… ») plutôt étonnante de la part de celui qui, obsédé par la question de la résignation ou du sursaut, deviendrait un cinéaste du pas de côté, de l’hybridation, de
l’impureté.
Beauté et force politique de ce cinéma que d’être si difficilement assignable. Dans Le Joueur de
flûte cohabitent éloge bien-pensant de la tolérance et conscience aiguë d’un ironique paradoxe : la sortie de l’obscurantisme marqua également l’entrée dans l’ère du capitalisme
bourgeois. Drôle de film que celui-là, tourné un an après Peau d’Ane dans une toute autre perspective : à l’interprétation ludique, psychédélique et distanciée du conte de Perrault
succède un régime de représentation très anglo-saxon, une sorte de réalisme hollywoodien empreint d’un ton débonnaire à l’anglaise, avec pour seuls anachronismes la guitare et les jolies chansons
de Donovan. La plus plate mièvrerie y côtoie la plus folle férocité, la noirceur s’y dissout dans de purs instants de grâce : Demy fut décidément le plus schizophrène des
cinéastes.

Les jeux de l’amour et du hasard
Lola,
son premier long métrage, est joyeux et mélancolique, sentimental et minutieusement pensé, rempli d’hommages et très personnel – une merveille de fausse simplicité et de nostalgie feutrée, placée
sous l’égide de Max Ophüls (auquel le film est dédié), et dans laquelle s’exprime encore (sous une apparence très Nouvelle Vague, mais de manière explicite) l’influence du maître Bresson. Tous
les fondements de l’univers de Jacques Demy sont déjà esquissés dans ce conte nantais où le hasard arrange les rencontres, où de très jeunes filles s’entichent de marins de passage, où les mères
élèvent seules leurs filles, où l’attente est sans cesse glorifiée, magnifiée. « Vouloir le bonheur, c’est déjà un peu le bonheur », dit Roland Cassard à Lola, son amie
d’enfance qu’il a retrouvée par hasard, et qui attend le retour de son premier amour. Le thème de la fidélité, qui sera creusé dans Les Parapluies de Cherbourg, est déjà là, doublé d’une
idée qui fait tout le charme du film : celle d’un bonheur d’avant le bonheur, c’est-à-dire d’un bonheur dans l’espoir et le désir mêmes, plus que dans leur éventuel accomplissement. Tout
Lola est ici : dans cette attente-désir qui porte vers l’avant, qui donne la force de vivre. Les jalons d’un cinéma à la fois aérien et sérieux, d’une apparente futilité qui, comme
celle de son héroïne, n’est que le masque de la grâce, sont déjà posés.
On retrouve Lola – mais une Lola « cassée », disait Anouk Aimée – dans Model
Shop, tourné à Los Angeles huit ans plus tard : œuvre amère, à la mélancolie prononcée, qui est aussi le dernier volet d’une série de films dans lesquels on retrouvait, conformément au
souhait fondateur de leur auteur, les mêmes personnages. Le film, qui a reçu un accueil glacial aux Etats-Unis comme en France, était pratiquement invisible jusqu’à aujourd’hui. Il est grand
temps de redécouvrir ce qui est une pierre de touche dans le petit monde de Demy – parce qu’on y croise à nouveau des noms ou des figures connus, et parce que s’y expriment des thématiques tout à
fait caractéristiques. Dans l’un des bonus proposés par l’édition, Benoît Jacquot rappelle la surprenante « radicalité européenne » de ce film tourné aux Etats-Unis, où chacun
s’attendait à ce que Demy réalise un musical hollywoodien. Celui-ci, dans un autre bonus, évoque sa volonté de faire un film « très simple, très évident ». Model
Shop répond à Lola en reprenant et transformant le thème de l’attente qui y était fondamental : désormais, l’attente est triste, marquée par la peur – peur de la mort pour
celui qui s’apprête à partir au Vietnam où il doit effectuer son service militaire – et non par le désir. Dans ce monde qui a perdu ses illusions, il ne s’agit plus de « vouloir le
bonheur », mais d’essayer d’être heureux... C’est-à-dire de tenter de créer quelque chose (ce que propose explicitement George à Lola), d’imposer à un monde dont l’on n’est plus dupe quelque
chose comme un choix – le choix du bonheur « malgré tout », dit Jacquot. « Always try », martèle George dans les dernières images du film, comme pour s’en
convaincre lui-même. Toujours essayer, et ne jamais abandonner la partie.
« Dieu nous préserve des joueurs ! », disait Madame Desnoyers à Roland Cassard dans Lola. Jouer sa vie, prendre le risque, dans un mouvement ambigu
qui suppose à la fois l’engagement de son existence entière et l’abandon à ce qui serait une puissance supérieure, hasard ou destin : telle est la démarche décrite et magnifiée par La
Baie des Anges, second long métrage de Demy, dans lequel l’héroïne, blonde et non plus brune, mais tout aussi volubile et versatile (elle confond les deux mots) a la vivacité et l’élégance
de Jeanne Moreau. Demy disait avoir voulu « démonter et démontrer le mécanisme d’une passion » : le résultat en est un film sombre, assez cruel, qui exploite le thème
d’Orphée, primordial dans l’œuvre de Demy. Le collègue qui initie Jean au jeu répond au nom de Caron, et la descente aux enfers qu’amorce ce qui n’est au départ que de la curiosité sera ponctuée
par un finale en demi-teinte, plus déchirant que rassurant. Inquiétante fable sur la religion de l’aléa, et la difficulté d’y mêler les sentiments, La Baie des Anges prouve que le thème
du hasard, ici creusé jusque dans ses facettes les plus sombres, les plus dangereuses, n’a rien d’innocent chez Demy.
Ses films les plus connus, musicaux, lui ont façonné la réputation d’artiste inoffensif et naïf que l’on
connaît. Rien n’est plus faux que cette idée reçue, qui repose généralement sur une équivalence trop rapidement tracée entre chant et légèreté. On ne compte d’ailleurs, dans l’œuvre de Demy, que
deux films qui soient effectivement des « comédies musicales », réalisées dans l’esprit du musical hollywoodien. Les Demoiselles de Rochefort, film vu et revu, trop
rapidement étiqueté et qu’on ne saurait trop conseiller de revoir à la lumière des autres films, est à la fois un hommage revendiqué à un genre bien précis et une œuvre très personnelle. Le
coffret va enfin nous permettre de comprendre qu’il est bon de connaître le Nantes de Lola pour apprécier le Rochefort que les sœurs Garnier cherchent également à fuir ; qu’avoir croisé
Mesdames Emery et Desnoyers aide à comprendre Yvonne Garnier ; que les rencontres manquées, omniprésentes dans Les Demoiselles, prennent tout leur sens à la lumière de celles de
Lola et Roland (puis George), de Guy et de Geneviève, de Mylène et de Montand. Le deuxième véritable « musical » de Demy est aussi son dernier film : Trois places pour le
26, réalisé en 1988 et mettant en scène Yves Montand dans son propre rôle. Curieusement, c’est à la fois son film le plus récent et l’un de ceux qui ont le moins bien vieilli – la
musique de Legrand n’y est pas pour rien. Inégal, ce dernier opus n’en est pas moins sympathique, généreux dans son approche des personnages, audacieux dans les thématiques qu’il entrelace. On
lui reconnaîtra notamment un traitement osé du thème de l’inceste – patent dans Peau d’Âne mais présent de manière latente dans bien d’autres films de Demy – et son hommage touchant au
cinéma et à la chanson, réunis en la personne mythique – et utilisée comme telle – d’Yves Montand.
Les plus désespérés sont les chants les plus beaux. On va enfin pouvoir redécouvrir Une chambre en
ville, largement boudé par le public à sa sortie en 1982 et souvent resté dans l’ombre depuis. Deuxième et dernier film entièrement chanté de Jacques Demy, Une chambre en ville est
plus noir, plus fou, plus radical dans son esthétique comme dans son propos. Grand film malade, qui exacerbe le parti pris d’« opéra populaire » déjà prôné par Les
Parapluies de Cherbourg, Une chambre bénéficie en outre d’une jolie édition, qui rend justice à ses couleurs d’une audace splendide, et propose des bonus plutôt intéressants ;
on trouve notamment un montage d’images du tournage, mais aussi de l’enregistrement (préalable) de la bande-son. Un autre bonus propose le témoignage de Gérard Vaugeois, critique à
L’Humanité au moment de la sortie d’Une chambre, et qui évoque la polémique ayant opposé les partisans du film à ceux de L’As des As de Gérard Oury, sorti au même
moment. L’édition des Parapluies de Cherbourg est également soignée : le film est accompagné d’un extrait du documentaire de Marie Genin et Serge July qui était absent de l’édition
simple. Film « en musique, en couleurs, en chanté », Les Parapluies marque la rencontre fondatrice d’un cinéaste avec une actrice – Catherine Deneuve, qui trouve ici
son premier grand rôle, et qui inspirera Demy pour trois autres longs métrages –, mais aussi avec la couleur (qu’il ne quittera plus) et avec le chant. Le chant quotidien, spontané, qui donne du
relief aux mots, en exacerbe les forces et les faiblesses – et qui redonne leur puissance tragique à des situations ordinaires.
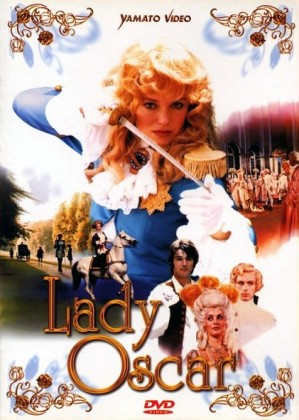
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe...
En tant que gardienne du temple, Agnès Varda a indirectement contribué à entretenir la douce illusion que le
cinéma de Demy n’était que pure fantaisie, construisant de ses propres mains la légende via le documentaire L’Univers de Jacques Demy et faisant en sorte de ne pas trop lever la voix sur
les productions des années 70/80. Ainsi, à côté des raretés que sont les courts-métrages de jeunesse, ce coffret est également l’occasion d’apprécier trois long-métrages (L’Evénement...,
Lady Oscar et Parking) trop longtemps restés dans le placard. Après avoir déguisé Cherbourg et Rochefort, le cinéaste s’est aussi amusé à travestir les genres, à débrider les
sexualités et à se pervertir d’inspirations souterraines. Terrain idéal pour les gender studies, ces intentions sont stimulantes quoique pas totalement assumées, et du trio, seul
Lady Oscar parvient à convaincre. Devant ces quelques ratés, le spectateur devient alors le témoin privilégié d’une œuvre qui bute, tâtonne et se retrouve à deux doigts de l’impasse,
voire de la stérilité.
L’Evénement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune n’est pas seulement l’un des titres les plus longs de l’histoire du cinéma français : c’est aussi l’une des
tentatives les plus queer du cinéma populaire des années 70. Il fallait oser s’attaquer ainsi au couple mythique de l’époque (Deneuve-Mastroianni) pour titiller sa sexualité !
Présent en filigrane dans Les Demoiselles de Rochefort par l’intermédiaire de Monsieur Dame, l’homme-femme passe enfin du stade d’Idée à celui de réalité, et voilà un homme... enceint.
Demy se détache de la comédie musicale et s’amuse d’une sympathique screwball comedy réalisée comme un pied de nez à Agnès Varda, féministe dans l’âme et accessoirement enceinte de
Mathieu. Le film ne parvient jamais totalement à dépasser le stade de la pochade, même si Demy décale parfois son sujet pour tenter çà et là une critique de la médiatisation via le personnage de
Catherine Deneuve. Les séquences les plus convaincantes sont ainsi celles où Demy se laisse aller à une ironie grinçante, comme dans ce passage où le couple assiste à un concert de Mireille
Mathieu, numéro de chanson populaire que Demy désacralise en y faisant ressentir à Marcello Mastroianni ses premières nausées, l’obligeant à quitter la salle... Trente ans après,
L’Evénement n’en est plus vraiment un, et l’on se dit que le film a plutôt mal vieilli tant au niveau du discours que de son esthétique : trop de fourrures improbables et de fleurs
aux tentures ! Mais son défaut principal est d’avoir peur de son sujet, au point d’avorter l’histoire avant son terme. Au final, la grossesse de Marcello Mastroianni n’était qu’une illusion,
là où les premières versions du scénario envisageaient un accouchement en bonne et due forme. Demy ou l’art d’un cinéma autophage qui rompt le charme en cours de route et laisse un goût amer
d’inachevé.
Mal perçu à l’époque, trop en avance sur les problématiques proposées mais finalement trop tiède dans leur
traitement, L’Evénement fut un échec critique et public cuisant, obligeant Demy à habiller ses personnages avec des capitaux étrangers : film de commande financé par une marque de
cosmétiques nippone, Lady Oscar a complètement intégré le fait d’être destiné à un public étranger (le film n’a guère été exploité sur notre territoire) et joue donc délibérément la
carte du pittoresque en traitant l’histoire de France comme un grand livre d’images animées. Il serait pourtant injuste de réduire Lady Oscar au simple rang de curiosité exotique.
Occasion d’entr’apercevoir Lambert Wilson dans l’un de ses premiers rôles, cette adaptation française en langue anglaise du manga Rose of Versailles manie relativement bien les
péripéties. Demy nous gratifie également de quelques morceaux de bravoure, comme ce travelling circulaire porté par le lyrisme de la partition de Legrand lorsque Marie-Antoinette retrouve son
amant Fersen. Les bonus du DVD nous permettent d’ailleurs de voir Demy à l’œuvre dans des images de tournages très rares.
Le renversement des genres entamé dans L’Evénement Lady Oscar en fait son postulat de
départ : comme dans les contes de fées, il a suffi qu’un père dise « ma fille, tu seras un garçon » pour que naisse un nouveau chevalier d’Eon au service de la cour,
engendrant son lot de quiproquos, de relations ambiguës et de baisers homosexuels. Avec Lady Oscar, le cinéma de Demy accède enfin à un certain degré de sexualité(s) mais comme toujours,
le travestissement ne peut-être que de courte durée et l’ambivalence sexuelle se voit rattraper par la bienséance. A l’instar de L’Evénement, le charme se rompt rapidement et c’est
seul(e) dans sa chambre qu’Oscar découvre la nudité de son corps de femme.
Comme beaucoup de films de Demy, Lady Oscar est une marche vers la clairvoyance, celle qui fait
comprendre aux garçons qu’ils sont des femmes et aux reines que le peuple meurt de faim... Le côté vignette de la reconstitution historique participe de cette problématique. Comme dans Les
Parapluies de Cherbourg où la ville décalée par les couleurs et la musique était une projection de l’univers mental de Geneviève et de Guy, le Paris révolutionnaire et édulcoré de Lady Oscar
peut être appréhendé comme le théâtre intérieur de Marie-Antoinette. Et comme dans Les Parapluies, l’ironie tragique est en marche dès les premières images. Si Marie-Antoinette veut
faire de sa vie un spectacle de marionnettes en carton-pâte, son royaume illusoire est d’emblée voué à la perte : le temps défile sur les images et se fait de plus en plus pressant, d’abord
les années, puis les mois, puis les dates, et la prise de la Bastille.
Troisième film « parisien » du cinéaste nantais, Parking est également le plus bâtard.
Demy lui-même n’hésitait pas à renier cette œuvre de sa filmographie. Kitsch dans le mauvais sens du terme (l’enfer en bleu et rouge traduit davantage un manque de moyens qu’un réel parti pris
esthétique), souffrant d’une monumentale erreur de casting (Francis Huster, peu crédible dans le rôle d’une rock star, n’a jamais été aussi insupportable, seuls Jean Marais et Marie-France Pisier
parviennent à tirer leur épingle du jeu) et d’une partition de Legrand oubliable (mis à part le thème principal tout en envolées lyriques), Parking intéresse finalement plus par ce qu’il
aurait pu être que par ce qu’il est réellement.
Aux origines, Demy se serait bien vu explorer les terres de L’Homme blessé, il rêvait aussi d’un
hommage à John Lennon/Yoko Ono, et pourquoi pas de ressusciter le mythique Orphée sous les traits de David Bowie. De Monsieur Orphée (l’un des premiers titres envisagés) à
Parking, le projet a énormément dévié, victime à la fois des aléas de la production mais aussi du manque de confiance de Demy en ses inspirations souterraines – inspirations
underground, devrait-on dire. Il est la preuve que le cinéma de Demy est alors dans une voie de garage qui l’empêche d’assumer complètement noirceur et transgression. D’où cette
impression d’avoir plus que jamais affaire à une œuvre inaboutie, à cheval entre deux inspirations à l’image d’Orphée partagé entre Eurydice et son ingénieur du son. Pourtant, jamais – sinon dans
Une Chambre en ville – Demy n’avait tenté de se mettre autant à nu. Il évoque la crise de son couple à travers Orphée et Eurydice, affronte face caméra le thème de l’homosexualité latent
dans tout son cinéma. Mais autant L’Evénement ou Lady Oscar traitaient avec une certaine légèreté l’ambivalence sexuelle et le retournement des genres, autant Parking
traduit une sexualité douloureuse et coupable. Au baiser entre Orphée et Calaïs, la magie inconsciente du montage fait succéder la mort empoudrée et ampoulée d’Eurydice. La question reste alors
en suspens, de savoir si cette sexualité coupable qui peine à s’assumer en écriture et en images ne serait pas à l’origine de l’inhibition d’un Minnelli qui se rêvait Fassbinder...
Une chose est sûre en tout cas : revoir Parking à la lumière des autres œuvres de l’intégrale
donne à ce film musical en mode mineur un semblant de profondeur et d’intérêt. Il était presque trop attendu que le cinéma de Demy assume un jour sa rencontre avec Orphée, tant le mythe traverse
les films antérieurs, se glissant dans l’enfer du jeu de La Baie des Anges, parasitant le départ de Guy pour l’Algérie (« Je m’éloigne de toi, ne me regarde pas »).
Mais après tout, pour reprendre les mots de Camille Taboulay, Demy lui-même n’était-il pas perçu comme un Orphée du cinéma, « voyageur d’entre-deux mondes » ?

Suppléments
Etant donnée la beauté de l’objet, on était en droit d’attendre beaucoup des « boni ». Légère
déception, surtout lorsque les intervenants, dont on espère une véritable lecture (subjective ou érudite) des films, se livrent davantage à la description, à l’anecdote ou à l’exercice
d’admiration qu’au commentaire éclairant. A quelques exceptions près : Benoît Jacquot, Agnès Varda sortent du lot, cette dernière avec des propos inévitablement sentimentaux mais pudiques et
sensés. Elle se dit notamment contente que Demy se soit intéressé à la psyché féminine, qu’il ait adapté la seule œuvre qu’elle aurait adaptée si elle ne s’était fixé comme règle de toujours
écrire elle-même pour le cinéma. Quant aux lectures du livre de Berthomé par Mathieu Demy, leur intérêt est divers mais ne dépasse jamais celui des textes mêmes. Peut-être le fils du cinéaste
aurait-il pu paraître à l’image afin de rendre plus vivantes, plus touchantes ces lectures. Les plus sympathiques restent sans doute les documents d’époque, comme les interviews de Jacques
Demy ou les images du cinéaste au travail.
A noter, enfin, qu’un CD précieux accompagne les films : il compile maquettes de travail et
séances d’essai des chansons que Michel Legrand mit en musique pour Demy. A écouter comme telles, donc, comme la petite cuisine des produits finis que l’on connaît. Comme il est poignant
d’entendre les sobres versions de trois chansons des Parapluies interprétées par Michel Legrand et sa sœur Christiane, qui font ressentir la nouveauté absolue du genre cinématographique
et musical que Demy et Legrand inventaient ensemble ! Comme il est étrange et amusant d’entendre un texte connu chanté sur des mélodies inconnues – ou plus encore, sur des mélodies
aujourd’hui attachées à d’autres textes connus... La musique de Trois places pour le 26, avec son utilisation calamiteuse de la boîte à rythmes d’un synthé ringard, s’avère, sans
surprise, toujours aussi insupportable. Mais la surprise vient d’une chanson non retenue au tournage de ce dernier film : Ensemble, bijou lyrique sur les promesses d’amour non
tenues et la volonté de vieillir à deux pour ne plus faire qu’un, vient clore le CD sur une note des plus émouvantes.
Pour plus d’informations :













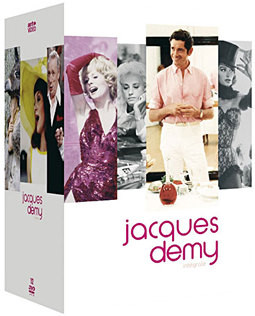



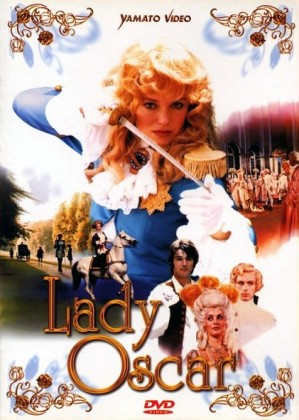

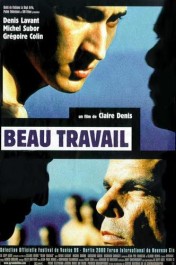
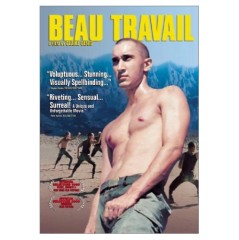
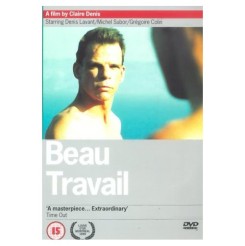









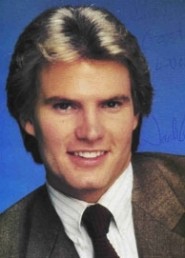








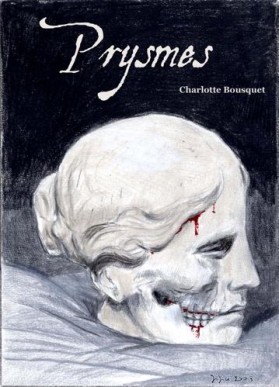








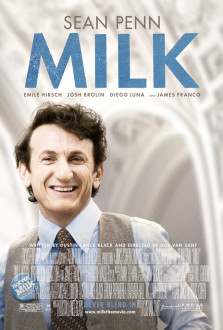



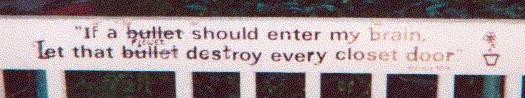














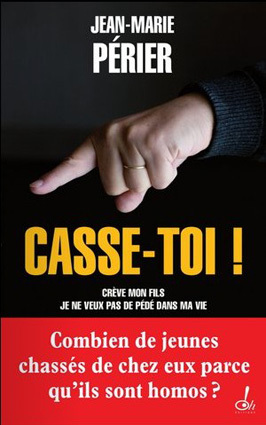
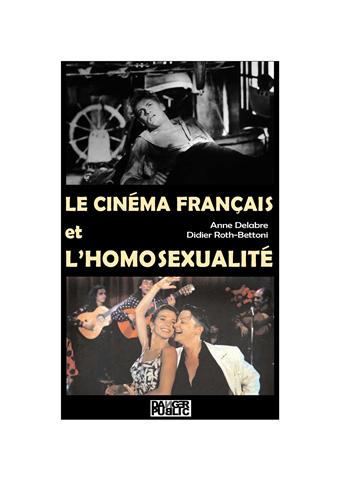
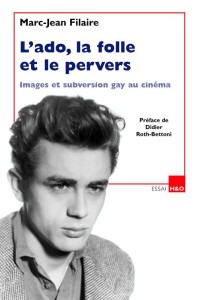

Commentaires