Le crépuscule rougeoyant s’abattait sur la ville-lumière, et le soleil dardait ses ultimes rayons qui transperçaient le store vénitien de la
chambre de Florian. Il ouvrit un œil, s’arrachant péniblement aux brumes du sommeil artificiel dans lequel un cocktail de psychotropes l’avait plongé. Les drogues, portes de l’oubli. À part
l’héroïne, qu’il ne prenait pas à cause de sa phobie des aiguilles, il avait tout essayé. Tout… pour oublier Jipé. Mais rien n’y faisait. Les narcotiques auxquels il était devenu accro peuplaient
ses rêves de cauchemars effroyables. Le visage de son tourmenteur y apparaissait sans cesse, sous diverses formes, le contraignant à une fuite en avant désespérée.
Pourquoi m’as-tu quitté ? Pourquoi suis-je incapable de t’oublier ?
Cela faisait des mois que Florian préférait dormir de jour. La nuit, pensait-il, ses rêves angoissés étaient deux fois plus forts, et la
sensation de mort qui les accompagnait plus terrifiante encore.
Il se traîna d’un pas lourd vers la salle de bains pour y prendre une douche. Recroquevillé sur le carrelage, il laissa l’eau chaude, presque brûlante, le débarrasser de ses impuretés. Le mal
était dans sa peau, non sur l’épiderme.
Je t’ai dans la peau, Jipé. Je t’en prie, ne pars pas !
Jipé était parti depuis dix mois, mais il était toujours là, tel un serpent ondulant dans le labyrinthe du cerveau de Florian. Vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, il parasitait ses pensées, l’empêchait de vivre. Un garçon amoureux et abandonné, naufragé d’une nuit plus obscure que celle qui enveloppe Paris, une nuit faite des
seules ténèbres, sans lumière ni espoir. L’autre nuit lui tendit ses bras, comme la précédente. La nuit parisienne, tourbillon de la fête et de l’insouciance. Depuis qu’il ne vivait plus que la
nuit, Florian avait abandonné ses études pour devenir barman. Il avait trouvé un emploi au D-Fonce, sexe-club glauque dont l’éclairage plus que tamisé se fichait pas mal de son teint blafard et
des traits tirés qui griffaient son visage.
Le D-Fonce portait bien son nom : au bar comme dans tous les recoins de la backroom, le sexe et la drogue mêlaient leurs effluves immoraux
dans une sarabande au parfum de stupre. Odeurs nauséeuses pour les novices, arômes enivrants pour les habitués qui, une fois qu’ils y avaient goûté, ne pouvaient plus s’en passer. Florian
n’aurait pu dire quel était le type de musique que passait le DJ ; dans les profondeurs de ce lieu de perdition, les gémissements, les râles orgasmiques et les rugissements rauques des mâles
en rut constituaient le vrai fond sonore. En certains endroits, l’obscurité était totale ; en d’autres, des veilleuses bleues ou rouges offraient un spectacle obscène à la concupiscence des
rôdeurs en quête de leur damnation.
À l’heure de sa pause, Florian frayait parfois avec la clientèle, les tripes nouées, mais l’envie, plus forte que lui, de flirter avec le
danger et de rechercher le baiser de la mort. Cette heure-là était sur le point de sonner lorsque l’arrivée de trois nouveaux consommateurs le fit blêmir.
Jipé. Non, pas toi...
C’était bien lui. L’homme de sa vie, l’amour de sa mort. Jipé, étrangement sanglé dans des vêtements de cuir que Florian ne lui connaissait
pas, entouré par deux hommes vêtus de la même façon, dont l’un était le guide. D’emblée, le chef entraîna sa meute réduite dans les entrailles du D-Fonce. Jipé suivit ses compagnons de débauche,
l’œil lubrique, la langue pendante, le sexe déjà gonflé par de coupables désirs.
Avec deux minutes d’avance, Florian quitta son service et s’enfonça à son tour dans les cavernes barbares. Il se fraya un chemin parmi ces
corps sans tête, en ayant l’impression que des milliers de mains tentaient de l’agripper, et qu’autant de queues cherchaient à toucher son intimité. Il sursauta en croisant un garçon qui lui
sembla à peine sorti de l’adolescence, et dont le visage angélique dégoulinait de sperme.
— Si t’en veux toi aussi, c’est par là.
Il tremblait. De peur, de rage, de honte. Il tremblait aussi du manque qu’il commençait à éprouver. Le manque de lui, le manque de stupéfiants.
Le manque de vie. Soudain il l’aperçut, là où il l’attendait le moins. Allongé sur un sling, Jipé, son Jipé, celui qui dans leur couple était le plus actif, se faisait labourer les entrailles à
grands coups de reins. Un Jipé inconnu, possédé par des hommes qui se succédaient dans son cul à tour de rôle, y plongeant sans répit leurs bites nues tout en beuglant des propos orduriers.
— T’aimes ça, hein ? Salope ! Tiens, prends ça dans ton trou à jus !
Florian sentit le sol crasseux et trempé de foutre de la backroom se dérober sous ses pieds. Il fut saisi d’un vertige, les cris bestiaux
tambourinaient dans sa tête. Il se vit alors, dans un effort surhumain, décrocher la croix de Saint-André et l’abattre avec férocité sur ces ombres pornographiques. Frapper, frapper, et frapper
encore, éclater ces corps sans âme, briser leurs attributs virils, et répandre un torrent de sang pour laver la chambre sordide. Provoquer des cris et des hurlements, et tuer Jipé, enfin, car son
crime mérite un châtiment.
— Non !
Une aurore éclatante réveilla Florian devant la porte du D-Fonce, à cinq heures, ce matin d’été.
— Eh Flo, ça va ?
C’était David, son collègue du bar.
— Je sais pas… qu’est-ce qui m’est arrivé ? murmura Florian, à moitié assommé.
— Tu es parti en courant vers une heure du matin, comme un fou. Tu étais dans un état, fallait voir ça !
— Est-ce que j’ai tué quelqu’un ?
— Quoi ? Tu délires encore, vieux.
La porte s’ouvrit, les derniers clients quittaient les lieux. Florian vit Jipé s’en aller avec ses deux compagnons d’orgie, plus trois autres.
Il ne les avait pas massacrés, mais dans son esprit c’était tout comme. Alors, pour la première fois depuis très longtemps, il sourit. Il éprouva un double soulagement. Dorénavant, Jipé n’était
plus rien. Ses bacchanales nocturnes l’avaient tué, enfin, et libéré de son obsession Florian qui n’avait tué personne. Comme un aveugle qui recouvre la vue, il se sentit revivre, affranchi du
joug de Jipé qui disparaissait à l’horizon, la mort dans les veines.
— Il fait jour…
— Oui, répondit David, ça va être une belle journée.
[Petite précision : il s'agit d'une nouvelle qui sera lue ce vendredi 20 juin dans le cadre d'une soirée autour de la
thématique du "thriller gay", organisée par l'association littéraire "La Rive Opposée" (Paris).]


















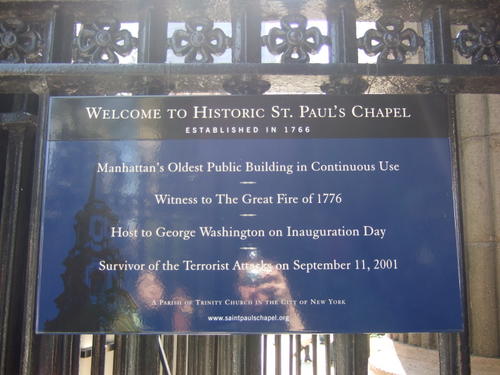






Commentaires