
Fiche technique :
Avec: Nicolas Gob, Michaël Cohen, Clémentine Célarié, Nozha Khouadra, Bérénice Béjo, Valérie Donzelli, Valérie Mairesse, Sophie Quinton, Carlo Brandt, Philippe Lefebvre, Cyril
Descours, Jean Dell, Alexandre Mercouroff, Sophie de La Rochefoucauld, Isabelle Ferron et Dominique Frot. Réalisateur : Renaud Bertrand.
Scénario : Véronique Lecharpy & Pascal Fontanille. Image : Marc Koninckx. Son : Jean Casanova. Montage : Laurence Bawedin. Musique : Stéphane Zidi.
Durée : 200 mn. Disponible en VF.
Résumé :
Nous sommes au début 1981. Lors d’un match de foot, un beau brun (Michael Cohen), genre intello mais qui soigne ses abdos, kiffe sur un blond (Nicolas Gob), Bruno de style plus rustique, dans la
douche des vestiaires. Tout ce qui va suivre est raconté par le brun. Nicolas et Bruno deviennent amis. Bruno a une petite amie, Isabelle (Sophie Quinton), qui se trouve être la sœur de Nicolas.
Isabelle accouche de Jérémy mais Bruno n’en est pas le père. De son coté Nicolas, homo et grand fêtard, a un meilleur ami, Jérôme (Cyril Descours), avec lequel il couche régulièrement. Jérôme
tombe amoureux d’un steward américain. Ce dernier ne tarde pas à tomber malade et meurt ; c’est une des premières victimes du sida. Jérôme est contaminé. Bruno voudrait se marier avec Isabelle et
reconnaître Jérémy. Isabelle hésite. Bruno réussit à la convaincre. Quelques jours avant de s’unir, passant par là, le couple est victime de l’attentat antisémite de la rue des Rosiers. Isabelle
est tuée, Bruno très gravement blessé. Hélène (Clémentine Célarié), la mère de Nicolas, élève Jérémy. Nicolas est désespéré et se jette dans la drogue et la fornication intensive. Bruno sort du
coma mais il est paralysé des jambes. Nicolas arrache Jérémy à sa mère Hélène pour s’en occuper et le rendre à Bruno. La séparation d’avec l’enfant rend Hélène folle. Bruno se rééduque et tombe
amoureux de son infirmière Nadia (Nozha Khouadra), d’origine algérienne. Elle est mariée avec Nabil, militant de Touche pas à mon pote. Elle a deux enfants. À cet instant, nous sommes à la
quarantième minute du film et si les scénaristes n’ont pas chaumé, il y a néanmoins beaucoup de trous dans la narration. Nous ne savons pas alors par exemple ce qui nourrit au sens propre comme
au sens figuré, Nicolas, son père ou Jérôme...

Nicolas fait accueillir Bruno, en chaise roulante, dans la belle et grande maison de ses parents. La famille recomposée disperse les cendres d’Isabelle dans un fleuve voisin.
1983, Jérôme développe le sida. Vers la quarante-cinquième minute, on comprend enfin que Nicolas est le secrétaire d’une importante politicienne de droite, tout en s’occupant de Jérémy et en
cohabitant avec la marraine de l’enfant qui lui sert d’alibi dans sa profession. Dix minutes plus tard, on apprend que le père va enseigner à l’université de Montréal. Nicolas et Bruno prennent
un appartement ensemble pour élever Jérémy. Au bout d’une heure de film, Bruno tente d’avoir une relation sexuelle avec Nicolas, mais il n’arrive pas à bander, fin de l’expérience, ce qui nous
vaut tout de même de voir Bruno nu de dos. La cohabitation des deux hommes est difficile. Presque guéri, Bruno a repris son emploi d’ouvrier menuisier.
1985, Nadia se bat pour faire éclater la vérité sur le sang contaminé. La mère de Nicolas vire alcoolique grave. Nadia s’aperçoit que Bruno a été contaminé lors d’une transfusion. La mère de
Bruno divorce et se remarie avec le patron de son ex-mari. Nicolas devient l’attaché parlementaire d’un député de droite qui recherche à faire éclater la vérité sur le scandale du sang contaminé.
Le député en question, tout marié qu’il est, est un un pédé dans le placard. Il drague Nicolas et rapidement ils couchent ensemble, la première fois dans leur bureau de l’assemblée nationale.
Mais leur histoire doit rester secrète. Bruno est viré de son boulot lorsque l’on découvre qu’il est séropositif. Le jeune et joli Jérôme meurt du sida. Fin de la première partie.

1986, Jérémy apprend que Bruno est malade et qu’il n’est pas son père. Nicolas est très amoureux de Pierre (Philippe Lefèbvre), son député. Bruno retrouve du travail chez un vieil ébéniste.
Nadia, qui a été chassée de son hôpital à cause de son engagement sur le sang contaminé, travaille maintenant dans un laboratoire spécialisé dans le suivi des malades du sida. Le sida de Bruno se
déclare. Il développe une première maladie opportuniste. Nadia passe de plus en plus de temps à son chevet. Nabil est jaloux. Bruno se remet.
1989, il se trouve une nouvelle copine, Fabienne (Bérénice Béjo). Quelque temps après, il développe une autre maladie opportuniste. Nadia se sépare de Nabil et vient vivre avec les deux hommes.
Bruno se relève encore et décide de vivre avec Fabienne. La mère de Nicolas n’accepte pas la nouvelle liaison de Bruno. Le député de Nicolas devient secrétaire d’État et lui, chef de cabinet.
Bruno retombe malade mais cette fois encore il s’en sort grâce à la bithérapie. Hélène se suicide par noyade le matin de Noël 1995. Bruno a une nouvelle maladie dont il ne se remet pas. Nadia lui
injecte la piqûre de la délivrance devant la télévision sur laquelle Bruno vient de voir la France être sacrée championne du monde de football. Pierre s’oppose au PACS. Nicolas menace Pierre de
l’outer. Ils se séparent. Pour se consoler, Nicolas, qui a trop bu, lève un jeune mec au matin ; il s’aperçoit que son coup d’une nuit est séropo et qu’ils ont eu un rapport non protégé. Nicolas
est contaminé. Pour récupérer Nicolas, Pierre rend public son homosexualité. Ils se remettent ensemble.

L’avis de Bernard Alapetite :
Contrairement à l’habitude, je n’ai pas écrit un résumé car il n’aurait pu être que trompeur, mais ce que l’on appelle, dans le jargon cinématographique, une continuité dramatique pour bien, je
l'espère, montrer l’incongruité de cette histoire causée par un trop plein de péripéties. C'est cette continuité dramatique que l'on présente aux producteurs pour essayer de les convaincre de
monter le film et aux différentes autorités pour essayer de récupérer quelque argent.
Dès les premières images, on sent que l’on va droit à la catastrophe artistique, plan trop serré sur l’action, les figurants c’est cher, donc le réalisateur resserre le cadre pour que le
spectateur ne s’aperçoive pas que la foule que le cinéaste est censé filmer, ne se résume en fait qu'à une demi douzaine de clampins. Mais surtout, la voix off, nous expliquant le pourquoi du
comment de ce que l’on devrait voir, est presque toujours un aveu d’impuissance cinématographique ; c'est ici patent.

L’échec du film tient autant à son esprit qu’à sa forme. Déblayons tout de suite la forme technique de la chose, n’importe quel producteur de bon sens devrait se rendre compte que traiter 27 ans
d’histoire en 3 heures, avec une foule de personnages lancés dans des péripéties des plus romanesques, est déraisonnable. Si la chaîne (1ère diffusion le 26 Mars 2008 sur la 2) avait été vraiment
courageuse et responsable, elle aurait dû produire une mini série de cinq à six épisodes de 90 minutes. Mais le péché originel de Sa raison d’être est d’avoir voulu mêler des genres qui
se révèlent antagonistes, soit le mélo cinématographique façon Douglas Sirk, avec le roman feuilleton genre Eugène Sue, qui a engendré le feuilleton télévisé tombé en désuétude depuis la mort de
l’ORTF. La différence principale des deux genres réside dans leur construction : le premier se nourrit d’un nœud gordien aussi inextricable qu’improbable et est d’essence fondamentalement
pessimiste ; le deuxième ne vit que par une incessante avalanche de péripéties tragiques et également peu réalistes mais rendues crédibles justement par leur arrivée continue dont la fréquence
empêche le spectateur de réfléchir. Dans cette dernière forme, au bout du compte, après bien des tragédies, quelques personnages arriveront au terme de ce chemin infernal et toucheront au
paradis. On le voit, des conceptions bien différentes, tant par leurs philosophies que par leurs rythmes. Les scénaristes Véronique Lecharpy et Pascal Fontanille, qui étaient déjà aux commandes
du très bon Un Amour à taire, ont voulu de surcroît faire coller les aventures particulières de leurs personnages avec l’Histoire de la période traversée : élection de François
Mitterrand, pandémie du sida, scandale du sang contaminé... La seule idée raisonnable qu’aient eu les auteurs est de rendre compte de toute cette foisonnante période par le biais d’un regard
spécifique, en l’occurrence celui des gays, personnifiés par le narrateur Nicolas. Non que la bonne idée ait été de choisir le regard gay, aucun communautarisme dans mon propos, ce regard en vaut
un autre pas plus, mais surtout, il réduit le champ narratif de ce scénario, qui par ailleurs explore beaucoup trop de sujets jusqu’à toucher au ridicule par leur accumulation et veut tout
embrasser sans rien étreindre...
Dans la deuxième partie, bien meilleure que la première si l’on excepte la toute fin lourdement didactique, le rythme devenant moins frénétique laisse enfin passer l’émotion. Les scènes entre
Bruno et Fabienne, par exemple, sont réussies.

Le parti pris de ne pas vieillir les acteurs par le maquillage (les personnages, au cheveu près, ont presque le même aspect du début à la fin du film alors que plus de vingt-cinq ans ont passé,
sauf Jérémy qui est joué par des garçons différents au fil du temps) est une bonne solution. N’imagine-t-on pas souvent les autres (et soi-même) avec un aspect qu’ils ont cessé d’avoir depuis
longtemps ? Autre bonne idée de faire des réunions de la famille élargie dans la grande maison des parents de Nicolas qui constituent des bornes sur la route du temps.

Si les poncifs ont souvent leur part de vérité, il est déconseillé à un réalisateur d’en faire un catalogue quasi exhaustif dans son film, comme c’est le cas dans Sa raison d’être. C’est
forcément un steward qui a contaminé le joli Jérôme, lourde allusion au « patient zéro » ; quand une femme est enceinte, elle ne peut que vomir ; le jeune prolo (Ah les gros plan sur le
torse de Gob en marcel ! Un grand moment !) est bien sûr homophobe et fils d’un routier. La politicienne de droite ne peut être qu’une caricature façon Boutin revue par Marie-France Garaud...
Les allusions à l’actualité du moment (la guerre des Malouines, les régimes communistes en Europe de l’est...) sont plaquées artificiellement dans les conversations entre les personnages et
arrivent comme des cheveux sur la soupe.

Il serait grand temps que les cinéastes s’aperçoivent que situer un film en 1981, présente les mêmes difficultés logistiques que de filmer une action se déroulant pendant les guerres
napoléoniennes ou le premier conflit mondial. Dans les trois cas, les objets de la vie quotidienne sont complètement différents de ceux d’aujourd’hui. Il y a même la difficulté supplémentaire,
lorsqu'une fiction se déroule dans les quarante dernières années, que bon nombre de spectateurs qui verront le film se souviendront des détails de ce temps-là et qu’ils n’auront pas oublié les
visages connus d’alors. Et bien avec des moyens limités, Renaud Bertrand s’en tire très honorablement, évitant les anachronismes trop flagrants (je n’ai guère vu qu’un sweet capuche peu plausible
lors d’un entraînement de foot en 1981). La reconstitution du Palace est plausible, en revanche l’avatar de Fabrice Emaert est grotesque et n’a aucune ressemblance avec son modèle dont la
physionomie est encore bien présente dans la mémoire de ceux qui sont passés au Palace.

Le miracle est qu’au milieu de séquences parfaitement ridicules, super téléphonées et très mal dialoguées, certaines scènes parviennent à être des îlots d’émotion, comme lorsque Bruno annonce à
sa mère qu’il est séropositif, et qui parviennent donc à étrangler notre rire continu tout au long des deux parties.
Cela est dû principalement aux comédiens (Michael Cohen et Nicolas Gob ont tous deux reçu, à juste titre, le Prix d’interprétation masculine à Luchon) qui dans ce mélo improbable, se débattant
dans des situations impossibles, débitant un texte parfois indigent, parviennent à rendre leur personnage convaincant et nous force à rester devant l’écran pour connaître la suite.

L’avis de Franck :
À la télévision, il n'y a pas que la Nouvelle Star. Le même soir, il peut arriver qu'un chef-d'œuvre soit diffusé sur une autre chaîne. On a bien lu quelque part qu'il y a un truc bien sur France
2 ce soir-là, alors on enregistre, c'est là sur son disque dur de son lecteur de DVD, en attente d'être regardé, et puis on voit les piles de DVD à la Fnac, alors on se dit que ça vaut peut-être
le coup d'être regardé, vraiment.
Alors, ce soir-là, car on n'a pas grand chose d'autre à faire, on se met à regarder Sa raison d'être. Et on prend une baffe. On aurait aimé ne pas être seul ce soir-là devant la télé,
avoir à ses côtés des bras où se lover pour pleurer, et rire aussi. Parce que ce téléfilm français est ce que j'ai vu de mieux à la télévision depuis l'épopée de la Coupe du Monde 98 racontée par Stéphane Meunier, c'est dire. À propos de la Coupe du Monde, il y a une scène terrible,
belle et tragique, dans Sa raison d'être, qui se déroule pendant la finale. Rien que d'y repenser, là maintenant, les sanglots reviennent. C'est là où j'ai pleuré toutes les larmes de
mon corps, en sanglots mesurés dans un premier temps, qui se sont transformés en cataractes quand le réalisateur a eu la bonne idée de mettre Jeff Buckley pour accompagner la deuxième partie de la scène. Il n'y a décidément pas de hasard.

Sa raison d'être, donc. 28 ans de la vie de Nicolas, Bruno, Isabelle,
Nathalie, et de Nadia, et Nabil aussi. Vaste fresque d'une France que je connais bien, d'une époque que j'ai vécue en adulte, 1980-2008. Comment une société coincée s'est ouverte le 10 mai 1981,
et comment elle s'est repliée, d'un coup, avec le retour de bâton de la crise, le culte de l'argent-roi… et le SIDA. Le réalisateur – Renaud Bertrand – décrit bien ces années-là, cette
rupture-là, sous l'angle du SIDA, car c'est le thème du téléfilm, les années SIDA, la découverte de la maladie, les premières années, où les malades étaient ostracisés à l'extrême, coupables,
forcément coupables, l'hécatombe, puis les premières découvertes, la stabilisation, la vie qui lutte, et qui perd parfois, mais de moins en moins, et le relaps, et la contamination qui
continue.
Chronique sociale aussi, avec un couple de beurs, elle infirmière, lui macho qui aime ses enfants, qui sont ni violents ni mafieux, qui aspirent à la normalité, trouver leur place dans cette
société-là. Cette image-là est encore trop rare à la télé française, de la même façon qu'une relation homo est très rarement montrée dans ce qu'elle peut avoir de normale, un coup de foudre,
l'émoi et les premières approches, une relation durable, avec ses crises. C'est le cas dans Sa raison d'être, bravo.

Ce téléfilm, c'est ce que j'ai vécu, parfois, beaucoup trop, par procuration, mais pas toujours.
Comme Nicolas, j'ai été assistant parlementaire ces années-là, et j'avais des patronnes, donc la comparaison s'arrête là. Dans la réalité, les bureaux sont bien moins vastes, et il n'y a pas de
telles salles de bain à l'Assemblée nationale ! À ce propos, seule erreur repérée dans le scénario, pour 200 minutes de téléfilm, ce qui est mince, les élections de 86 sont à la proportionnelle,
donc l'ouverture d'un musée dans une circonscription ne doit pas émouvoir un candidat aux législatives...

Comme Nicolas, dans les années 84-86, on effaçait des noms de nos calepins, on allait bien trop souvent à des enterrements. Je vous parlerais un jour d'Erik, l'homme grâce à qui je suis devenu
outrageusement européen, et libéral, au sens XIXe du terme s'entend. Comme pour le reste, il m'aura fallu des années de déni avant de pleinement l'assumer. Il est mort du SIDA. Et il y a eu
Pascal et Denis, chez qui, avec toute une bande de jeunes socialistes, filles et garçons, on s'éclatait des week-ends entiers, à Noisiel, dans ce superbe appartement au pied du RER. C'était
l'époque des « Nuits de la pleine lune », quand on découvrait la froideur et la post-modernité si « in » des villes nouvelles. C'était aussi l'époque des Nuits
fauves, et la bande découvrit l'hôpital Saint-Antoine. L'un des deux partit, le deuxième se retrouva en enfer. Et la bande se délita, chacun prit sa route, nos chemins politiques nous ont
éloignés les uns des autres.
Superbe téléfilm donc, avec d'excellents acteurs, dont Clémentine Célarié – on n'oubliera pas qu'elle a roulé un patin à un mec atteint du SIDA en plein Sidaction, pour démontrer qu'il n'y avait
pas de risque de ce côté-là. Dans le rôle de Nicolas, un excellent Michaël Cohen, qui a su jouer aussi bien le jeune con que nous étions tous dans les early 80's que le quadra en belle maturité
des années 2000 (et là, on est un peu moins à pouvoir souffrir la comparaison...). Belle maturité mais qui n'empêche pas les conneries...
À voir, malgré cette critique (juste mais négative) ici [Franck lie à son billet la critique de Bernard Alapetite publiée sur
notre blog (voir ci-dessus.) Merci à Franck de m’avoir autorisé à reproduire son post qui m’a profondément touché. Note de Daniel C. Hall].
Pour plus d'informations :








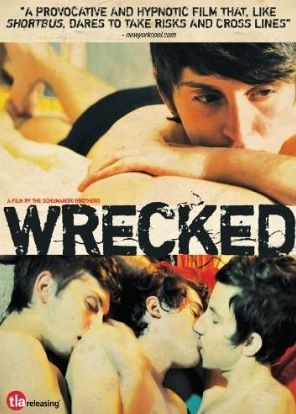







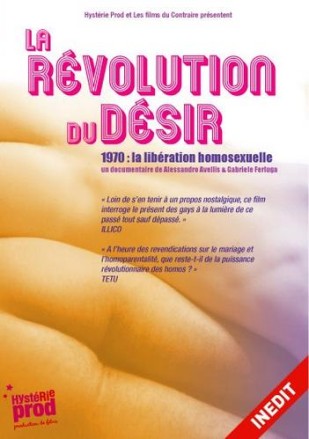


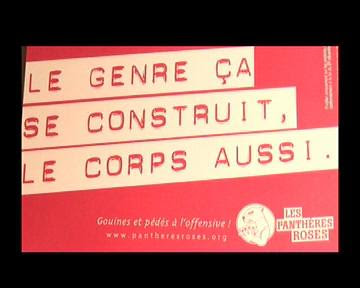



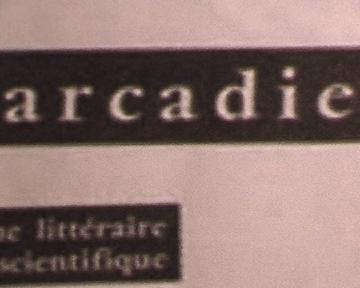





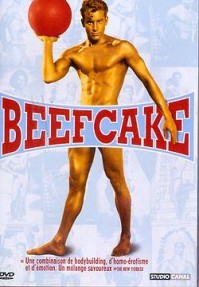
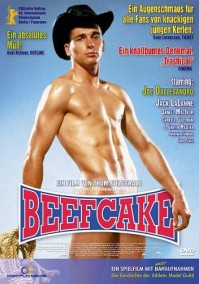
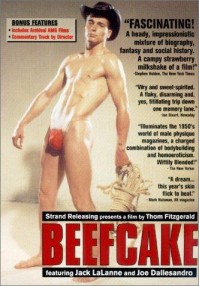









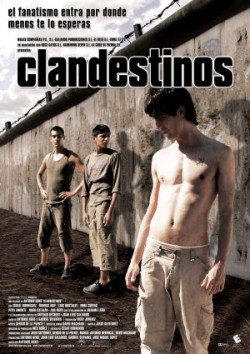
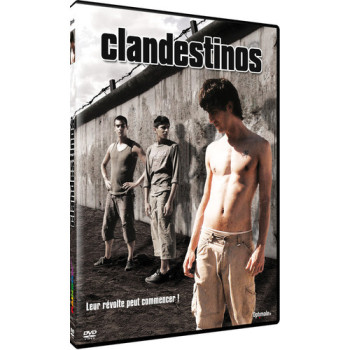

























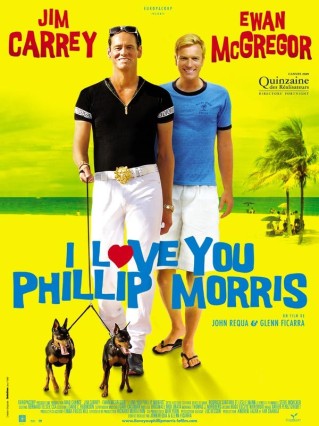
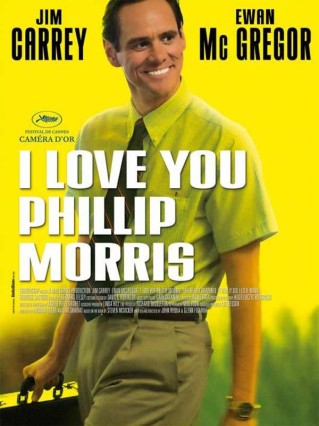
























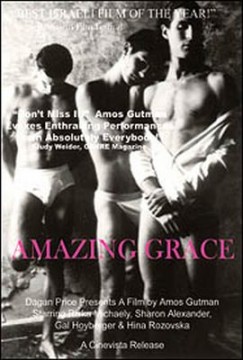





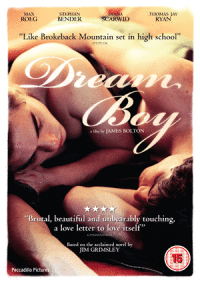
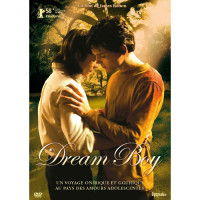
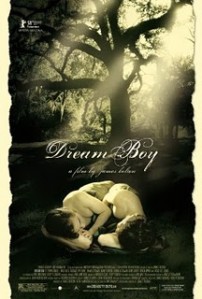











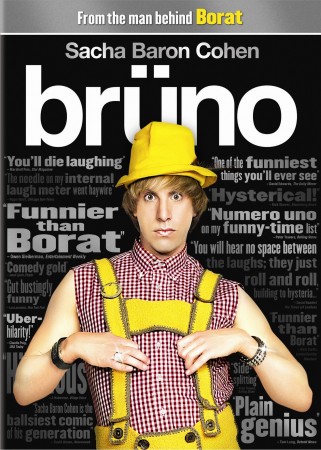








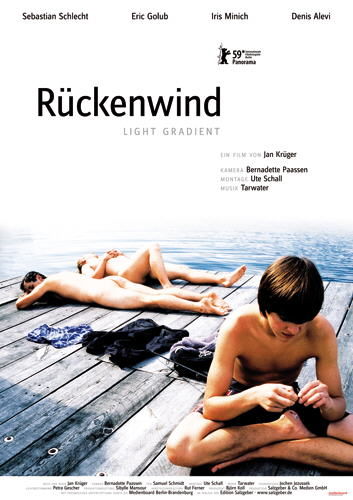










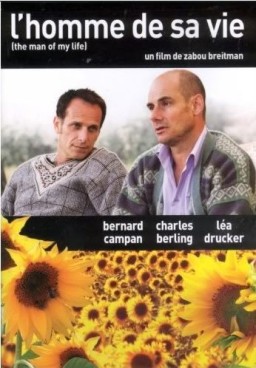








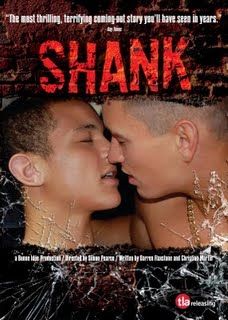
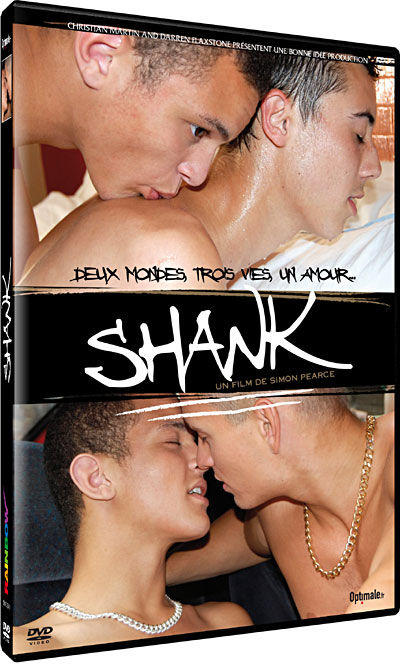












Commentaires